- Accueil
- Lettres de famille.
- 1846 -1850
1846 -1850
1846
Paris 7 janvier 1846
Mon cher frère,
En fait d’exactitude épistolaire, j’ai trop besoin d’indulgence pour en manquer envers les autres; sans cela je ne sais si je ne t’adresserai pas aujourd’hui quelques reproches qui me semblent justifiés par le silence que tu as gardé avec moi depuis notre séparation.
Le bulletin qui m’annonçait ton arrivée, les deux ou trois lignes que tu m’as adressées lors du dernier retard que j’avais mis à écrire, bien loin de constituer une correspondance n’équivalent pas même à une lettre et je puis dire que je suis encore à en recevoir de toi.
Je t’avoue que je n’ai pas moins de peine à trouver la cause de ton silence que tu en as , peut être , toi même à expliquer le mien avec nos chers parents. quoiqu’il en soit , c’est avec chagrin que j’ai vu s’écouler les premiers jours de cette nouvelle année sans recevoir de toi une marque de souvenir, et cela dans l’isolement où tu sais que je suis, dans l’ignorance où tu es de ce que je deviens et après la lettre que je t’ai écrite…
tout ceci dit sans reproche, mon cher Amédée, je viens t’offrir les souhaits que je forme pour ton bonheur qui contribuera toujours au mien, souhaits qu’il faut laisser à l’avenir le temps de réaliser.
Adieu mon cher ami, je t’embrasse de tout mon coeur et je te prie de croire à l’affection de ton frère.
Abel jeandet
P.S. j’aurais bien quelques nouvelles à t’apprendre sur notre restaurant, ce sera pour une autre fois , je te dirai seulement que toutes les personnes qui te connaissent s’informent souvent de tes nouvelles . Je te prierai d’aller toi même de ma part faire mes compliments de bonne année à notre oncle Pierre à notre tante et à Jeandet, je te charge également du même soin auprès de notre oncle Dambrun, de notre tante Adrien, etc …
Dis à notre bonne mère que j’ai reçu de Mme ??? les 10 francs qu’elle t’a chargé de remettre à Mme Machureau.
***
Bernard Derosne et cie Paris le 1846
rue St Honoré 115
à Paris
Mon cher frère,
Il y a quelques jours je ne pensais certainement pas qu’en t’écrivant, j’aurai besoin de m’excuser, mais la position dans laquelle je me trouve placé vis à vis de toi et de notre chère mère, les conditions dans lesquelles je t’adresse à la hâte , ces lignes, doivent changer complètement le fond et la forme de ma lettre. Ce n’est que dans l’après midi que j’ai reçu la tienne hier; Mademoiselle Lannoy, vient d’avoir l’attention , en l’absence de Mr Bernard de m’envoyer dire de passer de suite chez celui-ci, où elle m’a donné connaissance de la lettre de notre mère. Je ne te dirai pas la peine que je ressent des tourments que je lui ai causé , mais dont elle a été elle même l’artisan par les lettres inouïes qu’elle m’a écrites.
Cependant ne va pas croire , mon cher frère, que c’est de propos délibéré et par colère que j’ai gardé le silence, j’attendais seulement que je puisse annoncer quelque chose qui sans satisfaire complètement nos parents, leur rendit cependant ma position plus supportable . Cette chose je l’avais mandée dans une lettre donnée il y a une dizaine de jours à un de nos compatriotes qui allait à Mâcon , passant par Chalon et qui aura certainement gardé la lettre dans sa poche , de là ce silence qui vous a semblé insupportable même en tenant compte de mon inexactitude habituelle et du mécontentement que je devais éprouver.
Tu vois , par la nature du papier en quel lieu j’écris cette lettre , et tu comprendras le motif qui m’empêche d’y mettre plus de méthode et de la faire plus longue.
Je te dirai seulement avant de la terminer que je t’en écrirai probablement une par notre tante Adrien qui doit partir lundi prochain et certainement une à notre mère, auprès de laquelle je te prie d’intercéder pour moi ainsi qu’auprès de notre père, comme je serai heureux de le faire pour toi si le malheur voulait que tu en eusse besoin.
Je ne puis remettre plus longtemps à vous informer que j’ai pris depuis les 200 francs dont je vous ai parlé, une pareille somme auprès de Mr Bernard , je ne puis aujourd’hui préciser la date , mais je vous dirai ce qui est bien autrement important que sur cette somme il n’y en a que la moitié pour moi et que l’autre reste à ta disposition pour le jour de ton arrivée ici.
Dis à notre mère que j’ai reçu 30 francs de Madame ???? qui s’en repose sur elle du soin de l’employer comme elle le jugera convenable Mme Machureau.
Adieu mon cher Amédée, Mlle Lannoy qui est près demi me prie de te faire ses compliments, quand à moi je t’embrasse de coeur quoique j’ai bien des griefs contre toi et je te prie de croire au sincère attachement avec lequel je suis ton frère et meilleur ami.
Abel
***
Cette lettre est écrite sur du papier à entête de la mairie de Verdun sur le Doubs. Elle est adressée par Abel à Amédée au 185 rue St Jacques à Paris.
Verdun sur le Doubs, le 9 novembre 1846
Mon cher frère,
Dès hier notre mère était allée à la poste dans l’espérance d’y trouver déjà une lettre de toi ; ta marraine avait également demandé à Mme Chaussenot si tu avais écrit ; juge par là de l’impatience avec laquelle nous attendions le courrier de ce matin. D’après ce que tu nous dis des souffrances que tu as endurées, il parait que les pilules calmantes ne t’ont procuré aucun soulagement; enfin tu es arrivé sans de véritables accidents et aussi sain et dispo qu’après une purgation panchymagogue .
Nous aurions été bien aise d’avoir ta lettre dimanche matin pour notre dessert, mais maintenant que nous avons de tes nouvelles, nous trouvons que tu as mieux fait d’aller te reposer que de te mettre à nous écrire.
Nous avons été tous excessivement surpris de la promptitude avec laquelle tu as loué une chambre puisque la mienne était à ta disposition et que tu aurais pu arrêter celle qui restait disponible dans le cas où quelqu’un serait venu la demander. Si je ne me trompe , tu te serais, de suite installé dans ta chambre , en vérité nous ne comprenons pas pourquoi tu as donné la préférence à mon maître d’hôtel, et que tu aies mieux aimé lui procurer un bénéfice plutôt qu’à toi et à moi .
La modicité du prix qui semble t’avoir décidé me surprend également beaucoup, car ta chambre étant dans le même corridor que la mienne, c’est à dire au n° 14, il ne devrait pas exister une grande différence de prix entre les deux. enfin tu as fait ce que tu as cru convenable ; notre père ne doute pas que tu mettras la même activité à régler tout ce qui concerne tes études pharmaceutiques et il espère recevoir bientôt , c’est à dire dans une huitaine de jours , une lettre dans laquelle tu l’informeras de la manière dont tu auras disposé tes travaux.
Notre mère est déjà allée faire tes compliments chez notre tante Adrien, j’irai ce soir donner de tes nouvelles à l’oncle Pierre .
Le jour de mon départ n’est pas encore fixé, mais il viendra malheureusement trop tôt , quoique j’ai la consolation de penser que je te retrouverai là-bas.
Au revoir mon cher Amédée je t’embrasse de tout mon coeur et je te prie de ne jamais douter du sincère attachement de ton frère et ami
Abel Jeandet
P.S. Notre père me charge de te dire , comme tu l’en avais prié, qu’il a remarqué quatre fautes assez graves dans ta lettre, dont deux de participe, ce qui l’a surpris, quoiqu’il ait fait la part de la fatigue et du froid.
Il est inutile de te dire que notre père et notre mère se joignent à moi pour t’embrasser de coeur.
***
Paris le 17 novembre 1846.
Mes chers parents,
Il n’y a pas encore quinze jours que je vous ai quittés et cependant à l’ennui qui me talonne, aux regrets amères que je ressens, il me semble qu’il y a déjà plusieurs mois. En effet si je rappelle mes souvenirs et si je compare ma situation présente avec celle d’autrefois, je vois qu’à la vie d’intérieur si pleine de charmes, qu’aux douces joies de la famille, qu’à la société inappréciable d’un père, d’une mère, d’un frère, personnes dont on est aimé et qu’on aime soi-même si tendrement, je vois dis-je qu’à toutes ces choses, qu’on ne peut véritablement apprécier à leur juste valeur qu’après les avoir perdues, a succédé une vie triste, monotone et solitaire ! maintenant mes biens aimés parents je vous demande s’il est possible, à moins d’avoir un cœur de pierre, de ne pas s’abandonner à la tristesse, de ne pas céder à sa douleur, lorsqu’on met en parallèle deux positions aussi opposées et que l’on fait la part de l’une et de l’autre, trop longtemps j’ai respiré l’air de ma ville natale, trop longtemps je me suis assis au foyer paternel et j’ai puisé à pleines mains dans la corne d’abondance, pour pouvoir sans combat reprendre mon collier de misère. Mais ne devais-je pas m’y attendre à ce combat ? Pouvais-je espérer de pouvoir rompre si facilement des habitudes contractées pendant une longue année ? Il est probable qu’avec le temps mes chagrins s’affaibliront et que je finirai par accepter avec courage ma part de misères dans ce monde. Mais ce doute je suis certain , c’est que ce genre de vie n’en sera pas moins pour moi ce qu’il a toujours été, un bien pesant fardeau ; et je ne cesserai de répéter ces belles paroles d’Horace : Felices ter et amplius, quos irrupta tenet copula nec malis divulsus querimoniis. Suprema citius solvet amor die !
Le travail heureusement vient à mon secours et certes il ne me fait pas faute ; s’il ne me console pas encore comme je le voudrais, du moins il occupe mon esprit et l’empêche de s’abandonner à son penchant pour la mélancolie. C’est à partir d’aujourd’hui surtout que je commence à avoir beaucoup à faire, attendu que l’école de pharmacie a fait hier sa rentrée solennelle, et qu’aujourd’hui ont commencé ses cours du semestre d’hiver. Puisque j’en suis sur ce chapitre, je vais vous exposer succinctement en quoi consiste mes études pharmaceutiques. Je suis trois cours à l’école de pharmacie savoir : le cours de chimie de M. Bussy qui a lieu trois fois pas semaine, celui de M. Soubiron ( physique) qui a lieux deux fois par semaine, enfin le cours d’histoire naturelle médicale qui se subdivise en deux branches professées chacune par un professeur différent : le cours d’histoire naturelle médicale ( minéral)fait par M. Guibourt deux fois par semaine, et enfin celui d’histoire naturelle médicale (animaux) fait par M. Guilbert et qui a lieu aussi deux fois par semaine. Je vais en outre à l’école de médecine au cours de chimie de M. Orfila que je trouve fort inteéressant. Ajoutez maintenant à cette longue énumération, les études que nécessite le baccalauréat et vous pouvez approximativement vous faire une idée de l’emploi de mon temps. A propos de baccalauréat, j’aurais d’après ce que j’ai appris ici et les réflexions que j’ai faites, quelques observations à communiquer à mon père, mais comme rien ne presse je les réserve pour servir de matière à une autre lettre. Avant de terminer celle-ci, je vous dirai que M. Bernard m’a selon son ordinaire très bien accueilli et qu’il a poussé la courtoisie jusqu’à me donner à entendre que quand je voudrais venir dîner chez lui j’y serais toujours le bien venu ; il va sans dire que je n’userai que fort rarement de ce privilège. Je suis allé aussi voir M. Adrien et j’ai dîné chez lui jeudi dernier. Mais il se fait tard et je me vois forcé d’aller porter ma lettre à la grande poste rue J.J. Rousseau.
Adieu mon cher papa et ma chère maman, je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de croire à l’affection sans borne de votre fils.
Amédée Jeandet
J’embrasse aussi bien tendrement mon cher frère s’il a encore le bonheur d’être près de vous.
P.S. J’oubliais de vous dire que j’ai pris mon inscription à l’école le lendemain de mon arrivée. Mes compliments à nos parents et connaissances. (répondez moi sous peu)
***
Cette lettre est écrite sur papier à entête de la mairie de Verdun et adressée par Abel à son frère Amédée au 185 rue St jacques à Paris.
Verdun sur le Doubs le 29 novembre 1846
Mon cher frère,
Après avoir joui pendant une année des douceurs de la vie de famille, je ne doute pas de l’ennui que tu dois ressentir là-bas tout seul ; je sais par expérience combien les premiers temps de cette vie d’isolement sont pénibles ; c’est une épreuve que tu avais à peine subie et que j’espérai te rendre moins rude en la partageant avec toi, mais des circonstances importantes ou insignifiantes , selon ce qu’il en résultera , ont voulu que je restasse ici jusqu’à ce jour. Mais quoiqu’il arrive tu dois bien penser que je noterai toujours ces circonstances comme favorables puisqu’elles m’auront procuré le bonheur de rester un peu plus longtemps avec nos chers parents.
Ils s’associent tellement à tes ennuis, mon cher ami, que déjà depuis trois ou quatre jours, ils m’engagent à t’écrire; ce à quoi je consacre la matinée de ce dimanche . Tu aurais reçu cette lettre un peu plus tôt, sans de véritables études stratégiques auxquelles nous nous sommes tous livrés sur la funeste et à jamais mémorable campagne de Russie. La lecture du journal d’un acteur héroïque de ce drame lugubre, avait reporté notre attention sur cette triste page de nos passés militaires, teinte de tant de sang français que nous y retrouvons même du notre….
Tu nous manques toujours, mon cher ami, mais vraiment, tu mous manques bien davantage encore durant cette lecture. Je ne te dirai aujourd’hui, ni le titre de ce journal, ni le nom de son auteur afin de te ménager une surprise agréable pour une autre fois.
Te donner le plaisir de recevoir des nouvelles de nos bons parents est le seul but de cette lettre ; tu connais trop le calme et l’uniformité de notre vie pour que j’ai besoin de t’en parler. Rien d’important ne se passe dans notre villette ; cependant comme la moindre nouvelle de la patrie et de la famille absente nous intéressent , je crois te faire plaisir en te donnant une petite revue verdunoise . et d’abord pour commencer par ce qui te touche le plus je te rappellerai que c’était jeudi dernier, 26, le jour anniversaire de la naissance de notre père, le soir notre mère a fait quelques gaufres que nous avons partagées avec les dames Adrien ; la veille selles étaient venues nous payer les marrons. Ai-je besoin de te dire que si tu n’en a goûté ni de ceux ci ni de celles là, nous les avons pas moins tous partagés en pensée et en paroles avec toi ; c’est un peu insipide au goût et léger à l’estomac, mais aussi c’est doux et nourrissant pour le coeur.
La semaine qui vient de s’écouler a été l’une des plus fécondes en mariages, qu’on ait vu depuis longtemps. Les affiches de six bans décoraient la porte de notre hôtel de ville ; de ces épousailles, je ne te mentionnerai que deux , celle de Guillemin avec Reine Coutru, et celle de Mlle Faivre avec M. Thévenin de la Barre de Saunière.
Nos rivières sont aujourd’hui très grandes, après avoir été excessivement basses jusqu’à ces derniers jours. Le 24 au matin on pouvait encore passer au petit Doubs, maintenant c’est un fleuve rapide et profond . Je terminerai ce qui regarde notre pays en t’annonçant que les soirées paraissent gravement compromises pour cet hiver, car personne n’en a encore parlé.
Lorsque tu nous a informé de ta visite à M. Bernard, tu n’as pas dit que tu lui avais demandé de l’argent , notre père a été très surpris de cet oubli que tu voudras bien réparer dans ta prochaine lettre. Mme Pelletier est venue pour avoir des nouvelles de son fils, elle espère toujours le voir arriver, elle désirerait bien savoir à quoi s’en tenir à ce sujet; quand tu verras ce fils tant soit peu oublieux , ne manque pas de lui parler de cela.
J’ignore si tu as déjà fait l’acquisition d’un dictionnaire des termes de médecine, chirurgie, pharmacie etc…celui dont nous avions parlé est par MM Begnin, Boisseau, Jourdan, Montgarny, Richard, Gandon etc… Paris 1830 in8° avec supplément , le tout coté 8fr75; tu sais qu’il y a une petite remise pour les élèves. Tu pourrais consulter mon catalogue imprimé de livres de médecine pour t’assurer si l’ouvrage en question n’a pas eu une nouvelle édition.
Tu devineras, sans que je te le dise, que le motif de mon long séjour chez nous est une négociation du genre de celle qui avait été commencée avant ton départ. Nous attendons incessamment un commencement de solution, c’est à dire un total avec chiffres ! ô temporal ô mora ! comme s’écriait le bon curé.
Demain je mettrai la main à la confection du mannequin que tu dois attendre impatiemment. Adieu, mon cher Amédée, nos bons parents t’embrassent de tout leur coeur, je me joins à eux et je te prie de me croire ton affectionné frère et ami Abel Jeandet
Notre mère désire savoir si tu as acheté du bois, elle te recommande de te bien chauffer, il fait peu froid ici depuis quelques jours.
***
Paris le 30 novembre 1846.
Mes chers parents,
Je ne puis rester plus longtemps dans cet état de doute et d’incertitude qui me ronge depuis plus de huit jours. Je voulais laisser aller la chose jusqu’au bout et, imitant votre exemple, garder un profond silence, m’isoler en quelque sorte, tout pendant que j’en avais la force, des seules personnes qui me font aimer la vie, mais hélas ! moi faible enfant, je me faisais illusions sur l’état de mon propre cœur, de mas affections, et ce matin 30 novembre en voyant encore mes espérances déçues, j’ai, je l’avoue, perdu courage, mon ressentiment s’est évanoui et a fait place au doute cruel, aux inquiétudes cuisantes que mon imagination en désordre aggrave sans doute. Je viens donc vous demander, ce dont vous devez être déjà instruits par les phrases décousues et sans ordre que je viens de tracer sur ce papier , ce que vous faites tous, si vous n’êtes point malades, pourquoi Abel n’est pas arrivé déjà depuis plusieurs jours, car c’est ce retard qui cause en partie mes inquiétudes : ma dernière lettre a du vous apprendre que j’attendais tous les jours mon frère, et il me semble que puisqu’il ne devait pas en être ainsi, il aurait été bien facile de me tirer d’erreur en m’écrivant quelques mots.
Adieu mes biens aimés parents, je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de croire à l’affection bien vive d’un fils qui est en ce moment bien à plaindre.
Amédée Jeandet
***
Mon cher ami,
Au moment où ces quelques lignes te parviendront tu auras déjà reçu de ton frère une lettre du 29 novembre, laquelle aura mis fin aux inquiétudes si ??? que tu as connues à notre égard. Dans la crainte, toutefois, que par un de ces hasards rares à la vérité, mais qui ne laissent pas d’arriver de temps en temps, je t’écris ceci pour te tranquilliser complétement sur nous.
Quoique j’ai été profondément ému à la lecture de ton épître, je me permettrais de te dire que ton amitié pour nous t’a fait oublier les motifs raisonnables qui pouvaient apporter un peu de retard à notre réponse. Ta lettre était du 29 et dix jours après ton frère t’écrivait. Tu l’as vu assez souvent ici, quand on te proposa de répondre, il se passa presque constamment deux ou trois jours avant qu’on ne le fasse. Quoiqu’il en soit, tout va comme par le passé, nous nous portons tous bien et si j’ai pris la plume dans cette circonstance, c’est pour que tu y croie davantage par le témoignage que je t’en donne.
Ton tout dévoué père et ami.
Jeandet
P.S. Ton frère est encore retenu ici d’une manière indéfinie pour une négociation qui ne marche guère et dont il te sera facile de juger l’objet.
Verdun le 2 décembre 1846 - immédiatement après la réception de ta lettre – nous ne t’écrirons avant que tu nous ais répondu.
***
Paris le 16 décembre 1846
Mon cher frère,
Quoique l’époque à laquelle vous avez reçu ma dernière lettre ne soit pas encore bien éloigné de nous, je t’aurais pourtant déjà écris depuis quelques jours pour hâter, par l’envoi de mon épître, l’arrivée de celle que Toi ou nos parents doivent m’écrire, car depuis mon retour ici, c’est à dire depuis que je me vois condamner à mener un genre de vie dont je n’avais fait l’apprentissage qu’au quart, la réception d’une lettre venant de chez nous me cause une joie infinie, c’est pour moi l’effet d’un baume salutaire, c’est un compagnon dans ma solitude, car pendant que je la lis , et cela m’arrive bien des fois dans une semaine, je ne suis plus seul ; je m’entretiens avec vous, et si toutefois ce bonheur est court, du moins il me soulage et raffermit un peu mon courage abattu. Je te disais donc, mon cher ami, que mon intention était de t’écrire plutôt , mais j’en ai été empêché par une maladie sans gravité il est vrai, mais qui ne laisse pas d’être, si non douloureuse, du moins fort gênante. Je veux parler d’une grippe bien déclarée, c’est à dire avec une toux sèche, fréquente, un coriza violent, la gorge malade au point de ne pouvoir avaler que difficilement ma salive, un petit mouvement de fièvre sur le soir, qui se prolongeait pendant une partie de la nuit. Des urines abondantes et sédimenteuses, enfin pour te compléter cette longue série de symptômes si bien tranchés, j’éprouvais en outre des douleurs dans la poitrine. Malgré tout cela je n’ai pas gardé précisément le lit ; je me levais très tard il est vrai, mais enfin je me levais tout de même pour aller quérir ce qu’il me fallait de nourriture. Ô comme je souhaitais ta présence, celle de notre mère, de notre père ! que les jours et les nuits me semblaient longues, que les heures s’écoulaient lentement à mon gré ! le soir, lorsqu’assis à mon foyer solitaire, il m’arrivait de sommeiller quelques instants , aussitôt je me trouvais transporté à Verdun où je vous voyais tous heureux et contents de notre réunion ; puis tout à coup j’entendais un bruit lointain qui s’approchait peu à peu, puis enfin qui finissait par m’éveiller, alors j’avais beau interroger du regard les objets qui m’entouraient, je ne voyais rien, rien que l’isolement le plus complet, seulement le bruit sourd, qui m’avait tiré de ma douce rêverie, se faisait toujours entendre… C’était Paris qui bourdonnait à mes pieds !...Grâce à dieu, je suis maintenant à peu près rétabli, et il ne me reste plus qu’un gros rhume qui ne paraît devoir me quitter de long temps. Mais en voilà bien assez sur mon compte, parlons maintenant de toi, mon cher ami, de ce qui te concerne : où en est l’affaire importante qui te retient la bas ? Il me tarde d’apprendre que tout va comme tu le souhaites, et que bientôt je vais avoir une sœur ; car enfin il faut en venir là et puisque tu as tant fait que de rester chez nous jusqu’à présent, tu devrais selon moi poursuivre chaudement l’affaire pour arriver enfin à un résultat décisif. Crois moi mon cher Abel, ne reviens pas ici pour recommencer la vie d’étudiant et pour aller comme je le fais du charcutier au boulanger et du boulanger à l’épicier, mais reviens y avec une gentille petite femme au cœur noble et affectueux, et dont les enivrantes caresses raffermiront ton courage et te donneront la force nécessaire pour conquérir le titre qu’il te faut obtenir. Ce sont là les rêves d’une imagination d’enfant, me diras-tu ? Point du tout, mon ami, c’est là la vie véritable, telle qu’on doit la comprendre et où, en définitive, tendent à arriver la plupart des hommes.
Vers la fin du mois dernier, est arrivé, à l’adresse de M. le Docteur Abel Jeandet,, une lettre qui, à la simple vue, me paraît être une invitation, toutefois comme je t’attendais d’un jour à l’autre, je ne la décachetai point ; et ce n’est qu’après la réception de ta seconde épître que je me permis de l’ouvrir et que je vis que c’était tout simplement le papa Mège qui t’invitait à Dîner et te priait surtout de ne pas oublier ta thèse. Du reste personne n’est venu te demander, si j’en excepte cependant, un certain individu qui ne s’est point nommé, mais qui, à la manière dont on me l’a dépeint, me paraît avoir assez de ressemblance avec l’auteur des Druides, du voyage en Bourgogne etc… Je te dirai aussi que le père Lanche ou Lange a remis son hôtel depuis à peu près un mois. L’hiver se fait vivement sentir ici, tout est couvert de neige, et au froid qu’il fait ce n’est pas de si tôt qu’elle fonde. Si tu veux savoir comment je me trouve au milieu de cette Sibérie parisienne, je te dirai que je n’ai ni chaud ni froid. Adieu mon cher Abel, je t’embrasse de tout mon cœur et te prie de croire à l’affection bien vive de ton frère et ami,
Amédée Jeandet
P.S. N’oublie pas de faire mes compliments aux dames Adrien et chez mon oncle Pierre. Personne n’est encore venu réclamer les pots de moutarde destinés à M. Adrien de Crécy. ( J’attends une réponse avant la fin du mois) Embrasse bien tendrement pour moi notre bon père et notre bonne mère.
Le mannequin n’arrive toujours pas. Le 11 novembre j’ai pris 200 francs chez M. Bernard : pourrais-je m’adresser de nouveau à lui quand j’aurai besoin d’argent ?
***
Verdun le 20 décembre 1846
Mon cher frère,
Nous attendions une lettre de toi avant de te donner de nos nouvelles, cependant j’avais résolu de ne pas laisser passer ce dimanche sans t’écrire , autant pour mettre fin à l’incertitude où tu étais relativement à mes négociations , que pour nous informer de quelle manière tu supportais l’hiver rigoureux que nous éprouvons ici, si tu n’en souffrais pas trop, et pour chercher à te réchauffer un peu en t’assurant de notre bon souvenir , en te disant combien de fois il nous arrive de te souhaiter une part de notre foyer de famille . Nous étions loin de prévoir qu’outre les ennuis de l’isolement et les inconvénients de la mauvaise saison, tu avais eu encore à essuyer les souffrances de la maladie ? Je n’ai pas besoin de te dire , pour que tu le saches, que cette triste nouvelle de ton indisposition nous a vivement peinés ; j’ai en particulier, d’autant mieux compris tout ce que tu avais enduré que j’ai moi même éprouvé les tourments. Enfin tu es guéri, probablement d’une partie de ta petite maladie , de ta bronchite aigüe , néanmoins ne néglige aucun des moyens capables de te débarrasser entièrement ou d’en prévenir le retour, tels que des boissons mucilagineuses et adoucissantes ; ( décoction d’orge perlé, tisane de jupiter etc …), une infusion de fleurs pectorales édulcorées avec sirop de pavot blanc, pou le soir calmerai la toux dont tu te plains encore. Nos chers parents recommandent bien de ne pas être trop économe de bois et de suivre les petits conseils que je te donne. Je sais que pour un pauvre diable d’étudiant réduit aux seules ressources de son hôtel, plus ou moins garni les moindres besoins sont difficiles à satisfaire, mais l’exécution de ce que je viens de te prescrire est des plus facile. deux cafetières de terre d’un prix très minime y suffiront. Quant à l’autre maladie , celle de l’âme et du coeur, le temps , la saison, l’espérance te procureront non pas la guérison, mais la force de la supporter. Du reste, mon cher ami, encore quelques jours et je quitterai nos chers parents pour aller soulager un peu tes ennuis en les partageant. Malheureusement ce n’est pas comme tu l’avais rêvé, comme je l’avais presque cru un instant que je vais te revenir. C’est une longue histoire que j’aurais à te raconter, car le temps me manque aujourd’hui pour cela. Tu as vu que je comptais t’envoyer cette lettre hier dimanche, mais j’ai été empêché par une foule de petits riens, et je me hâte de la terminer , quoiqu’elle soit un peu courte, dans la crainte qu’elle n’éprouve un nouveau retard aujourd’hui.
Je suis allé hier soir, faire tes compliments chez notre oncle Pierre et chez notre tante Adrien, tous te remercient de ton souvenir et m’ont chargé de pas les oublier auprès de toi, commission dont je m’acquitte comme mon ordinaire.
Je ne t’écrirai probablement plus; mon départ devant avoir lieu vers le jour de l’arque je tiens à passer à Verdun en famille , dans ce cas je t’offre dès à présent mes souhaits sincères de bonne année en t’embrassant de coeur et en te priant de ne jamais douter de la vive affection de ton frère et ami.
Abel jeandet
P.S. Je suis très contrarié du changement de notre maître d’hôtel car cela m’obligera de traiter mes petites affaires d’intérêts avec un étranger. N’attends pas le mannequin avec trop d’impatience, il n’est parti que d’aujourd’hui.
Tu remarqueras que je ne mets qu’un pain à cacheter à ma lettre : à bon entendeur…. salut .
Cette lettre d’Abel est écrite depuis Verdun et adressée à son frère Amédée élève en pharmacie rue St Jacques 185 Paris. Le cachet est du 21 décembre 1846 et mentionne Verdun sur Saône. Il faut savoir que Verdun se trouve au confluent de la Saône et du Doubs. Elle a été parfois appelée Verdun sur Saône et Doubs.
***
Paris le 30 décembre 1846.
Mon cher papa et ma chère maman,
En vous écrivant ces quelques lignes, je ne me conforme pas seulement à une ancienne coutume consacrée par le temps et par l’usage, mais j’obéis aussi au sentiment tendre et affectueux qui m’anime, qui me pénètre et me porte à m’acquitter d’un devoir, non pas du genre de ceux que l’on désigne sous les dénominations banales et vulgaires de convenances, de bienséances et d’étiquettes, choses sans doute très convenable si on les envisage au point de vue de la société, mais où le plus ordinairement les sentiments du cœur ne sont pour rien ; au contraire le devoir dont j’entends parler ici, est un devoir pieux, dicté par l’affection la plus vive et qui doit être en quelque sorte sacré pour un fils ayant comme moi, le bonheur d’avoir des parents tels que vous. Je ne sais si vous ajoutez foi à tous ces témoignages, à toutes ces marques d’affection tendre et sincère que je vous manifeste dans mes lettres, car si vous vous rappelez ma vie privée, ma vie d’intérieur, vous ne m’y voyez peut être pas tel que je me montre ici ? en effet je ne suis pas d’un commerce bien agréable, mes manières n’ont pas ce poli , cette délicatesse qui, à la fois plait et séduit, j’ai la parole brève, souvent impérieuse, je ne suis pas assez réservé dans la discussion où je pousse l’oubli des convenances jusqu’à dire des choses blessantes à mon adversaire. Enfin j’ai pu, dans un moment d’égarement exciter la juste colère de personnes cependant bien chères ; eh bien ! malgré tous ces défauts, qui sont graves il est vrai, mais dont la plupart sont inhérents à l’espèce humaine, car je ne prétends pourtant pas faire exception à la loi commune. Soyez bien persuadés que sous l’enveloppe, rustique et grossière qui me recouvre, bat un cœur sensible et généreux, qui n’est pas étranger aux douces émotions de l’âme et qui aime du plus vif amour ceux de qui il a reçu la vie. Lorsque vous recevrez cette lettre, mes biens aimés parents, ce sera à peu près l’heure de votre déjeuner, vous serez sur le point de vous mettre à table ou peut être y serez vous déjà ; alors à la vue de cette épître vous vous rappellerez plus vivement votre fils exilé loin du toit paternel et vous vous apercevrez sans doute de l’absence d’un convive ! Mais à quoi bon sert de troubler, par de tristes pensées, le bonheur dont vous avez encore à jouir pendant le séjour de mon frère près de vous ! Jouissez-en donc paix de ce bonheur, c’est là ce que souhaite un fils qui adresse au ciel les vœux les plus ardents pour la conservation de ses parents bien aimés. Adieu, recevez les embrassements bien tendres, bien affectueux de votre fils
Amédée Jeandet
Mon cher Abel
Je viens te remercier par ces lignes et de ton exactitude à me répondre et des lettres vraiment fraternelles que tu m’as écrites depuis notre séparation, car elles m’ont procuré quelques instants de bien être dans ma solitude, tant pour le plaisir que j’éprouvais à leur lecture, que par les marques d’intérêt et d’affection que j’aimais à y découvrir ; reçois donc mon cher ami les embrassements d’un frère qui souhaite ardemment que cette nouvelle année 1847 te vois de retour près de nos parents et enfin ???, car j’y tiens.
Ton frère et ami
A.Jeandet
(tournes la page)
P.S. J’ai besoin d’un second extrait de naissance attendu que celui que j’ai ici a été déposé à l’école de pharmacie, où il doit rester jusqu’à ma réception et qu’il m’a été impossible de l’avoir ; je te charge donc spécialement, mon cher ami, de m’en faire rédiger un autre à la mairie et te prie de t’en occuper de suite afin que tu puisses l’apporter avec toi.
P.S. Mes compliments de bonne année chez l’oncle Pierre et les dames Adrien ainsi qu’à la bonne mère Patin, car si je n’en parle pas plus souvent, cela ne m’empêche pas que je conserve toujours un bon souvenir et d’elle et de sa famille.
***
1847
Paris le 23 janvier 1847.
Mon cher papa,
Tu te souviens, sans doute, que dans la lettre, que j’écrivis il y a à peu près deux mois et dans laquelle je te donnai quelques détails relatifs à mes études pharmaceutiques, je ne fis qu’effleurer la question du baccalauréat et te promis d’y revenir plus tard, pour remplir cette espèce d’engagement, que je t’envoie la présente lettre. Ainsi tu vois, mon cher papa, que quoique tu ne me demandes pas d’éclaircissements , je t’en donne quand même ! Depuis mon retour ici, l’impitoyable Sorbonne a, dans deux sessions successives, admis ou éliminé, selon son bon plaisir, de nombreux aspirants au baccalauréat, cet écueil si difficile à franchir et qui n’est pas moins redoutable aux jeunes gens, que ne l’étaient aux matelots de l’antiquité, Charybe et Sylla. Il va sans dire que je ne suis pas du nombre des élus, et que probablement, lorsque mon tour viendra d’aller m’asseoir de nouveau sur les bancs poudreux de ce noir édifice, dont feu Robert de Sorbonne, dieu veuille avoir son âme, aurait bien pu aurait bien pu se dispenser de nous gratifier, on me fera l’honneur de me congédier poliment tout en empochant, néanmoins, mes vingt six livres. Que faudra-t-il donc que je fasse après cette nouvelle chute ? Tout simplement ce que fait notre Doyen, le père Victor Leclerc, qui veut, envers et contre tous, faire partie des quarante immortels et que l’Académie Française vient encore d’éliminer pour la troisième fois, je me présenterai jusqu’à satiété.
Un semblable langage, en pareil matière, te paraîtra peut être déplacé, et ce ton railleur que j’affecte, lorsqu’il s’agit d’une chose d’où dépend en quelque sorte mon avenir, doit d’autant plus te surprendre qu’il est peu en harmonie avec mon caractère, car tu sais que je ne suis guère plaisant de ma nature et que mon esprit, au contraire est plutôt porté à réfléchir sur ma position future, et à s’effrayer des obstacles qu’il me faudra vaincre pour y arriver ; mais que veux tu mon cher papa c’est un essai que je fais ; je tache de m’étourdir au milieu des ennuis qui m’assiègent, en me faisant illusion, et m’effraie , en véritable philosophe, de ne pas donner aux choses d’ici bas, plus d’importance qu’elles n’en ont réellement.
Je reviens à mon sujet : ayant laissé se clore la session de janvier, dans la conviction où j’étais qu’il me fallait, de nouveau, présenter mon extrait de naissance, pour consigner ; conviction que, du reste, le secrétaire sorbonnien avait, pour ainsi dire, autorisé en ne me disant pas, d’une manière précise, si on pouvait oui ou non m’exempter de cette formalité, ma présentation se trouva donc ajournée à la session d’avril, la seule, à laquelle je puisse prétendre pour cette année scolaire, attendu que je sais, par ma propre expérience, et par les renseignements de ceux, qui comme moi sont intéressés dans la question, que celle, de juillet et d’août, est inabordable. S’il est écrit là-haut, que je dois être encore refusé trois, quatre, cinq, six et même sept fois, à l’exemple de quelques malheureux jeunes gens que je connais, je réunirai tout ce qu’il y aura, en moi, de force et d’énergie, pour ne pas succomber, avant d’avoir encore essayé à la huitième. Eh cependant ! tout en reconnaissant mon insuffisance en bien des choses, j’ai vu, maintes fois, recevoir des bacheliers, et cela tout récemment encore, qu’il ne m’aurait pas été bien difficile d’égaler en savoir. Voilà, mon bon père, ce que je me proposaiss de t’écrire ; et si j’ai attendu, jusqu’à ce moment pour le faire, c’était afin que cette lettre arrivât, à peu près, vers l’époque convenue et que par conséquent, maman n’ait pas lieu de se tourmenter. Adieu mon cher papa, je t’embrasse de tout mon cœur, j’embrasse aussi ma chère maman et vous prie de croire à l’affection bien vive de votre fils
Amédée Jeandet.
Mon frère se joint à moi pour vous embrasser tendrement.
P.S. Mon cher papa, ne m’écriras-tu pas, dans peu, quelques lignes ? des compliments de notre part à nos parents et connaissances. Maman trouvera ci-incluse, la lettre que mon frère a écrite à M. De Longuy.
Recevez une fois encore les embrassements bien affectueux de votre fils
Amédée Jeandet
***
Loin de me déplaire, mon cher ami, le ton à la fois plaisant et philosophique qui règne d’un bout à l’autre de ta lettre m’a fait grand plaisir. Je désire que ce soit chez toi le résultat d’une réflexion fixe et arrêtée, et qu’elle devienne à jamais la règle de ta conduite. Les choses les plus graves de ce monde sont en effet bien vaines et bien futiles, et celui qui les prend et les accepte pour ce qu’elle sont, sans trop s’en soucier, a acquis l’ultimatum de la sagesse humaine. Si j’en parle ainsi ce n’est pas que je m’en sois accommodé de même, ni que je m’en accommode mieux aujourd’hui ; mais je n’en vois pas moins que c’est du bon côté que tu envisages cette importante question, et qui, quand on la traite de cette sorte, à ton âge, on a beaucoup fait déjà pour le temps à venir.
Je me félicite de trouver dans la manière dont tu abordes l’affaire du baccalauréat l’application de ces excellents principes. Nous sommes convenus ensemble que nous regardions comme une bonne fortune le cas où nous en sortirions avant trois ans . Ce parti pris, les défaites à changer nous surprendrons peu ou point du tout puisqu’elles sont prévues. Toutefois, plus les attaques seront fréquentes, plus nous aurons d’espoir de lasse l’ennemi. Je n’approuve pas en conséquence la résolution que tu as prise de ne te présenter qu’une seule fois cette année, à la session d’avril, sous prétexte que celle de juillet à août est inabordable. Il serait difficile d’imaginer en quoi cette dernière session offre plus d’obstacles que les autres ; mais en fut-il ainsi, je crois encore qu’il faudrait s’y exposer conformément à la tactique dont je viens de parler. Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. Il y a si loin du jour où il conviendra de se décider, que nous avons le temps d’y réfléchir.
Notre second trimestre commencera le 1° février. Pour y satisfaire tu as à prendre et tu as peut être déjà pris 200 francs chez M. Bernard Derosne. Mme Colombard ou sa fille devront te donner 64 francs. à l’acquit de quatre mois à 16 francs. ??? qu’on a payés à Machureau, en tout 26 4 francs au lieu de 266 y compris les 26 francs de l’examen au baccalauréat. C’est 2 francs qui te resteront dus. Tu sais maintenant à quoi à quoi t’en tenir à l’égard des arrangements que nous avons pris ici pour ta pension. Tu te rappelleras que nous l’avons fixée à 80 francs par mois ou 240 francs par trimestre. Informe nous si ce chiffre suffit aux indispensables besoins de ta position actuelle.
Qu’est devenu la clarinette ? en joues-tu quelques fois ? as-tu ou vas-tu bientôt prendre un maître, comme je te l’avais dit, pour quatre ou cinq leçons par mois ? Je tiens fort à ca que tu apprennes passablement cet instrument et je te renouvelle à cette occasion la promesse que je t’ai faite d’ajouter à ton traitement mensuel le surplus qu’il t’en pourra coûter.
Il y a depuis l’année dernière un progrès fort remarquable dans ta manière d’écrire. On y voit plus que quelques fautes d’inadvertance, saciété pour satiété ; maintefois pour maintes fois en deux mots, un parfait après un imparfait au lieu du même mode au subjonctif… Mais ce qui m’y touche réellement, ce sont les expressions où déborde pour nous toute ton affection, toute la sensibilité de ton excellent cœur.
Adieu, mon cher ami, porte toi bien, embrasse ton frère pour moi, ton dévoué père et ami
Jeandet
Verdun le 27 janvier 1847.
***
Paris le 27 février 1847.
Mon cher papa et ma chère maman,
Quoiqu’écrire une lettre soit pour moi une affaire très importante, vu mes talents en fait de style épistolaire, insuffisance d’ailleurs sensible en ce qu’elle est le résultat de mon peu de pratique, je me charge néanmoins de faire, cette fois, la correspondance. C’est donc uniquement pour vous donner de nos nouvelles, mes chers parents, que je prends la plume, car je n’ai rien à vous apprendre d’intéressant, du moins en ce qui me regarde. Et en effet que pourrai-je vous dire de moi personnellement ? rein ou presque rien. Les heures, les jours, les mois se suivent, disparaissent, et c’est sans regrets que je les vois m’échapper pour toujours et aller se perdre dans la nuit des temps, puisque pas un souvenir agréable ne me rappelle leur passage. C’est donc vous donner à entendre que ma misérable vie s’écoule triste et monotone, que malgré tous mes beaux projets de philosophie, je ne suis en définitive, qu’une chétive et faible créature, sans force, sans énergie retombant toujours dans les mêmes erreurs et n’ayant pas le courage de supporter, sans murmurer, ma petite part d’existence. Quelque fois cependant, lorsqu’il m’arrive de faire un retour sur moi-même, j’ai honte de ma faiblesse, j’en rougis intérieurement, ma conscience, cette sage et prudente conseillère, me tient un langage sévère, elle me reproche ma pusillanimité, me demande de quel droit je viens me plaindre, moi enfant qui commence à peine à vivre et qui par conséquent ne doit pas encore désespérer de l’avenir, ce vaste champ ouvert à toutes les ambitions comme à tous les talents.
Mais je vois venir les beaux jours ; le soleil, par la chaleur de ses rayons, nous annonce le printemps, comme tous les êtres animés de la nature , je me sent renaître, et la joie, l’espérance, semblent vouloir remplacer, dans mon cœur, le chagrin et la tristesse.
C’est que voyez-vous, mes biens aimés parents, mon imagination, prompte à s’enflammer, a bientôt franchi le long espace qui nous sépare encore des vacances ; Je crois voir et entendre rouler la diligence qui m’emporte loin de ma geôle, et Paris, cette cité qui croit être la France, ne m’apparaît à l’horizon que comme un point perdu dans l ‘espace. Mais laissons là les fictions et abrégeons cette longue causerie qui pourrait bien finir par vous paraître fastidieuse.
Avant de terminer cette lettre, je répondrai à une question que m’adressa mon papa : oui, mes chers parents, les 80 francs que vous m’allouez par mois, me suffisent, à la vérité je ne jette pas les sous par les fenêtres et je conduis ma barque le plus économiquement possible, n’imitant pas en cela le fils aîné de M. Bernard Derosne qui a eu le talent de dépenser en cinq mois environ vingt mille francs… en vérité ce jeune homme ira loin !... chut ! sur cette affaire.
Adieu mon cher papa et ma chère maman, je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de croire à l’affection bien sincère de votre fils,
Amédée Jeandet
Mon frère vous embrasse de tout son cœur.
P.S. Nous remercions maman des petites friandises qu’elle nous a envoyées par M. Dorène. J’ai pris chez M. Bernard deux flacons de sulfate de quinine à 13,29 ou 19,90, j’espère que M. Dorène voudra bien s’en charger.
( le mot maintefois, adverbe , s’écrit en un seul mot)
***
Te voilà si près, mon cher Amédée, d’un moment critique, que je ne veux pas le laisser passer sans te donner quelques encouragements. Nous avons depuis long temps arrêté notre compte à ce sujet, à moins que le hasard ou une bonne fortune, qui ne nous ont du reste jamais souri, ne vinssent à changer nos fâcheuses prévisions. Nous nous sommes appliqués ce vers du Satyrique à Laharpe : tomber de chute en chute au trône académique, car bon gré, mal gré il faudra bien enfin que nous prenions rang dans la docte assemblée.
Une chose que je te recommande expressément, si tu venais à passer l’épreuve préparatoire ou la version, c’est de ne point t’effrayer à l’aspect des professeurs dans les questions orales, mais bien de les voir tels qu’ils sont en effet, hommes spéciaux pour la plupart, philosophes, chimistes, physiciens, historien etc… tandis que tu es tout cela à la fois et que tu as sur eux une incontestable supériorité. Jamais je n’ai pu comprendre d’où venait aux pauvres candidats ce mouvement fébrile qui s’empare d’eux au début de la séance, sans les quitter un instant pendant sa durée au point qu’ils ne savent pas même user de leur véritables ressources et mettre au jour les connaissance qu’ils ont. Assied toi ferme sur le banc et restes y ainsi jusqu’au bout. N’imites pas les condisciples qui tremblent à tes côtés parce qu’ils ont songé à leur ignorance, ils ont oublié celle de leurs examinateurs et de tous les hommes en général.
Adieu, ton affectionné père
Jeandet
Dans ta prochaine lettre envoie moi la note exacte et par quantième des sommes que tu as prises chez M. Bernard depuis ton arrivée à Paris jusqu’à ce jour. A son défaut je n’ai pas pu mettre de l’ordre jusqu’ici dans mes comptes particuliers avec Mlle Pelletier
19 mars 1847
***
Paris le 29 mars 1847
Ta petite lettre ne me serait pas arrivée, mon bon père, que je t’eusse tout de même écris d’ici à quelque temps et si je le fais un peu plus tôt c’est pour te dire que l’époque à laquelle je dois me présenter à mon examen, n’est pas aussi rapprochée que tu le supposes, c’est à dire que je ne compte pas consigner avant la fin d’avril ou les premiers jours de ami, attendu qu’il y aura encire des examens vers ce temps là. Si j’ajourne le moment critique, ce n’est pas parce que son approche m’effraie, ou que j’espère être plus ferré en versions, mais c’est parce qu’il y aura moins de cohue, moins de confusion, les plus pressés ayant laissé le champ libre. Je te répéterai ce que je t’ai déjà dit souvent, si une fois je pouvais être admis à l’épreuve écrite, j’aurais pour moi plus d’une chance de succès à l’examen oral, car je crois savoir aussi bien que qui que se soit certaines parties du programme. Du reste je ne me fais pas illusion, sans doute il faut m’attendre à une défaite, mais enfin tout a un terme dans ce monde et, comme tu le dis avec raison mon cher papa, il faudra bien que nous prenions rang dans la docte assemblée, dont, j’ose le dire, je ne serai pas membre indigne. Voilà une assertion un peu trop hardie, trop prétentieuse, mais tant pis, je la laisse, pourquoi est-elle venue se placer au bout de ma plume ?... Je te le répète, mon bon père, j’aurai du courage, je tâcherai de résister de mon mieux aux coups du sort, et si parfois il m’arrive de faillir à ma promesse et de verser des larmes en secret, pour soulager mon cœur oppressé, ce sera à cause de vous mes chers parents, de vous seuls, qui méritez à si juste titre, d’avoir des enfants, dont vous n’auriez du attendre que joie et bonheur. Croyez-vous, si je suis jamais bachelier, que la joie que vous causera cet heureux événement, ne contribuera pas pour beaucoup à augmenter celle que j’éprouverai moi-même ? Le grand, le sublime Epaminondas, après la bataille de Leuctres, redit grâce aux dieu non pas seulement à cause de sa victoire, mais surtout parce que son père vivait encore, pour en être témoin. Ce rapprochement est sans doute trop élevé pour mon sujet, mais tu me le pardonneras eu égard au sentiment qui m’en a suggéré l’idée. Du reste ce qui me tourmente, ce qui me cause plus d’inquiétudes que tous les baccalauréats possibles, c’est le mauvais état de ta santé ; Je sais que tu as des éblouissements, des palpitations et que comme toujours tu persistes à éviter la signée, seul remède efficace et capable de faire cesser ces accidents. Quoique la plupart du temps, il soit assez difficile de déterminer les causes des maladies, quelque fois cependant, il n’est pas possible d’avoir le plus léger doute à cet égard ; ainsi par exemple, pour ce qui te concerne, tu sais que les éblouissements et les palpitations que tu éprouves n’ont qu’une seule et même cause que tu peux faire disparaître à l’aide d’une forte saignée.
Maman n’est pas non plus très bien portante, il faut et même j’exige, qu’elle se soigne et surtout qu’elle oublie à tout jamais ce maudit mariage d’argent avec tous les curés de la terre. Car enfin votre vie ne vous appartient pas, c’est notre bien à mon frère et à moi, c’est ce que nous avons de plus précieux dans ce monde !...
Ainsi mon cher papa, puisqu’il paraît que tu dois décidément aller à Aimant et qu’il faut , pour faire un voyage aussi long, jouir d’une bonne santé, fais venir un de ces matins Tixier pour te pratiquer une bonne saignée.
Adieu mon cher papa et ma chère maman, je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de croire à l’affection bien vive, de votre fils.
Amédée Jeandet
Mon frère vous embrasse de tout son cœur…
P.S. Voici la note exacte de l’argent que j’ai pris jusqu’à ce jour chez M. Bernard Derosne.
Le 11 novembre 200 francs
Le 25 décembre 100francs
Le 15 mars 200 francs sur lesquels j’ai payé les deux flacons de sulfate de quinine.
***
Paris le 30 avril 1847.
(fermée et mise à la poste le 1°mai).
Ta lettre est arrivée bien à temps, ma bonne mère, car nous aussi nous commencions à être inquiets ; et en effet, soit à cause de ce que tu nous avais dit du voyage d’Aiment dans tes précédentes lettres , soit aussi à cause de la visite extraordinaire que M. Bernard Derosne avait daigné nous faire, le 21 de ce mois, pour nous annoncer que Madame Gérard profitait du départ de notre père pour venir à Paris, nous nous étions bonnement imaginés que mon papa allait partir de Verdun le 23 ou le 24 au plus tard, et qu’une lettre de lui, datée soit d’Aiment, soit de Verdun, nous annoncerait son arrivée. Voilà le seul motif, ma chère maman, qui nous empêchait de vous écrire, car grâce à dieu, nous nous portons bien, ou du moins nous allons aussi bien que l’on peut aller avec une machine aussi fragile et aussi prompte à se détraquer que l’est celle du corps humain : ainsi par exemple, mon frère éprouve de temps en temps des douleurs et des crampes insupportables du côté où il a tant souffert de la sciatique, et moi j’ai eu, pour ma part il y a quelques jours, une fièvre de cheval occasionnée par un coriza passé à l’état chronique, et de plus j’ai supporté, avec un courage dont je ne me croyais pas capable, l’extraction d’une de mes dents. Hélas oui, il a fallu me séparer de cette dents chérie qui, aussi bien que le moineau de Lesbie mériterait d’inspirer de poétiques regrets, mais je ne suis pas un Catulle ! en vérité je suis encore tout étonné des nombreux mariages qui se mitonnent dans notre ville ; quoi ! cette petite demoiselle Boyer si rondelette, si piquante, se voit délaissée par ce rustre de Boivin ? est-il possible que Cessot aîné soit assez heureux pour devenir l’époux de la jolie et pudibonde demoiselle Clément ! il faut convenir que les destinées de chacun de nous ici bas, sont bien bizarres, bien extraordinaires ! en vérité je serai porté à croire comme jacques-le-fataliste, qu’une volonté éternelle, immuable, a décidé de notre sort, quand je vois une jeune et jolie fille, qui figurerait si bien dans un salon, devenir la femme d’un marinier dont le seul mérite est un physique passable.
Il paraît que Mlle Bernard-Fresne devient aussi un morceau friand ; trois fois demandée et trois fois refusée dans un mois peste ! quelle ardeur ! pour peu que cela continue les prétendants étrangers finiront par dépouiller notre cité verdunoise de toute sa jeunesse féminine et ils ne nous laisseront plus rien, à nous les enfants du pays. Maintenant que j’y songe sérieusement, je suis vraiment fâché de ne pas avoir mieux utilisé les soirées d’hiver où j’avais l’occasion de voir fréquemment la demoiselle en question et où, soit dit sans vanité, si j’en juge par les quelques conversations que j’ai eu avec elle, il m’aurait été facile de supplanter plus d’un galant. Que ne me parles-tu, ma chère maman et de la pharmacie de M. Bernard et des regrets que tu éprouvas de ce que mon âge m’empêche de prétendre à l’achat de cette maison ! je confesse ici, que je suis sensiblement touché de l’intérêt que me porte cette bonne demoiselle Pelletier, mais malgré tout le respect que mérite son âge, je ne puis néanmoins m’empêcher de taxer de folie, pour ne pas dire plus, le projet vraiment singulier qu’elle a en tête. Qu’elle connaît peu son fils la pauvre demoiselle ! M. Bernard ne songe peut être plus à vendre sa pharmacie, il songe encore moins à me la remettre, et moi, dont l’ambition l’ ambition est bornée et qui ai des vues ailleurs, je ne songe pas le moins du monde à lui acheter. Je terminerai cette lette, ma très chère mère, en te disant que je n’ai pas seulement besoin de quelques petites choses, mais de grandes choses, au reste, comme il serait trop long d’énumérer ici ce dont j’aurais besoin, je te rappellerai seulement que tu devais me faire faire un pantalon d’été pour mettre ordinairement et que par conséquent tu pourrais me l’envoyer par cette dame inconnue, et y joindre une ou deux cravates d’été, dont une commune et l’autre un peu plus soignée. Tu me ferais également bien plaisir, si tu m’envoyais une paire de gants blanc en fil d’ écosse. Je ne dois plus rien à D ???, je suis allé ces jours passés lui payer la somme de 31,50 francs ; c’est le fruit de mes économies de chaque mois. Incessamment j’irai lui commander une redingote noir, car vous savez que je n’ai que mon habit à mettre, et le règne des paletots va bientôt finir.
Adieu ma chère maman et mon cher papa, je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de croire à l’affection bien vive, bien sincère, de votre fils
Amédée Jeandet
P.S. N’ayez pas d’inquiétudes sur mon examen ; vous savez que je m’occupe de mon affaire et que je me présenterai cette année plutôt deux fois qu’une. Mais comme je vous l’ai déjà dit , je ne considère plus maintenant ma réception que comme ajournée à une époque plus ou moins reculée : ce n’est plus qu’une quetion de temps.
Mes compliments à nos parents et connaissances. Adieu encore une fois, je vous embrasse bien tendrement A. Jeandet
Mes rapports avec M. Bernard étaient devenus de plus en plus rares, depuis qu’une violente querelle s ’était élevée entre son fils aîné et moi. Plus tard je vous raconterai cette petite historiette qui, j’aime à le dire, m’honore autant qu’elle avilit mon adversaire. Du reste pas un mot de cela à la mère Pelletier.
***
Paris le 5 mai 1847
Monsieur,
Lorsque je quittai votre maison, il y aura bientôt trois ans, vous eûtes la bonté de me promettre votre protection et votre appui, s’il m’arrivait d’en avoir besoin ; C’est donc sur la foi de cette promesse que j’ose m’adresser à vous, et viens réclamer de votre obligeance un service, qu’il vous sera, je l’espère facile de me rendre. Ayant appris que quelques élèves en pharmacie, qui étaient dans une position à peu près analogue à la mienne relativement au baccalauréat, avaient obtenus, du ministère de l’instruction publique, la dispense du grade de bachelier, j’ai formé le projet bien insensé il est vrai, d’adresser une pétition au ministre dans le but de me soustraire, s’il était possible, à cette fastidieuse épreuve. Mais comme cette pétition ne pourrait avoir de la valeur qu’autant qu’elle serait appuyée par un certificat de vous, qui constaterait comme quoi je suis entré dans votre maison, en qualité d’élève, le 1° janvier 1840 et que je n’en suis sorti qu’en janvier 1846, j’ai recours à vous , dans cette conjoncture comme étant la seule personne qui puissiez m’être utile et viens vous prier de me rendre cet important service.
J’espère, Monsieur, que la bienveillance que vous m’avez toujours témoignée ne me fera pas défaut dans cette circonstance.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de la considération distinguée de votre très humble et très obéissant serviteur et élève.
Amédée Jeandet
***
Ma chère maman,
C’est hier, 16 courant, que nous avons reçu le petit paquet annoncé dans ta dernière lettre. Ayant passé, contre notre ordinaire, toute la journée d’hier hors de chez nous, ce n’est que le soir, lorsque que nous rentrions qu’on nous apprit qu’un facteur des messageries avait apporté un paquet à notre adresse. Quoique l’heure fut déjà avancée, je me hâtai de l’ouvrir (attendre jusqu’au lendemain eut été une véritable torture) ; D’abord nous fîmes une inspection rapide des objets renfermés dans le ballot, tant pour satisfaire notre curiosité, que pour nous assurer si tout était arrivé en bon état, ensuite nous cherchâmes s’il n’y avait pas soit une lettre, soit un billet, soit même quelques lignes écrites de ta main, mais ce fut inutilement ; pantalons, cravates, chaussettes, gants, massepains en marmelade, rien n’échappe à notre minutieuse investigation, mais tous nos efforts devaient être inutiles, puisque contrairement à ton habitude tu nous faisais un envoi sans y joindre une petite lettre.
Maintenant, ma chère maman, il te tarde, sans doute, de savoir si le choix que tu as fait, est de mon goût ? Tu crains peut être de t’être trompée ? Oh non ! rassures-toi car ce qui te plait me plait aussi ; et c’est là du reste un bien faible mérite, surtout pour ce dont il s’agit.
En effet le pantalon que tu m’envoies est d’un genre distingué ; sa couleur est très convenable et son dessin est à l’ordre du jour. Je ne parle pas de la façon, tout ce qui sort de chez Prin, porte un cachet de perfectibilité rare, seulement cet estimable artiste aurait très bien pu se dispenser de pratiquer deux espèces de languette au bas des jambes, car ça ne se porte plus. Les cravates sont aussi très gentilles, mais , ma chère maman, tu as été moins heureuse pour les gants, tant il est vrai qu’il faut toujours qu’il y ait quelque chose qui cloche : les doigts sont deux fois trop longs et par conséquent il m’est impossible de las garder ; aussi je compte te les faire tenir par un de mes compatriote et ami M. Trémeau jeune architecte qui doit partir d’ici à quelques jours . L’épithète injurieuse dont je me suis servi plus haut à propos des massepains, exige quelques explications : ils ne sont pas arrivés en marmelade , mais comme toujours, passablement brisés et rompus, en outre, par suite de la chaleur et de la pression, ils ont acquis une dureté assez analogue à celle du biscuit de mer. Mais qu’ils soient durs comme pierre ou réduits en poudre impalpable, que nous importe à nous ! ils viennent de notre ville natale, ils nous sont envoyés par la meilleure des mères et à ce titre ils ont un prix inappréciable.
Mais l’heure de la poste me presse, et ici doit se terminer cette lettre, peut être déjà trop longue. Adieu ma chère maman et mon cher papa, je vous embrasse tous les deux bien tendrement et de tout mon cœur, voter fils
Amédée Jeandet
Mon frère vous embrasse de tout son cœur.
P.S. Nous sommes extrêmement fâchés que mon papa ne soit plus décidé à faire le voyage d’Aiment, même dans le cas ou notre tante François lui écrirait ( ce qu’elle ne fera sans doute pas), car outre la joie et le bonheur que nous causerait sa présence ici, ce voyage ne pourrait que lui être très avantageux pour sa santé. Songe-t-il à se faire saigner ?
Je vous embrasse encore une fois bien tendrement
Amédée Jeandet de Verdun
Paris le 17 mai 1847.
***
Monsieur,
Sans doute vous croyez que l’élève a oublié le maître et que depuis qu’il est au sein de la grande ville, le souvenir de ces leçons musicales si souvent assaisonnées de petites chroniques amusantes et d’historiettes verdunoises s’est effacé de sa mémoire : non, mon cher monsieur Delacroix, il n’en est rien, et si je n’ai pas répondu plutôt à votre aimable lettre du mois de mars dernier, c’est que mes nombreuses occupations m’en ont constamment empêché.
Du reste vous me croirez d’autant plus aisément, lorsque je vous dirai que le même motif m’a fait négligé presque totalement ma musique, de telle sorte que je suis loin d’avoir fait quelques progrès comme vous paraissiez le croire. En effet, depuis mon départ de Verdun, ma pauvre clarinette n’a été tirée, que bien rarement, du tiroir où je la tiens enfermée, et ce n’est que depuis la venue du printemps avec les longs et beaux jours que je commence à jouer quelques morceaux. Mais voici les vacances qui approchent et j’espère réparer le temps perdu ; Seulement il me faudrait de la musique, et c’est précisément ce qui me manque. Je viens donc, Monsieur, vous prier, par cette lettre, de vouloir bien me disposer, dans vos moments de loisirs, un cahier de musique, renfermant outre vos propres productions, des valses, des quadrilles, des thèmes , des morceaux détachés etc, etc ; en un mot vous me feriez un recueil très varié dans sa composition, un espèce d’album musical, et le tout serait arrangé pour la clarinette et mis en des tons convenables. Ne craigniez pas d’y joindre des morceaux langoureux et quelques vieilles valses, la reine de Prusse par exemple, avec d’autres de la même famille.
J’aime à croire que rien ne s’opposera à ce que vous me rendiez ce petit service et, qu’aux vacances prochaines, j’aurai le plaisir de vous remercier de vive voix. Il va sans dire que je vous achèterai votre recueil, attendu que vous êtes musicien, que vous aurez la main à l’œuvre, et que tout travail exige salaire.
Il serait trop long de vous dire pourquoi je m’adresse de préférence à un Monsieur de Verdun, lorsque je suis entouré ici d’éditeurs et de marchands de musique, aussi vous conterai-je cela une autre fois. En attendant veuillez agréer l’assurance de la parfaite considération de votre tout dévoué serviteur et compatriote.
Amédée Jeandet
Sur la dernière page, Amédée à ajouter : lettre écrite à M. Delacroix le 22 mai 1847
***
Mon cher papa et ma chère maman,
Je conçois votre étonnement touchant le silence que je semble garder sur mon examen, et j’en suis d’autant moins surpris que, par mon exactitude et la franchise avec laquelle je vous ai toujours entretenu de tout ce qui me concernait, vous étiez autorisés à croire qu’il ne devait jamais en être autrement. Mais je ne pense pas non plus m’ être écarté de beaucoup de mon exactitude habituelle, et si vous relisez mes lettres, vous verrez que je suis à peine répréhensible, puisque dès le mois d’avril, je vous avais donné clairement à entendre que ce ne serait guère que vers la fin de mai que je comptais faire ce que vous savez bien : (je m’abstiens de prononcer un nom qui, à force d’occuper ma pensée, finit par me devenir, je ne dirai pas odieux, mais au moins insupportable). Eh bien ! j’ai en effet tenu parole et pour cette fois encore, il me faut renoncer à ce précieux parchemin, dont la possession, sans cesse différée, refroidit, de jour en jour, la joie d’enfant, le bonheur ineffable que j’espérais goûter en le partageant avec vous.
C’est qu’en effet il ne peut en être autrement, car lorsque nous atteindrons le but, depuis si longtemps désiré, ce ne sera plus pour nous qu’une chose bien simple, bien naturelle, notre esprit ayant tout le temps de s’y préparer. J’ose espérer que cette nouvelle ne vous causera qu’un léger déplaisir et que , pas plus que moi, vous ne désespérerez de l’avenir. Si il y a six mois pareille chose m’était arrivée. J’aurai probablement tenu un tout autre langage, mais les temps sont changés, ou du moins je veux croire qu’ils le sont, et en dépit du sort, je veux me bercer des plus douces illusions ; je veux rêver le bonheur, la fortune, je veux croire enfin. C’est que voyez-vous, mes biens aimés parents, j’ai le sentiment de ma faiblesse morale et si je ne fais pas tous mes efforts pour lui résister, je dois craindre les plus graves accidents.
Du reste le fait qui nous occupe en ce moment n’a pas en lui même une bien grande gravité, car en définitive l’échec, que je viens d’essuyer, ne recule pas plus le terme de mes études, que ma réception ne l’eut avancé. C’est donc une affaire terminée et à la session de novembre nous en serons quitte pour recommencer. Il n’est pas nécessaire, comme j’ai déjà eu occasion de vous le dire, de faire une nouvelle tentative au mois d’août, ce serait multiplier inutilement le nombre de mes défaites et augmenter le chiffre, déjà trop élevé, des sommes d’argent que nous avons sacrifiées jusqu’à ce jour. Je me repend beaucoup de m’être présenté les deux premières fois, car à proprement parler, ce n’est que cette dernière fois seulement que je me suis montré vraiment candidat et que j’ai été renvoyé à cause de l’imperfection d’un travail qui était mien et non à autrui. Lorsque je serai près de vous ( je compte déjà les jours) je vous entretiendrai de toutes ces choses : quand à présent je ne veux m’occuper que de vous, mes bons parents, de vous seuls, qui nous causez tant d’inquiétudes par le mauvais état de vos santés. D’abord, ma chère maman, je te prierai de ne pas tant te presser de sortir de chez toi ; il faut que tu restes tard au lit et que tu n’en sortes que pour te mettre dans ton fauteuil ; si, comme tu nous l’annonces, tu vas beaucoup mieux, alors je ne t’interdirai pas la promenade, mais tu la feras courte, mieux vaut la répéter plus souvent, que de t’exposer, par la fatigue, à réveiller ton mal. Quant à mon papa, si on vient le chercher, au milieu de la journée, pour aller en campagne, il faut qu’il refuse ; nous ne voulons pas, mon frère et moi, qu’il abrège ses jours pour gagner une pièce de six francs. De ^plus, nous attendons d’ici à huit jours, une lettre qui nous annoncera qu’il s’est fait soigner, car s’il ne veut pas s’y résoudre, nous partons pour Verdun ! En vérité il est bien étrange de voir deux enfants prier, supplier leur père de vouloir bien conserver sa vie ! Mais cette fois nous ne te prierons pas en vain, mon cher papa, tu vas te rendre à nos vœux, car si tu persistais plus longtemps, ce serait nous faire douter de ton affection pour nous.
Adieu mon cher papa et ma chère maman, je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de croire à l’affection bien vive de votre fils
Amédée Jeandet
Paris le 31 mai 1847
T.S.V.
P.S. M. Boulet a publié un livre intitulé « une année de versions graduées pour les aspirants » cet ouvrage, qui renferme 300 versions, me paraît être assez bon et je me propose de l’acheter pour l’étudier à fond pendant les vacances. Quant à présent, je travaille à la rédaction de mon cours de chimie ce qui n’est pas peu de chose à faire, de plus, je suis les cours d’été de l’école de pharmacie, et le temps qui me reste je le consacre à mes études classique et littéraires. Georges Léger est arrivé à Paris vendredi soir ; il n’a pas osé se faire conduire à notre hôtel, mais dès le lendemain, il est venu nous trouver et comme il ne savait pas où donner de la tête, hier dimanche, il a pris un logement dans notre maison s’estimant fort heureux d’être en pays de connaissance.
Adieu encore une fois mes très chers parents A.J.
Mon frère vous embrasse de tout son cœur.
***
La lettre qui suit n’est pas datée, mais le cachet de la poste est du 4 juin 1847. Elle est adressée à Abel Jeandet à Paris par son père François Philoclès Jeandet. Mais dès la première phrase on comprend qu’i s’adresse à Amédée.
Les événements prévus, mon cher Amédée, ont un côté avantageux qui fait qu’ils ne vous surprennent ni ne vous étonne lorsqu’ils arrivent. C’est l’effet qu’a produit sur nous la nouvelle que tu nous viens d’annoncer. Nous nous en sommes consolés surtout en voyant de quelle manière tu envisages cette affaire, laquelle n’est, après tout, comme tu le dis si philosophiquement, qu’une question de temps… et d’argent… foin de ces pédants en us et en os à qui tu pourrais déjà enseigner bien des choses échange de leur misérable pancarte dont l’obtention n’est rien moins qu’une preuve de capacité…
Nous ferons derechef du latin aux vacances prochaines. Tu achèteras à cet effet le recueil de versions de M. Boulet, le quintilien- Nizard qui a paru, et autres ouvrages relatifs au baccalauréat dont tu croirais avoir besoin.
Tu ne nous dit pas si tu as pris de l’argent chez M. Bernard. A cette occasion je te ferai observer que notre compte s’embrouille étrangement et que je ne sais plus si tu règles ta dépense d’après les bases que nous avions fixées ici, savoir 80 francs par moi ou 240 francs par trimestre, à l’exception des faux frais qui en sont en dehors et restent à ma charge. C’est un règlement à opérer dont nous nous occuperons plus tard.
La fin de la lettre, les formules de politesse sont en latin et je n’arrive pas pour l’instant à les copier
Jeandet
P.S. ta dernière lettre a coûté 18 sous 90 cents cela tient à la grosseur du papier et à l’ampleur de l’enveloppe, deux choses auxquelles tu feras attention dorénavant pour éviter ce surcoût de taxe.
***
La lettre qui suit est écrite de Paris par Abel JEANDET à son frère Amédée à Verdun sur le Doubs.
Ce dimanche 27 juillet 1847
Mon cher frère,
J’étais d’autant plus peiné de ne t’avoir pas répondu depuis quatre jours, au moins, comme je le voulais et le devais que j’ai craint, tout à l’heure, pendant quelques instants qui m’ont semblé bien longs, je t’assure , qu’il me serait impossible de sortir de mon lit pour t’écrire, ainsi qu’à nos chers parents. Pourtant après des efforts douloureux je suis parvenu à me mettre sur mon séant, puis sur mes jambes où je représente assez bien, au côté plaisant près, tantôt le père Cassandre, tantôt la raideur de Gilles dans la scène d’Arlequin. Tu vois, mon cher Amédée que ce sont encore mes nerfs sacrés sciatiques et Cie qui me tourmentent. Du reste ça ne va pas plus mal aujourd’hui, et j’en suis quitte de comp… tous mes mouvements sous peine de douleur aigues. Croiras-tu que c’est la seconde indisposition que j’ai éprouvée depuis ton départ ? La première s’est fait sentir le jour même de notre séparation. J’ai été obligé de me mettre au lit, la tête lourde et brûlante, le corps brisé, comme à l’approche de quelque grave maladie. Il ne me restait plus que la force de sourire de pitié sur notre pauvre machine humaine en songeant que je serai peut être fort malade dans le moment où tu annoncerais que j’étais bien portant. Mais le lendemain il n’y paraissait plus. Qui m’avait abattu ? je le sais, mais qui m’a relevé ? je n’entrevoyais pas comme toi, mon cher frère, une terre promise, terme assuré de ma souffrance que les caresses d’une mère et d’un père chéris devaient bientôt transformer en joie ineffable , pour moi je n’avais que l’appréhension d’autres tourments.
Mon silence a du te faire pressentir que l’événement n’avait fait que transformer mes craintes en une triste réalité… Du moins deux considérations importantes doivent compenser un peu ce retour de fortune. La première c’est qu’il a pour cause plutôt l’esprit et la forme sous lesquels j’ai discuté certaines questions que mon ignorance ??? sur ces mêmes questions, la seconde c’est que la clôture des épreuves pour cette année ne me permettait pas d’en subir de nouvelles. Cet échec n’a pas pour moi de suite aussi fâcheuse que si j’étais, par exemple, dans une position plus avantageuse pour une autre épreuve, à quelque chose malheur est donc bon ? et il n’y a donc rien d’absolument heureux ni d’absolument malheureux ? C’est surtout pour nos chers parents que je te donne ces explications afin d’atténuer un peu le chagrin que ce nouveau contre temps va leur causer.
Je me repose sur ton affection pour eux et pour moi du soin de leur faire supporter cette mauvaise nouvelle. Cela me contrarie beaucoup plus sur le point moral qu’en raison du mal réel que j’en éprouve lequel n’est pas grand, comme je te le disais en raison de ma position présente. Mais d’un autre côté cela n’influera-t-il pas sur la possibilité de mon voyage à Verdun ? Nos parents n’avaient pas raisonné d’après cette hypothèse ? J’attendais une lettre avec beaucoup d’impatience. Je suis obligé de terminer celle ci dans laquelle j’ai supplée par la finesse de l’écriture à la petitesse du format, en t’embrassant de tout mon cœur et en te priant d’embrasser de même pour moi notre cher père et notre chère mère.
Ton frère et ami
Abel Jeandet
P.S. je n’ai pas le temps de relire ma lettre M. Mathey vient de venir me voir.
***
Paris 9 Août 1847 (au soir)
Dans le doute, le sage s’abstient ; entre deux maux, dit le proverbe, il faut choisir le moindre ; et je dis que libre d’opter entre deux jugements, dont l’un condamne et l’autre absout, il n’y a pas à hésiter… quelque soient du reste les apparences toujours si trompeuses. Ceci posé en réponse à certaine partie de la toute petite lettre que tu m’as écrite le 24 du mois dernier, je te retournerai, mon cher frère, la première phrase de ta susdite lettre. « est-ce ainsi que tiens les promesses que tu m’avais faites lors de notre séparation ? » en effet je suis bien autorisé , moi aussi, à t’adresser ce petit reproche à la vue des deux belles et grandes pages vides qui restaient encore, dans la dernière lettre de notre chère mère . Pourquoi n’y as tu pas tracé quelques lignes ? Je présume que le temps t’aura manqué et que tu croyais peut être, également, que je n’étais plus ici. D’un autre côté le peu de temps pendant lequel nous devons être séparés justifie ton silence. Ce motif ne m’empêche pourtant pas de profiter du départ de M. MATTEY pour t’écrire ces quelques lignes que je placerai, sans faire un paquet, dans le premier venu d’un de tes livres ; j’y joindrai deux brochures que tu mettras de côté parce que je pourrais, peut être, en avoir besoin pour y prendre quelques notes sur la géognosie de notre département.
Il faut que je t’apprenne quelque chose relativement à ton certificat d’études. N’en déplaise à notre chère qui me fait l’amitié de m’écrire qu’elle craint que je ne fasse pas mieux tes propres affaires que les miennes, j’tais déjà allé, quoique important, trois fois à l’école de pharmacie lorsque sa lettre est venue m’admonester à ce sujet. J’au du passer pour un élève bien assidu, et bien au fait des us et coutumes de <mon école, quand pour justifier mon insistance a demandé mon certificat, j’alléguai la fermeture de l’école au juille31t. Le secrétaire me répondit que l’école ne serait fermée qu’à la fin d’août et qu’on ne délivrerait les certificats qu’après le 1° septembre. Pour t’épargner la peur que pourrait te causer cette nouvelle, je me hâte de te dire que le secrétariat m’a assuré que l’on pourrait tout aussi bien obtenir le certificat en question à la rentrée, qu’à la fin de l’année scolaire, ce que je crois d’autant plus volontiers que c’est là une affaire de forme et que l’on est pas trop intraitable dans votre école.
J’avais l’intention de remplir mes trois pages, mais je suis très fatigué, et Hyppolite Adrien qui vient de me faire visite ne me laisse plus le temps nécessaire pour cela. Il faut cependant que tu saches, ce qui ne te surprendras pas, que ton très haut, très puissant, et ex patron ne m’a pas donné signe de vie depuis son retour que je n’ai appris que par M. Adrien et Thirot que j’ai rencontré. Après avoir un peu hésité je me suis décidé à ne pas allé le voir. Je me propose pourtant d’aller demander à Mme Girard si elle a des commissions. Si je puis toucher les 56 francs pour t’entretenir de Melle Lannoy je le ferai. Je ne t’entretiendrai pas plus longtemps des faits et gestes extra-aristocratique de milord de Rosne, cela est trop connu à nous.
Si je ne te précise pas le moment de mon départ et celui de mon arrivée c’est afin d’éviter toute cause d’inquiétude qui pourrait résulter d’un de ces milliers d’empêchement imprévus qui ne nous atteignent parfois jamais mais qui nous menacent sans cesse.
Au revoir donc mon cher frère, je t’embrasse de tout mon cœur, embrasse pour moi notre chère mère, je crois inutile de te charger de cette douce commission pour notre cher père car je pense qu’il ne sera plus à Verdun quand ce brouillon y arrivera.
Ton frère et meilleur ami
Abel JEANDET
***
Paris le 11 novembre 1847.
Mes chers parents,
Après un long et pénible voyage de plus de quarante heures, nous sommes enfin arrivés hier 10 courant à quatre heures du soir par le bateau à vapeur. Il était temps que nous arrivassions, je vous assure, car nous étions tous les deux accablés de fatigue et nous avions grand besoin de repos, mais hélas ! quel repos pouvions nous goûter loin de vous, dans des lits durs comme la pierre et au milieu d’un bruit et d’un vacarme inaccoutumé. J’ai été comme je m’y attendais, excessivement malade ; à peine étions nous en voiture que je commençai à éprouver un malaise général, et nous n’étions pas encore éloignés des dernières maisons de Chalon, que les vomissements me prirent pour ne plus me quitter de toute la nuit. Combien elle m’a semblée longue cette nuit cruelle et que les heures se sont écoulées lentement à mon gré. Plusieurs fois, au milieu des tourments que j’endurais, il me prit envie de me faire descendre de voiture et de me coucher sur les cailloux du chemin, car là au moins j’étais sûr de voir cesser mes souffrances, mais aussitôt mon courage reprenait le dessus et je me résignais à mon sort.
Heureusement que tout finit dans cette vie, les peines comme les plaisirs, et que, d’ici à quelques jours, je me souviendrai à peine de tout ce que j’ai souffert durant ce maudit voyage. Quand à Abel il n’a nullement été incommodé, et à part la fatigue, il s’est très bien trouvé.
L’heure de la poste me presse et il faut fermer ma lettre ; dans la prochaine, je vous donnerai, sur ma situation ici , tous les détails qui pourraient vous intéresser.
Adieu mes biens aimés parents, je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de croire à l’affection inaltérable de votre fils.
Amédée Jeandet
Mon frère se joint à moi et il vous embrasse de tout son cœur.
P.S. Nous attendons une lettre de maman le samedi 20 novembre. Le père Naudin a fait route avec nous ; à l’heure qu’il est ce pauvre homme nous cause de l’inquiétude, car il est bien exposé ici vu sa grande simplicité.
***
Verdun le 18 novembre 1847.
Mes chers enfants,
Combien me paraît éloignée, notre séparation, il n’y a que dix jours aujourd’hui que nous nous sommes quittés, eh bien il me semble à moi qu’il y a plusieurs années, le temps dès que je ne vous vois plus mes chers enfants est si long a s’écoulé que les jours me paraissent des mois. Nous ne sommes pas heureux mon cher Amédée dans les moyens que nous employons pour t’éviter les souffrances que tu éprouve en voyage, malgré les pilules de ????, sur l’estomac tes douleurs se sont faites sentir plus tôt que de coutume, c’est la foi mon cher ami qui t’a manqué, car si tu ???? tu n’aurait pas été malade , tu connais le dicton , c’est la foi qui nous sauve, c’est ainsi que l’on interprète les choses quand elles ne réussissent pas. Votre père , mes chers enfants, se porte assez bien, il est aussi fou qu’il était avant la saignée, il n’a rien à faire dans ce moment, c’est ce qui le contrarie beaucoup, moi je n’en suis pas fâchée puisque la marche lui est contraire, rien que d’être aller mardi à Ciel jour de la noce Il a pissé du sang, à quoi attribuer cet accident, il n’en sait rien, depuis cinq mois environ il s’en est aperçu. Parlons un peu de la noce, il est onze heure, j’entends le tambour qui bat, je pense que l’on va porter le courrier pour aider ton oncle à manger ses ??? Je vous dirai que le matin il a plu un peu, il y avait des brouillards très épais, le temps s’est remis mais la boue est restée, toutes les femmes sont allées en voiture. Votre tante est tombée malade l ’avant veille du mariage de son fils, le lundi j’y suis allé depuis le matin, Madame Jeandet avait passé une bien mauvaise nuit, elle avait une grande fièvre, mal à la gorge et toussait beaucoup. Elle n’a pu se tenir levée, elle se trouvait mal, nous avions de l’inquiétude, son fils ne l’a f
Jamais tant embrassé. Il était toujours près de son lit la main appuyée sur le front de sa mère, jamais on ne l’avait vu si affecté. Le mardi matin la fièvre était peu de chose, elle a pu tenir assise. Elle voulait assister au mariage de son fils. Cette pauvre mère elle se sacrifie pour leurs enfants. Monsieur le curé de Ciel a fait allumé le poêle dans la sacristie et là nous avons attendu la messe, car je suis restée près de ma belle sœur. En résumé tout s’est bien passé, je ne puis m’étendre longuement sur tout ce qui est arrivé parce que je vous ai dis que ma lettre partait aujourd’hui. C’est surtout votre père qui y tient beaucoup en partant pour les bordes, il m’a recommandé de ne vous écrire que quelques lignes afin que vous puissiez recevoir cette lettre samedi. C’est Monsieur Coutaveau qui a été garçon d’honneur, il aurait pas mal rempli sa mission s’il put aller moins souvent dans les cafés et cabarets. Nous étions 82 personnes à table, le repas a été très beau. Le mercredi soir grand bal, il a été très joli. J’ai dansé une valse avec mon beau frère, votre père s’était couché. Je suis rentré à minuit avec les dames Desnuel.
Le froid commence aujourd’hui, nous n’avons parlé que de vous en déjeunant. Le froid empêche de travailler, achetez du bois et chauffez vous bien. Vous me direz si mardi vous avez fait un bon dîner, nous vous l’avion recommandé, dites nous comme vous êtes arrangés, si vous avez une chambre à deux lits ou si vous êtes chacun dans la votre, et depuis quand vous avez repris vos études, et si mon cher Abel est entièrement remis de ses fatigues.
Adieu mes chers enfants, je vous embrasse de tout mon cœur ainsi que votre père
Annette Jeandet née Chapuis
***
Paris le 24 novembre 1847.
Mon cher père,
Fidèle à la promesse que je t’ai faite avant notre séparation relativement à mes études, je t’envoie cette lettre pour te donner quelques détails sur mes travaux scientifiques et sur ma situation présente. Dès le lendemain de mon arrivée, soit à cause des fatigues du voyage, soit à cause de tout autre motif à moi inconnu, mes hémorroïdes sont survenues et pour la première fois elles m’ont fait véritablement souffrir pendant plusieurs jours comme un malheureux. De plus, j’avais une constipation des mieux conditionnées et malgré la calomel que j’ai pris la semaine dernière, encore maintenant je ne vais à la selle que très difficilement. Avec de semblables infirmités, il ne me devait pas m’être facile de vaquer à mes affaires ; aussi n’est-ce que le 13 que je me suis traîné à l’école pour prendre mon inscription. Maintenant sans être précisément guéri, je vais néanmoins beaucoup mieux et depuis le j’ai repris le cours de mes occupations, quoique marchant encore comme les deux pots de la fable. Mais venons en au but principal de cette lettre, et voyons un peu quel est l’emploi de mon temps : se suis 4 cours à l’école de pharmacie, savoir le cours de physique, de pharmacie, de matière médicale ou histoire des drogues simples et de zoologie ; chaque a lieu deux fois par semaine. Le cours de matière médicale ne commence que le 1° décembre, Monsieur Guibourt ayant été appelé aux assises comme juré. Si tu ajoutes à cette liste , le cours de chimie de M. Orfila qui, cette année, a lieu quatre fois par semaine, tu auras, mon cher papa, une idée exacte de l’emploi de mon temps. Ce n’est pas tout, il me reste encore à te faire part d’une nouvelle qui m’intéresse fort, et qui, dans le premier moment, ne m’a été rien moins qu’agréable : il s’agit d’un arrêté du ministre, en date du 15
septembre dernier, qui oblige les étudiants en pharmacie à passer deux examens préparatoires ; le premier à la fin de mars et le second à la fin de juillet. Ces examens rouleront sur les matières enseignées dans chaque semestre, et les élèves qui échouerons à ces épreuves ne pourront prétendre à leurs certificats d’études qu’après une nouvelle présentation ajournée à trois mois. A la lecture d’un semblable arrêté, ma surprise, comme tu le penses bien, fut extrême et j’envoyai, de grand cœur le ministre à tous les diables, mais je ne tardai pas à me calmer et à considérer, en définitive, cette mesure comme très bonne et fort utile. Après tout, me suis-je dit, ce n’est point là un examen de bachelier, et avec un travail suivi et aidé d’une bonne mémoire, il ne faut pas désespérer du succès.
Seulement, mon cher papa, par suite de cette nouvelle mesure, je me vois dans l’obligation d’acheter de suite l’ouvrage de M. Favrot, dont je t’ai déjà parlé, et qui me devient maintenant presque indispensable. Cet ouvrage se compose de 4 volumes : les deux premiers contiennent la physique la chimie la toxicologie et la pharmacie avec 200 figures explicatives , les deux derniers renferment la botanique, la zoologie, la minéralogie et la matière médicale avec 500 figures explicatives intercalées dans le texte. Tu peux juger, par là, de la bonté de cet ouvrage qui, quelque soit d’ailleurs l’élévation de son prix, nous reviendra toujours à bien meilleur compte que si nous l’achetions séparément chacune des matières qu’il renferme, comme cela se pratique ordinairement. Deux mots sur notre gîte avant de terminer, nous sommes logés selon nos souhaits , nos deux chambres se touchent, elles sont assez propres et surtout un prix raisonnable. Nous nous chauffons au même feu, lequel par parenthèse n’a encore été allumé que le soir.
Galland habite notre hôtel , sa chambre est située précisément au dessous de la mienne : C’est un jeune homme laborieux et d’un commerce agréable. Nous avons vu notre tante Chapuis, elle est venue à Paris pour négocier le mariage de sa fille Anna avec un certain Monsieur affligé de quarante cinq printemps et n’ayant pour toute fortune qu’une place de mille écus au ministère des finances ; Mais les tantes de Tours désirent ce mariage, elles dotent leur nièce à qui elles donneront probablement leur fortune et voila ce que c’est. Nous avons eu le plaisir de voir M. Léchelle qui est et sera toujours un excellent homme bien reconnaissant de tout ce que vous avez fait pour lui.
Adieu très chers et bien aimés parents, recevez les embrassements bien tendre , bien affectueux d’un fils qui vous aime de toute la force de son âme et ne souhaite qu’une chose… votre bonheur !
Amédée Jeandet
P.S. Faites, je vous prie, mes compliments chez mon oncle Pierre et chez ma tante Adrien. Dans la prochaine lettre, mon papa ne m’enverra-t-il pas quelques lignes écrites de sa main pour me dire ce qu’il pense du contenu de cette épître ?
Lundi dernier 22 courant, j’ai pris les 200 francs chez M. Bernard
***
La lettre qui suit est une lettre d’un oncle Chapuis à Amédée . Le papier est à en tête : Académie d’Amiens, Collège de Château-Thierry, Aisne.
Château-Thierry le 29 novembre 1847.
Je ne sais par quel hasard je t’écris, mon cher Amédée, car ayant des neveux qui pour moi sont de véritables mystères dont l’existence se perd dans la nuit des temps, c’est à peu près comme si je n’y avais pensé. Cependant ta tante vous ayant vu tous les deux à Paris, j’en conclu que vous appartenez encore à ce monde sub ou super humain. Je viens te faire une proposition que je crois à ton avantage, je sais que tu useras ton âme et son enveloppe matérielle dans des travaux pénibles qui ne permettent pas et ne peuvent pas permettre de grands résultats. Ma position actuelle me met à même de t’être doublement utile, sous le support de l’instruction à acquérir et de certaines recommandations qui peuvent faciliter un examen. Comme d’un autre côté Anna va se marier, la conséquence de ce fait est qu’elle n’habitera plus sous mon toit et que je n’aurai point à craindre de mettre en contact une jeune fille assez aimable avec un jeune homme qui n’est pas trop mal, de sorte que, si par hasard, il t’était agréable de venir habiter et travailler chez ton oncle, j’écrirai sur ce sujet à ta mère qui sans doute passerait aussi volontiers ta pension à Château-Thierry qu’à Paris.
Je n’ai pas besoin de te dire que tu ne pourrais être en aucune façon considéré comme élève , que tu aurais ta chambre et que je serais ton professeur.
Réfléchis à ma proposition : de même que toutes celles qui jusqu’à présent ont eu toi ou ton père pour objet, elle est tout à fait désintéressée ; ne te crois condamné ni à la refuser, ni à l’accepter, fais usage de ta liberté, sans crainte de me blesser en aucune manière et quand tu te seras déterminé, écris moi , alors, s’il y est besoin, je correspondrai avec ton père et ta mère.
Ta tante, Henri et moi, nous vous embrassons tous les deux, toi et Abel, et quelque soit d’ailleurs l’étrangeté de vos rapports avec votre oncle, ne doutez jamais de mon affection pour vous,
Chapuis
Votre tante a fait un bon voyage ; elle a été accompagnée par son futur gendre. Il y a à Château-Thierry un pharmacien, et même plusieurs chez lesquels il te serait facile de faire des préparations.
***
Pas de date sur la lettre qui suit mais on peut la dater du début décembre 1847 car Amédée répond très rapidement au courrier de son oncle.
Mon cher oncle,
Si j’avais des raisons ou des motifs plausibles à faire valoir, j’essaierais de m’excuser de mon long silence à votre égard, mais je n’en ai point, et pour dire la vérité toute crue, je vous confesse que sans la réception de votre lettre, probablement je ne vous aurais point encore écrit maintenant. Cependant, mon cher oncle, je puis vous certifier que depuis bien longtemps je me proposais de le faire et même lors de mon séjour à Verdun combien de fois ma bonne mère ne m’a-t-elle pas fait des reproches à ce sujet, mais je remettais toujours et en définitive à force de remettre, je me suis laissé prévenir par vous. Pardonnez-moi, je vous prie, ces quelques lignes de préambule, ainsi que ma rustique franchise, laquelle, j’en suis sûr, ne vous déplaira pas chez un neveu dont vous avez été jadis à même d’apprécier le caractère et les sentiments. Parlons à présent de votre lettre mon bon oncle. Avant de rompre le cachet et en reconnaissant votre écriture sur l’adresse, je vous avoue que j’ai été bien agréablement surpris et si lorsque j’en eu pris lecture, le plaisir que j’avais d’abord éprouvé se changea en de pénibles regrets lorsque je vis que je ne pouvais répondre à votre offre obligeante, néanmoins je ressentis une vive et véritable satisfaction de cette dernière marque de votre bienveillante sollicitude pour le fils de votre sœur, et soyez assuré que j’en conserverai toujours un bon souvenir. Non mon cher oncle, il ne m’est pas possible d’accepter votre proposition, et cela pour une raison bien simple et que vous allez comprendre ; Je suis lié avec l’école de pharmacie de Paris où j’ai pris à la rentrée, ma 2° inscription. Si l ‘année dernière il m’eut été facile de ne point aller à l’école, de quitter Paris par exemple et malgré cela d’obtenir à la fin de chaque semestre mon certificat d’études et de présence aux cours, cette année les choses se passeront tout différemment, attendu que le ministre de l’instruction publique, par un arrêté du 19 septembre dernier, oblige tous les élèves en pharmacie inscrits à l’école, à passer deux examens préparatoires, l’un à la fin de mars, l’autre à la fin de juillet. Ces examens rouleront sur les matières enseignées dans chaque semestre et les candidats renvoyés ne pourront prétendre à leur certificat d’étude qu’après une nouvelle épreuve, c’est à dire qu’ils seront retardés d’une année. Vous voyez par là qu’i n’y a pas moyen d’échapper et que le temps n’est plus où l’on se contentait de suivre les cours en amateur et seulement pour la forme. Aussi quand à présent, je m’occupe exclusivement de mes études pharmaceutiques, laissant de côté celles du baccalauréat sauf à les reprendre plus tard s’il y a urgence, mais j’espère ne pas en venir là, car si ne m’abuse, je crois, d’après les démarches que j’ai déjà faites, qu’il ne me sera pas impossible d’obtenir une dispense de baccalauréat. Si je me suis étendu aussi longuement sur ce sujet, c’est que je tenais, mon cher oncle, à bien vous éclairer sur l’état de la question afin d’éviter, par là de votre part, toute interprétation fausse qu’un refus motivé de cette nature sur des raisons banales et peu contraignantes, aurait pu entraîner avec lui. Avant de terminer cette épître déjà trop longue et pour laquelle j’ai besoin de toute votre indulgence, permettez moi, mon cher oncle, de vous faire des reproches sur le peu de confiance que vous avez en votre neveu et de vous dire que le motif, qui maintenant ne vous ferez plus redouter ma présence chez vous , fait précisément que je regrette moins de n’y point aller. Pensez-vous, en effet qu’à l’exemple des héros du ??, il m’eut été impossible de résister aux enchantements de cetter nouvelle ???
Adieu mon cher oncle et ma chère tante, je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de croire à la sincère affection de votre neveu. Mon frère se joint à moi.
Amédée Jeandet
Nous embrassons Henry qui sans doute n’a pas oublié ses deux cousins Abel et Amédée.
***
Aucuns prétendent, mon cher Amédée, que nous nous ressemblons beaucoup au moral, et les mauvaises langues ajoutent que ce n’est pas le côté où nous brillons le plus, quoiqu’à mon avis fondé sur une longue expérience, nous valions bien la majeure et la meilleure partie de nos congénères dans l’engeance humaine. Ce n’est tant pas cela que je regrette de trouver en toi, mais certaines dispositions physiques qui ont été et sont encore les miennes. La nature dont les actes sont loin d’être toujours intelligents a établi une sorte d’hérédité des pères aux enfants, laquelle fait que ceux ci apportent en naissant le germe de quelques infirmités qu’ont eues ceux-là. Cette habile harmonie dans la production du mal te rend aujourd’hui solidaire d’une indisposition cruelle, les hémorroïdes, dont j’ai été moi-même fort tourmenté, et qui m’avait été léguée déjà par mon père. Je gémis profondément de voir que ce sera là pour toi comme pour moi la part la plus liquide de ta succession, à défaut de cette autre compensation que je n’ai plus l’espoir de te laisser, il faut du moins que je t’enseigne comment on remédie à une affection que tu as reçue fatalement de moi et malgré moi, et dont j’ai éprouvé depuis longtemps l’infaillible efficacité. Les moyens consistent uniquement dans un régime adoucissant, dans l’abstinence de vin, des liqueurs alcooliques et de café surtout aiguisé avec celles-ci – experto crede roberto *– que parles-tu de Calomel pour combattre la constipation à l’heure où tu es à la ?? où se trouve le citrate de magnésie de M. Rogé, rue vivienne n° 12 ? à nous , habitants déshérités de la produire ces drogues nauséabondes et empoisonneuses, tandis qu’à vous seuls enfants gâtés de la capitale, les arts et les sciences prodiguent tout ce qui peut flatter, émouvoir, séduire les sens, ?????
Je me réjouis , mon cher ami, de la mesure ministérielle qui va obliger les élèves en pharmacie comme ceux de la faculté de médecine, à passer des examens préparatoires avant d’obtenir les certificats d’études. Nous aurions tous immensément gagné si de telles épreuves eussent eu lieu il y a plusieurs années. Je sais bien que tu n’as pas besoin de ce stimulant pour faire un bon emploi ( sans E tandis que tu en as mis un ) de ton temps. Aussi suis-je persuadé à l’avance que tu t’en retireras avec honneur et distinction.
Tu ne devras pas perdre de vue la dispense au baccalauréat dont nous avons parlé si souvent ici. Lorsqu’il s’agira de cette affaire dont je te laisse à décider du moment opportun, je crois que, outre l’appui du Général Thiard, il faudrait également s’adresser à ton oncle. Son beau frère M. ?? a des accointances électorales avec le ministre de l’instruction publique, or un ministre ne sait rien refuser à qui peut lui vouer sous le rapport corps, biens et âme…
Ta santé doit être aujourd’hui tout à fait bonne. Quant à la mienne, si tu veux en savoir quelque chose, tu t’adresseras à Abel à qui j’écris sous le même couvert. L’acquisition de l’ouvrage dont tu me parles forme ou à peu près une bibliothèque complète de toutes les matières que tu as étudiées. Tu as bien fait de l’acheter, mais j’aurais désiré en connaître le prix.
Adieu, mon cher fils, aime nous comme nous t’aimons et compte toujours sur l’inaltérable dévouement de ton affectionné père.
Jeandet
Verdun le 6 décembre 1847
N’oubliez pas les prescriptions qui vous ont été faites les années précédentes au sujet de votre correspondance, ainsi si vous ne vous êtes pas encore exécutés, n’y manquez pas si tôt après la réception de cette lettre.
*Crois en Robert, qui le sait par expérience.
***
Le 18 décembre 1847
Si dans tout ce qu‘elle fait la nature agit toujours ou presque toujours en aveugle, laissant à notre pauvre espèce, le soin de se diriger comme elle le pourra dans ce labyrinthe sans fin qu’on appelle la vie, convenons aussi que parfois elle se montre plus intelligente et que lorsqu’elle nous dépouille d’une main, de l’autre elle nous prodigue ses dons. N’a-t-elle pas agit de la sorte à mon égard ? elle me rend solidaire, il est vrai, d’une maladie douloureuse et malheureusement incurable qui t’a été transmise par mon aïeul lequel lui aussi la tenait probablement de son père, mais en revanche, sans me doter toutes les vertus, du moins elle m’en a départi quelques unes, car mon cher père, je crois avec ces personnes, qu’il y a entre nous deux plus d’un point de ressemblance et les mêmes qu’il n’en serait rien, je n’en accepterais pas moins cet augure avec reconnaissance, y voyant, pour moi dans l’avenir le sûr garant d’une vie sans doute et bien remplie. Si, mon cher papa, comme je le conçois très bien, l’usage du café, des liqueurs, des mets épicés, et contraire aux hémorroïdes, ce que je n’explique pas aussi facilement c’est qu’avec un régime purement aquatique et plutôt débilitant que fortifiant, cette maudite affection se montre chez moi plus opiniâtre que chez tout autre. Quoiqu’il en soit de ???? Je supporterais encore avec assez de courage et de résignation et mes propres infirmités et la triste condition où le sort m’a placé, mais du moment où il s’agit de ta santé et de celle de ma mère, ma philosophie m’abandonne, mon pauvre et faible esprit se trouble, il ne peut supporter l’idée que votre vie puisse être en danger et j’éprouve littéralement un malaise particulier, inexplicable mais comparable aux plus grandes douleurs. C’est alors que ma raison s’égare et que j’aime à blasphémer : mon dieu me dis-je pourquoi suis-je né ? Pourquoi suis-je venu sur cette terre de deuil prendre ma part des misères humaines ? Pourquoi enfin suis-je triste du néant où il me faudra entrer ? David a dit : « les jours de l’homme sont comme l’herbe, sa fleur est comme celle des champs : un souffle passe, la fleur tombe, et la terre qui l’a portée ne la reconnaîtra plus. » que cette pensée est simple et sublime ! Peut-on définir avec plus de poésie et de délicatesse le passage ??? éphémère de l’homme sur la terre ?
Pardonne –moi, mon cher père, ces tristes et pénibles réflexions, toi et ma mère vous me connaissez assez maintenant, pour que je n’ai pas lieu de craindre que vous leur donniez plus d’importance qu’elles n’en ont réellement. Dans la lettre que tu as adressée à Abel, pourquoi ne dis-tu pas que tu suis un régime et un traitement approprié à ton état ? Il n’est pas probable que la médecine soit impuissante dans le cas qui nous occupe. Les boissons ???, par exemple sont particulièrement indiquées dans ces sortes d’affections : M. Afila dans sa leçon de mercredi dernier à propos des usages et des propriétés médicales de l’acide sulfurique pur, c’est à dire monohydrate marquant 66° à l’aéromètre, nous dit quelques mots des limonades acides et a précisément conseillé, dans le cas où l’on pisse du sang, de préférence aux autres liquides acidulés, l’emploi de la limonade sulfurique comme jadis sous le nom de limonade minérale. Je sais bien que tout cela n’est pas nouveau pour toi, mais en raison de l’à propos pourquoi n’en aurais-je point parlé en passant. Je ne suis pas mécontent de mon travail, et par suite de mon intelligence ; il me semble en effet que les diverses sciences qui sont autant de branches de l’art auquel je me suis destiné et qui naguère n’étaient pour moi rien moins qu’agréables, ne parurent moins difficiles et par cela même m’offrent un plus puissant intérêt. Espérons qu’en pénétrant plus avant dans l’étude de ma profession future, des difficultés imprévues ne viendront pas entraver ma marche et que ce vieux proverbe , finis coronat opus, pourra m’être justement appliqué. Mais je ne me lasse pas de m’entretenir avec vous , mes chers parents , et à la maison dont j’ai usé, on dirait en vérité que je ne crains pas de devenir fastidieux. Que voulez-vous je n’ai point d’autres confidents et où pourrais-je je vous le demande en trouver de meilleurs !
Adieu mes très chers et bien-aimés parents je vous embrasse de cœur et suis pour la vie votre respectueux fils
Amédée Jeandet
P.S. S’il n’est donc pas possible de savoir ce que deviennent les nouveaux mariés, et d’avoir , en particulier des nouvelles de ma tante Pierre
***
Mon cher Ami,
Il paraît que tu tiens à savoir comment se comportent les époux Jeandet, je te dirai qu’ils sont très entrain l’un de l’autre, ce sont deux tourtereaux, qui ne se quittent pas ; que dieu veuille que leurs amours durent longtemps, mais nous savons par nous même que la lune de miel n’est pas de longue durée. Pour ce qui concerne la noce, je crois en avoir assez dit dans ma première lettre, car tu dois concevoir que dans une aussi grande réunion, il s’est passé bien des épisodes. Il y aurait un feuilleton à vous écrire, si je vous détaillais tout ce qui s’est passé. Qu’il vous suffise de savoir que votre tante qui n’est rétablie que depuis quelques jours est on ne peu plus mécontente, il y a eu bien des personnes qui se sont plaintes, aussi me disait-elle l’autre jour, que si elle avait d’autres enfants elle les marierait sans noces, qu’on était bien bête de se donner de l’embarras pour des gens qui n’en valaient pas la peine. Cependant peu de personnes se sont plaintes des griefs sont dans la famille, je puis vous dire que le dîner était superbe, M. Lamarosse qui était à côté de moi en a été surpris, la ??? le gibier, le beau poisson, rien n’y manquait, nous n’avions de pièce de boucherie que quatre gigot de mouton que j’ai fait passer pour du chevreuil, ce qui a été accepté pour tel, vous voyez mes chers enfants qu’il n’y a que la foi qui nous sauve. Vous savez que Mlle Bernard se mariait huit jours plus tard, les messieurs qui étaient au dîner de votre oncle disaient à ceux qui étaient invités chez M. Bernard, nous ne savons pas ce que vous aurez à votre dîner, mais nous savons d’avance qu’il ne peut pas être plus beau que celui que M. Jeandet a offert car jamais nous avons vu un dîner aussi beau pour avoir autant de monde. Je crois vous avoir dit que le jour du mariage on était cent personnes. Chez M. Bernard on était que 26 personnes, la tante Coulon n’a pas été invitée ce qui l’a peinée beaucoup. Revenons à nos jeunes mariés, je ne voulais rien vous conter, mais malgré moi je me laisse entraîner pour avoir le bonheur de converser plus longtemps avec vous, et vous dire quelques mots d’une scène que je nommerais comique qui a eu lieu à minuit sous nos fenêtre le jour du mariage. Vous savez ou vous ne savez pas qu’on a la sale habitude de porter des œufs frais ou la ??? aux jeunes mariés. Jeandet a eu la bêtise de dire qu’il venait coucher à la maison. On les a suivi jusqu’à la porte, ils montent, sa petite femme était toute tremblante, il me conte cela en me disant qu’il allait couché chez son père que ça nous dérangerait trop, en somme je lui dit qu’il fera comme il voudra, mais que ces dames et ces messieurs ne monteront pas chez moi, que ma maison ne sera pas ouverte à des gens sans mœurs, et que de semblables orgies ne se passeraient pas chez nous, enfin il finit par me dire qu’il est bien fâché de tout cela parce que tout à l’heure on va venir nous déranger, mais qu’il leur a demandé de faire peu de bruit ; la dessus il part avec sa femme , je la rassure en lui disant que je dirai qu’ils sont là mais qu’ils n’entreront pas, je les empêcherai de vous chercher. Les voilà partis, vous connaissez votre père il se lève, va chercher les deux seaux d’eau en disant que les premiers qui viendront le déranger il leur jettera sur la tête. On arrive à minuit comme je vous l’ai dit, on sonne trois fois, je me lève, demande ce qu’on veut, il faisait noir je ne connaît personne, on répond que l’on vient pour les épousés, je dit je n’ouvre pas, on me répond : pourquoi, parce que nous ne voulons pas ; les épousés le veulent ; je dis encore Jeandet ne le veut pas ; je referme la fenêtre , on re sonne, ton père en colère arrive, je veux l’arrêter par son pan de chemise mais je ne le puis pas alors il répond qu’on entre pas chez lui, que les mariés y sont mais qu’ils n’entreront pas. Je le retire de la fenêtre et je la ferme pour la seconde fois, mais un troisième coup de sonnette retentit, votre père se retourne, ouvre la fenêtre et dit en colère, si c’est comme médecin qu’on parle je suis prêt mais si l’on vient encore pour me déranger je vous foutrai un coup de fusil, je prend ton père à bras le corps, je le tire de la fenêtre, je ferme, on casse des bouteilles de vin sucré sur le pavé, le reste je vous le dirai quand nous serons réunis, et vous nommerai les acteurs et actrices de cette scène.
Adieu mes chers enfants, je vous embrasse de tout mon cœur , Annette jeandet née Chapuis
Voilà le froid qui commence à se faire sentir, dites moi comment vous êtes arrangés, si vous vous chauffez au même feu, si vous avez un poêle votre père vous compte cent francs pour le bois s’il faut dix francs 20cts en plus on vous les fera. Dans la prochaine lettre d’Abel qu’il dise à quelle époque il a pris les 60 francs chez Adèle ??? Dis moi si Abel s’occupe spécialement de son affaire, je compte sur toi et dis le moi promptement, engage le de bien travailler mais parle avec douceur, amitié il n’aime pas à être brusqué, il est comme toi, et moi de même avec de la douceur on fait de nous ce qu’on veut. Je pense qu’il va passer son examen s’il ne l’a pas fait, je t’embrasse de cœur.
Dans votre position, ne parlez ni ne faites de politique, attendez pour cela du moins que vous ayez pris place dans la société.
***
Cette lettre n'est pas datée, on peut penser qu'elle a été écrite entre le 19 et le 29 décembre 1847
À mes fils Abel et Amédée
Quoique je sois fort empêché par la continuelle obsession des deux familles d’un malade que j’ai ici, M. Bigney Mathurin qui a repris son crachement de sang depuis cinq jours, je ne veux pas cependant laisser partir le courrier sans vous dire combien j’ai été profondément touché des lettres que vous m’avez écrites tous les deux à de courts intervalles. Ces témoignages d’une affection aussi vive sont la compensation que je désirais le plus et que j’obtiens enfin des longues peines dont ma vie a été semée. Vous contribuez à me rendre moins amères celles qui me restent à supporter en vous occupant moins vous même et en ne vous en faisant pas le sujet de vos inquiétudes . Ma position du reste s’est un peu améliorée. Les accidents dont je vous ai parlé se renouvellent plus rarement. J’ai fait quelques voyages sans presque rien éprouver. De tous les remèdes c’est le repos qui m’est le plus salutaire. C’est d’Abel seul que je dois l’attendre. Je le prie à cet effet de relire la partie de ma lettre où je parle de ses études et de me donner bientôt des détails très circonstanciés à cet égard.
J’étais dimanche 19 courant au banquet réformiste de Chalon. M. Boucher était un des orateurs mais il m’a été impossible de le voir, la séance n’ayant fini qu’à 5 heures du soir, moment où il m’a fallu remonter en voiture pour rentrer ici. Il y avait 1600 couverts, et plusieurs personnes sont restées debout à mon exemple. Cette réunion composée d’une grande partie d’électeurs avait quelque chose de fort imposant. Les discours prononcés ont été du plus pur radicalisme et tout à fait conforme à mes opinions personnelles. Sous le régime où nous vivons, régime où l’on se fait un jeu de violer l’intimité des familles, je dois m’abstenir de plus amples développements.
Adieu, mes chers fils, portez-vous bien et recevez ces quelques lignes comme une nouvelle preuve de mes sentiments affectueux pour vous et de mon entier dévouement.
Jeandet
***
30 décembre 1847
Il faut convenir que les vieilles coutumes sont profondément enracinées dans nos cœurs et qu’il est bien difficile de ne pas faire ce que nos pères ont fait de temps immémorial. Tout en respectant les anciens usages, qui sont j’en conviens, presque tous significatifs et qui nous retracent l’image à la fois fidèle et poétique d’un temps qui n’est plus, je n’en suis pas moins fort surpris de me voir vous écrire aujourd’hui une lettre de bonne année, car nos deux lettres précédentes, toutes celles qui les suivront ne seront-elles pas des lettres de bonne année ? Parce qu’elles ne seront pas terminées par la formule officielle devra-t-on en conclure que mon cœur est changé, ou que mon affection pour vous sera moindre qu’aujourd’hui qui est le premier de l’an ? Eh bien malgré cela, telle est la force de l’habitude, que si cette épître n’arrivait pas au jour et à l’heure dite, j’avoue que j’en serai véritablement contrarié.
Eh cependant ! Y-a-t-il un premier de l’an pour moi ? Est-ce que j’attends sa venue pour former des vœux pour votre bonheur ?Je ne mentirais pas si je vous disais qu’il ne se passe pas un jour que je ne pense à vous ! votre image chérie est sans cesse présente à mon esprit : je vous vois, je vous parle, j’entends le son de votre voix. Je me rappelle mille petits détails intimes, mille petites particularités de notre vie de famille ! puis à des souvenirs si chers viennent se mêler d’amères regrets : c’est que je compare ma vie actuelle au bonheur que je goûtais il y a deux ans à pareille époque et même encore il y a quatre mois ! C’est que je me demande s’il reviendra jamais ce temps que je regrette et qui maintenant me paraît si éloigné ! C’est que je me fais tout bas ces importantes questions : quel sort le destin me réserve-t-il ? te permettra-t-il de jouir un jour du fruit de tes travaux ? peux tu espérer revoir se renouveler les joies de la famille si chères à ton cœur, et ces moments délicieux où, assis le soir auprès du foyer, entre le meilleur des pères et la plus tendre des mères, tu leur prodiguais à tous les deux les plus douces caresses ? Voilà mes chers parents où se plait à m’entraîner aujourd’hui ma folle imagination, me faisant voir tout en beau et demain tout en noir ; c’est ainsi qu’elle aime à me ballotter au milieu d’une mer orageuse, tantôt me plongeant dans l’abîme, tantôt m’en retirant pour me remettre à flots. Eh mon dieu ? ne fais-je pas là, sans m’en douter l’image de l’esprit humain ? qui a-t-il de plus capricieux, de plus subtile, de plus insaisissable ? N’est ce pas un véritable caméléon dont les couleurs fugitives et toujours différentes offrent à nos yeux éblouis mille ??? diverses ? quoiqu’il en soit de tout ce qui précède, mes bien aimés parents, vous pouvez être certains de mon inaltérable amour pour vous et du désir ardent que j’ai de vous être agréable et de concourir autant qu’il sera en mon pouvoir, à votre bonheur ! c’est là l’insigne vœux que je forme ! c’est là l’unique prière que j’adresse aux dieux.
Adieu mon cher papa et ma chère maman, je vous embrasse de tout mon cœur et suis pour la vie votre respectueux fils Amédée Jeandet.
P.S. Vos deux lettres m’ont fait un bien sensible plaisir, les nouveaux détails sur la noce de Jeandet nous manquaient ; mais aussi il faut regretter de n’avoir pas été témoin de cette solennité.
Mes compliments de bonne année, je vous prie chez l’oncle Pierre, la tante Adrien et à toutes les personnes qui se souviennent de moi. Depuis quelques jours l’hiver qui jusqu’alors, avait été fort bénin, commence à sévir avec vigueur. Pour ce qui concerne le chauffage, que ma chère maman veuille bien avoir la complaisance de relire ma lettre du 24 novembre et elle saura ce qu’elle désire ! Amédée J.
***
1848
Chronologie des événements
Extrait d’Hérodote.net
Interdits de réunion, les républicains contournent la loi en organisant à partir du 9 juillet 1847 des banquets qui réunissent des centaines de participants autour de quelques éminents orateurs. On en compte pas moins de 70 à Paris et dans les grandes villes du royaume au cours des sept mois suivants.
Une révolution romantique
L'un de ces banquets ayant été interdit, les étudiants et les ouvriers manifestent le 22 février 1848 à Paris. Ils sont rejoints le lendemain par la garde nationale composée de petits bourgeois. La rue commence à se calmer quand le roi renvoie enfin son Premier ministre, le triste et impopulaire François Guizot. Mais, le soir du 23 février, une manifestation dégénère devant le ministère des Affaires étrangères, sur le boulevard des Capucines. Un coup de feu entraîne une riposte des soldats. On relève une vingtaine de morts. Les barricades se multiplient.
Dans la nuit, Louis-Philippe rappelle Adolphe Thiers, qui l'a porté au pouvoir 18 ans plus tôt, mais le remède est sans effet. Reçu avec hostilité par la troupe stationnée au Carrousel, devant le palais des Tuileries, le roi se résout à abdiquer en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, en confiant la régence à la duchesse d'Orléans.
La foule envahit le Palais Bourbon où siègent les députés. Les républicains commencent à se manifester. Un cri retentit : «À l'Hôtel de Ville !»
C'est ainsi qu'un petit groupe de républicains, à l'instigation de Ledru-Rollin et du vieux poète Lamartine (58 ans), gagne le lieu mythique de la Grande Révolution, celle de 1789. Lamartine, Ledru-Rollin, Arago, Dupont de l'Eure et Marie proclament dans la nuit l'avènement d'un gouvernement républicain. Ainsi naît la IIe République.
La Révolution parisienne a un énorme retentissement dans les élites européennes. Devant la contagion révolutionnaire, les monarques concèdent des Constitutions à Berlin, Munich, Vienne, Turin... « le printemps des peuples ».
Extrait de Wikipedia :
Les causes de la révolte ouvrière
• 26 février : création des Ateliers nationaux visant à résorber le chômage des ouvriers dans les grandes villes (la crise économique sévit depuis 1847).
• 15 mars : tentative de l'extrême gauche, qui sent la conjoncture défavorable, de faire repousser les élections.
• 23 et 24 avril : élection de l'Assemblée constituante ; unanimisme républicain chez les candidats ; les vainqueurs sont ceux qui figuraient sur plusieurs listes (scrutin de liste départemental jusqu'en 1852), donc modérés, qui se révélèrent au fil du temps républicains du lendemain. Les positions des uns et des autres se décantèrent à l'épreuve des faits.
• 21 juin : les Ateliers nationaux sont supprimés en raison de leur coût, parce que le travail (essentiellement le repavage des rues) n'existe plus, laissant place à l'agitation politique quotidienne. Le coût des ateliers nationaux ne représente en réalité que moins de 1 % du budget global du gouvernement.
• 22 juin : Agitation en divers points de la capitale.
Les journées insurrectionnelles
• 23 juin : Début de la révolte populaire de Juin par l'établissement des premières barricades, durement réprimée par l'armée menée par le général Cavaignac. Le général Hippolyte-Marie-Guillaume de Rosnyvinen de Piré a fourni le témoignage suivant, inattendu, de l'attitude des insurgés de la barricade de la rue Nationale-Saint-Martin ce jour-là :
« Citoyens représentants, entré le premier à la baïonnette, le 23 juin, dans la barricade de la rue Nationale-Saint-Martin, je me suis vu quelques instants seul au milieu des insurgés animés d'une exaspération indicible. nous combattions à outrance de part et d'autre ; ils pouvaient me tuer, ils ne l'ont pas fait ! J'étais dans les rangs de la Garde nationale, en grande tenue d'officier général ; ils ont respecté le vétéran d'Austerlitz et de Waterloo ! Le souvenir de leur générosité ne s'effacera jamais de ma mémoire... Je les ai combattu à mort, je les ai vus braves Français qu'ils sont ; encore une fois, ils ont épargné ma vie ; ils sont vaincus, malheureux, je leur dois le partage de mon pain... Advienne que pourra 6! »
• 24 juin : Le Panthéon de Paris est un des centres de l'insurrection. Plus de 1 500 insurgés s'y sont réfugiés. Ils sont délogés par le colonel Henri-Georges Boulay de la Meurthe à la tête d'un régiment de la garde républicaine7.
• 25 juin : Mort sur les barricades de Monseigneur Affre, archevêque de Paris. Le général Bréa est tué par les insurgés près de la barrière d'Italie.
• 26 juin : Fin de la révolte avec la chute de la dernière barricade, située faubourg Saint-Antoine. Ces journées révolutionnaires ont fait environ 4 000 morts du côté des insurgés, et 4 000 prisonniers sont déportés en Algérie. L'Assemblée décide de poursuites à l'égard de Louis Blanc.
• 28 juin : L'Assemblée remercie le général Cavaignac en le nommant chef du pouvoir exécutif.
• 3 juillet : Dissolution des Ateliers nationaux.
• 27 juillet : Suite à la répression des journées de Juin, l’Assemblée restreint l'activité des Clubs et y interdit la participation des femmes et des enfants.
• 28 juillet : Loi sur les clubs
La lettre qui suit est adressée à Monsieur Bernard Derosne par Amédée Jeandet.
10 janvier 1848
Monsieur,
Malgré le long espace de temps qui s’est écoulé depuis que j’ai quitté votre maison, j’en conserve néanmoins un agréable souvenir et me tiendrai toujours comme fort honoré d’avoir commencé l’étude de l’art auquel je me destine dans une pharmacie aussi recommandable que la votre, et dont la réputation est si bien établie depuis un si grand nombre d’années. C’est donc en considération de ce qui précède et à titre d’ancien élève, que je prends, Monsieur, la liberté de vous adresser cette lettre au risque de devenir importun.
Le motif qui, aujourd’hui me fait prendre la plume, est le même qui me porta à vous écrire il y a quelques mois, attendu que ma position n’est pas changée et qu’il s’agit toujours pour moi d’obtenir une dispense de baccalauréat. Car sans être précisément certain de réussir, je ne dois pas du moins désespérer du succès, surtout si je parviens à alléguer des raisons plausibles et capables de justifier une semblable démarche.
De plus, les nouveaux renseignements que j’ai recueillis à cet égard, m’ont appris qu’on accueillait plus favorablement les demandes de ceux qui avaient huit années d’études pharmaceutiques, et précisément il s’en manque bien peu de chose que je ne sois en règle. En effet, avec mes deux inscriptions qui me valent quatre ans et mon stage en pharmacie qui est de trois ans et huit mois, vous voyez que la différence est bien minime et qu’il me suffirait de 4 mois de plus pour compléter les années exigées par la loi. Maintenant, Monsieur, que vous connaissez l’état de la question, ais-je besoin de poursuivre plus avant ? N’avez vous pas déjà compris le but de cette lettre et ce que son auteur vient réclamer de votre extrême obligeance ? lors du court séjour que vous fîtes à Verdun, mon frère se proposait de vous parler lui-même de cette affaire, pensant qu’en raison du peu de temps qui me manquait pour que je fusse resté quatre mois dans votre maison., il ne fut pas impossible que vous consentiez à faire une petite correction au certificat que vous aviez eu la bonté de me donner au mois de mai de l’année dernière, mais le moment opportun ne s’est point offert, et c’est moi qui aujourd’hui prends la liberté de vous écrire pour vous en prier.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de la parfaite considération de votre très humble et très obéissant serviteur.
Amédée Jeandet
Rue St Jacques n° 189
***
Mon cher Amédée,
Je suis entièrement à votre disposition pour le petit service que vous voulez de moi et en venant rue St Honoré de deux à quatre et en m’apportant votre certificat nous le compléterons dans le sens qui pourra vous être favorable.
Votre bien affectionné
Bernard Derosne
11 janvier 1848
***
14 janvier 1848
Mes chers parents,
Enfin pour la première fois de ma vie j’ai une bonne nouvelle à vous apprendre, pour la première fois, j’éprouve un plaisir inexplicable à vous écrire, certain d’avance que cette épître vous sera d’autant plus agréable que vous vous attendez moins à ce qu’elle va vous apprendre. Vous savez que la loi exige des élèves en pharmacie huit ans d’études et que pour en arriver là, j’ai déjà séjourné plus de trois ans dans une officine, que j’ai suivi une première année de cours, que j’ai recommencé une deuxième, pendant laquelle j’aurai deux examens à passer, qu’au mois de novembre prochain , il me faudra revenir à Paris, à une époque déterminée, pour prendre une troisième inscription et qu’enfin je n’aurai complétement terminé qu’au mois de mai 1849.
Eh bien ! maintenant si je vous disais que le dénouement approche , que l’année scolaire qui vient de commencer est ma dernière année d’études, qu’au mois d’août prochain je serai libre comme l’air, emportant dans mon portefeuille mes huit ans de stage. ; à coup sûr vous refuseriez de me croire et me taxerez de démence. Eh bien ! cependant rien n’est plus vrai, rien n’est plus réel ; ajoutez en outre, et c’est là le plus piquant de l’affaire, que c’est un simple trait de plume et un peu d’habilité de ma part qui me valent cet heureux changement survenu dans ma position. En effet un jour, ou plus exactement une nuit car j’étais couché, je récapitulais dans mon esprit les sacrifices sans nombre que nous faisons depuis plus de 7 ans pour obtenir ce misérable titre de pharmacien, je faillis perdre entièrement courage, lorsque je vis que loin de m’approcher du terme, il me faudrait encore revenir à Paris l’année prochaine, délier les cordons de ma bourse, compter 36 francs à l’école et passer un nouvel examen de fin d’année, parce qu’il me manquait cinq mois de stage en pharmacie, cinq mois seulement ! et j’arrêtai là le cours de mas réflexions, car une idée subite venait de me traverser l’esprit, et je vis la possibilité de me débarrasser d’un seul coup de toutes ces entraves. Dès lors je ne songeai plus qu’à mettre à exécution mon projet. Contre mon espérance, ( car ce que je demandai cette année m’avait été refusé l’an dernier) un plein succès a couronné mon entreprise et deux jours après le départ de la lettre toute diplomatique que j’avais adressée à la seule personne qui pouvait faire droit à ma demande et que vous avez déjà deviné, j’obtins ce que je désirais, c’est à dire un certificat de quatre ans , ce qui , réuni à mes inscriptions qui me valent à elles deux également quatre ans, me fait précisément huit années d’études.
A présent, mes biens aimés parents, convenez que je dois être assez content de moi-même et que s’il est dangereux de trop réfléchir, quelques fois cependant cela vous conduit à bien. Abel, qui n’a été instruit de cette affaire que lorsque tout a été terminé, pense, avec moi, que cet événement inattendu pourra m’être fort utile relativement au baccalauréat.
Voilà mes chers parents ce que j’avais à vous dire ; peut être attendiez-vous non pas de moi, mais d’Abel une tout autre nouvelle ?
J’allais terminer cette lettre, lorsque la votre est venu, comme toujours ajouter de nouvelles inquiétudes à celles que nous avions déjà. Mon dieu ! que la vie est une chose bizarre et incompréhensible. J’étais il n’y a qu’une minute joyeux et content et voilà qu’à la gaîté succède la tristesse, à la joie la plus vive décevants chagrins, hélas je redeviens moi-même !
Mon frère écrira prochainement à mon papa ; Je ne puis rien dire de son examen attendu qu’il est peu communicatif relativement à ses études, cependant je présume qu’il se présentera à la fin du mois.
Adieu, mes bien aimés parents, je vous embrasse de tout mon cœur et suis pour la vie votre respectueux fils.
Mon frère se joint à moi.
Amédée Jeandet
P.S. En raison de l’état de vos santés qui est loin d’être bon et de l’accident survenu à mon papa, ne tardez pas trop longtemps à nous écrire.
***
Verdun le 22 janvier 1848
Ce serait, sans aucun doute, mon cher Amédée, une grande et heureuse nouvelle que celle dont tu nous a parlée dans ta lettre du 14 de ce mois, puisqu’elle aurait pour résultat d’abréger ton séjour à Paris de près d’un an, et de faire disparaître la grave difficulté du baccalauréat. Conséquence importante que nous croyons pouvoir tirer de tout ce que tu nous écris, quoique tu n’en dise mot. Mais avant de partager nous-même la joie que tu en éprouves, nous voudrions savoir si tu ne prends pas tes désirs pour des réalités. Es-tu bien certain que les études pharmaceutiques sont de huit ans ; que quatre années passées dans une officine équivalent à un temps pareil passé dans une école, et que deux années dans celle-ci représentent quatre ans d’officine ? D’où te viennent ces renseignements ? les as tu lus quelque part, ou les tiens-tu de personnes compétentes en cette matière ? Quant à moi je les ai inutilement cherchés dans la nouvelle loi sur les école de pharmacie , loi que l’on trouve à la tête de l’un des annuaires de M. Bouchardot. Il n’y a rien absolument ni sur la durée des études, ni sur la manière dont on peut les faire. Donne moi à ce sujet les instructions les plus précises, les détails les plus circonstanciés afin de dissiper tous mes doutes et de me laisser jouir à l’avance du bonheur de nous voir encore réunis pour ne plus nous quitter peut-être … L’affaire dont il s’agit ici, mon cher fils, est du plus haut intérêt. Ce doit être l’unique question que tu auras à traiter dans tes prochaines lettres où tu aurais à m’informer de tout ce qu’il est dans tes projets d’exécuter pour arriver à Verdun au mois de juillet ou d’août, nanti des pièces nécessaires à ta future réception.
Les chambres auront à ???? cette année sur la loi relative à l’enseignement et à l’exercice de la médecine et de la pharmacie. Avant que cette ???? ne soit ouverte et surtout qu’elle ne soit formée, j’imagine que tu seras parfaitement en mesure de solliciter la dispense du diplôme de baccalauréat es lettres. C’est le cas d’avoir recours à l’assistant du général Thiard, et par surcroît de précaution, à ton oncle Chapuis par l’intermédiaire du docteur Richard, son beau-frère à qui M . de Salvandy accorderait volontiers cette petite faveur. Dis moi si tu comptes cette dispense au nombre des avantages que tu te promets de l’avancement inespéré de tes études.
Depuis un mois j’ai fait souvent de longues et pénibles courses. Mon infirmité n’en a pourtant pas augmenté. Le froid assez vif qui n’a pas cessé de régner en est probablement la cause. Il a agi chez moi à la manière des astringents en refermant les capillaires autrefois béants de la muqueuse de la vessie. Nous le verrons du reste au retour de la belle saison. Mon doigt écrasé va mieux sans être encore guéri, ni sans me causer, au contact du froid, d’assez fortes douleurs.
Ta mère se porte bien. Les craintes que nous avions eu sur le renouvellement de ses douleurs de ventre se sont heureusement dissipées.
Adieu mon cher ami, porte toi bien, embrasse tendrement ton frère pour nous, ton affectionné et tout dévoué père.
Jeandet
P.S. J’ai profité de quelque répit pour t’écrire ces quelques lignes. La négligence qu’on y observe montre suffisamment la hâte que j’ai mise à les écrire. J’attends toujours mais vainement de ton frère une lettre en réponse à la mienne, c’est à dire fort longue et fort explicite… le temps marche pourtant… serions nous seuls actionnaires…
Nous sommes inquiets de savoir comment vous vous défendez contre les rigueurs inaccoutumées de cet interminable hiver, avez vous loué un poêle ou le remplacez-vous ?? ne ??? pas le bois au foyer ? Votre oncle Pierre qui vient m’inviter à la St Paul vous fait ses compliments ainsi que toute sa famille.
***
Le 6 février 1848
Mon cher papa,
Lorsque pendant une longue suite d’années ou a été trompé dans ses plus chères espérances, que l’on a pu voir se réaliser le moindre de ses désirs et qu’il a fallu renoncer à tous les projets, à tous ces rêves de bonheur, dont l’homme aime tant à se bercer, on finit par croire qu’il ne peut en être autrement, l’esprit et le cœur s’y accoutument, et s’il advient qu’un certain jour la fortune, plus traitable, vienne et vous tende la main, on retire bien vite la sienne et on détourne tristement la tête en lui disant « vous vous trompez ce n’est point ici, allez frapper ailleurs ». Tel est l’accueil que tu as fait à ma lettre du 14 janvier, mon cher père ; Elle t’annonce une heureuse nouvelle, bien surprenante, bien inattendue il est vrai ; eh bien ! Tu refuses ou du moins tu hésites à l’accepter comme véritable. Heureusement, mon bon père, que tes craintes ne sont point fondées et que je puis que confirmer ici ce que je t’ai déjà dit dans ma dernière épître. Je conviens qu’à la lecture de celle-ci ta surprise a du être extrême, mais si cependant tu te rappelles mes antécédents, tout ceci ne te paraîtra que fort naturel. En effet n’as-tu pas été à même de t’assurer, soit par mes lettres soit par les conversations que nous avons eues ensemble, combien j’ai toujours été désireux de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour atteindre le but auquel j’aspire et surtout pour abréger autant que possible, mon séjour à Paris ? Car Paris, cette ville tant aimée de la jeunesse et dont on ne peut s’arracher, moi j’ai toujours grand peine à ne point la quitter toutes les fois que je rencontre une diligence partant pour la Bourgogne. C’est que tel j’étais il y a dix ans, tel je suis encore aujourd’hui. Eh pourtant ! On m’a souvent répété « Bah ! Bah ! Tout ceci n’aura qu’un temps, peu à peu vous oublierez le clocher de votre village et un jour viendra où vous ne pourrez même plus vous accommoder de la vie triste et monotone du foyer paternel » ; mais les personnes qui me tenaient un semblable langage, et chez lesquelles sans doute ??? caillou avait pris la place du cœur, n’ont pas été prophètes. Quoiqu’il en soit, mon cher papa, pour faire cesser toutes les craintes relativement à l’affaire qui nous occupe, je vais transcrire ici textuellement l’article de la loi où il est parlé du stage en pharmacie : « une année d’étude dans une école spéciale équivaut à deux années de stage dans les officines et seront comptées aux aspirants sur les huit années de stage exigées pour la réception ». Ceci est bien clair et n’a pas besoin de commentaires. Maintenant que nous savons à quoi nous en tenir sur cette affaire, il s’agit de faire en sorte d’en profiter et par conséquent de ne pas me faire refuser aux examens semestriels ; Voilà ce qui m’occupe d’une manière toute particulière et ne me ??? moi vivement je t’assure.
Vient ensuite la dispense de baccalauréat à laquelle je n’ose point songer tant je suis partagé entre l’espoir et la crainte : m’arrive-t-il de supposer que j’ai été assez heureux pour réussir, mon cœur bondit de joie et je ne puis me contenir ; est-ce l’effet contraire qui se présente à ma pensée ? je me sent frissonner et au courage et à l’espérance qui jusqu’à ce jour m’ont soutenu, semble vouloir succéder le découragement le plus complet. J’ai pensé comme toi, mon cher papa, que le moment le plus opportun pour la présentation de ma pétition, serait précisément celui qui coïnciderait avec la discussion à la chambre du projet de loi sur l’organisation de la médecine et de la pharmacie, mais néanmoins je désire que celle ci ait lieu le plus tard possible, attendu que tu sais que l’affaire capitale pour nous, c’est la question d’âge, et je suis malheureusement bien jeune ; C’est là mon seul défaut ! Nous avons eu le plaisir de déjeuner avec notre oncle Chapuis jeudi dernier 3 courant ; il se porte à merveille, il est gros, a le teint fleuri et ce qui vaut encore mieux de la gaieté pour quatre. Nous l’avions déjà vu le 1° janvier revenant, avec sa femme et son fils, de Tours où avait eu lieu la célébration du mariage de Mlle de Mauroy avec M. Durand ???? . Ces ??? de mariage me font l’effet de véritables ???? et la victime la jeune épousée.
P.S. Le 2 février j’ai pris chez M. Bernard 300 francs et non 320 francs comme j’aurais du le faire ; la cause de cette erreur est due à l’imperfection de nos sens qui nous trompent bien souvent ; Abel qui m’a fait part de la ????, alors 300 au lieu de 320 …
Nous ne songeons ni l’un ni l’autre à faire partie du banquet des écoles. Des compliments de ma part chez l’oncle Pierre ???
J’ai acheté l’ouvrage de M. Parot et je m’en félicite : en effet il offre tous les avantages d’un manuel sans en avoir les inconvénients : on y rencontre pas de ces définitions qui pêchent par leur trop grande brièveté, l’auteur gardant un juste milieu, ne leur a donné que le développement nécessaire, développement subordonné, il est vrai, au plan et à l’attente de son ouvrage, mais néanmoins suffisant pour réunir la clarté à la précision. Bien entendu ce n’est point là le livre d’un praticien, car il lui faut à lui des traités spéciaux et non pas élémentaires et l’ouvrage dont il s’agit ici ne peut convenir qu’à des élèves. Il y a en effet certaines parties, telles que la pharmacie, la matière médicale et surtout la toxicologie qui sont traitées d’une manière très succincte et dont un pharmacien ne pourrait nullement se contenter : malgré cela l’élève, qui connaîtrait passablement toutes les matières renfermées dans ce livre, pourrait se présenter hardiment et avec sécurité à ses examens. Cet ouvrage qui se compose de 4 forts volumes in-8 qui renferme 700 figures intercalées dans le texte, me revient à 27 francs. Je ne crois qu’il soit possible d’avoir un ouvrage de cette nature à meilleur marché, surtout maintenant où les livres de sciences sont à un prix fort élevé. J’aurais du le payer 31 francs conformément au prix où il est côté dans tous les prospectus et annonces, mais connaissant le commis de la librairie où je l’ai acheté, j’ai obtenu une remise de 4 francs.
***
Me voilà, mon cher Amédée, parfaitement renseigné sur la durée des études en pharmacie avant de pouvoir être admis aux examens. L’article de la loi que tu as eu la bonne idée de me rappeler est positif à cet égard et non sujet à interprétations. Nous en devons conclure déjà que nous nous reverrons à l’automne prochain, que nous passerons l’hiver ici en famille et que nous aviserons ensemble aux moyens de surmonter les difficultés qui pourraient encore rester. Je ne comprends pas bien l’importance que tu attaches au succès des deux épreuves semestrielles auxquelles tu seras soumis au mois de mars et de juillet. Pour l’élève qui s’en retire mal, il me semble qu’il ne saurait en résulter autre chose, en ce qui concerne les examens réels, qu’un ajournement plus ou mois long, sans obligation absolue de suivre les cours de l’école. Eh ! Que te fait ce retard, à toi qui n’a, comme tu le dis , qu’un seul défaut, que tant de gens regrettent de ne pas avoir, celui d’être trop jeune. Ce sont donc des jours de plus que nous userons ensemble, et qui, dans l’espérance que j’ai d’en jouir, font aujourd’hui le charme des miens. Je me préoccupe davantage de la question du baccalauréat. Sans renoncer à la dispense qui n’est qu’un ???? in extremis, j’aurais préféré que tu eussent fait quelques nouvelles tentatives pour obtenir le degré qui confère l’inappréciable privilège d’être reçu et d’exercer partout. Où en es-tu à ce sujet ? Tes autres études déjà si multipliées, je le sais, t’ont peut être empêché de songer à celles-ci ? Mais il y aurait-t-il impossibilité de te présenter sinon à la session d’avril, du moins à celles du 25 juillet et au premier septembre ? A propos de cette affaire je lisais dernièrement dans mon journal l’annonce d’un cours préparatoire de M. Boulot, conformément au programme de 1848. Il y a donc eu des modifications apportées à l’ancien programme, et peux tu me faire connaître de quelle nature elles sont.
Ma clientèle a éprouvé une recrudescence, juste au moment où commençait le dégel, accompagné d’une pluie bien nourrie. J’ai fait plusieurs voyages excessivement pénibles, tantôt dans la boue, tantôt ayant de l’eau jusqu’à mi-jambe, protégé par un parapluie dont dix baleines environ formaient autant de gouttières qui venaient se décharger sur la moitié inférieur de mon corps trempé ainsi après vingt minutes, comme une soupe à l’eau glaciale. Le dirai-je ? mon vœu était que, bien à l’abri pourtant, ton frère et toi eussiez pu me voir dans cette triste position… aussi ai-je repris depuis toutes mes infirmités… J’ai pissé du sang ; mes urines ont coulé avec peine, et même ont été supprimées quelques heures avec des besoins continuels mais infructueux de les rendre… Je me demande toujours où cela me conduira-il ?
Vous semblez chaque année oublier les arrangements que nous avions pris en nous quittant au sujet de l’argent que je vous donne par mois. A votre départ cette affaire était réglée pour trois mois finissant fin janvier. Par suite je vous ai écrit de prendre chez M. Bernard pour février et mars 320, soit 160 francs pour chacun ou 80 francs par mois. Vous en avez réellement touché que 300, ce sera en conséquence 340 que vous prendrez, quand bon vous semble et qui formeront le complément de l’arriéré et le solde des mois d’avril et de mai. Ces dispositions pécuniaires ne doivent pas être considérées par vous comme ne devant jamais être ??? Il est des dépenses qu’on ne saurait prévoir, et auxquelles vous me trouverez toujours prêt à satisfaire, bien persuadé que je sais que vous y mettrez, comme par le passé, toute l’économie possible. Oui, c’est là une des plus heureuses compensations des peines qui ont accompagné ma vie : J’ai le rare bonheur d’avoir deux fils que je pourrai laisser maîtres du peu que je possède sans crainte qu’ils en fissent abus.
Adieu, mon cher Amédée, embrasse tendrement pour moi ton frère à qui je me propose d’écrire avant peu. Continue de nous donner souvent de vos nouvelles, ton dévoué père et ami
Jeandet
19 février1848
Ta mère est toujours d’une santé douteuse. Elle ne la maintient même ainsi qu’à la condition de ne presque plus marcher, car c’est du ventre que viennent les douleurs qu’elle éprouve. Si tu ne lis pas toute ma lettre à ton frère, je désire que tu le fasses du moins pour le second paragraphe qui concerne ma santé.
Vous savez probablement moins bien que nous ce qui se passe ) Paris, car nous présumons que vous ne lisez guère les journaux. Or apprenez qu’un avenir peut être fort prochain se charge des plus sombres nuages. Le banquet du 12° arrondissement dont on parle depuis longtemps s’organise enfin dans des proportions immenses. Toute l’opposition qui a été censurée dans ceux de ses membres qui ont pris part à d’anciens banquets ou qui y ont adhéré, veut s’y associer. Le gouvernement ou mieux le ministère persistera-t-il à empêcher cette grande manifestation, ainsi qu’il l’a expressément déclaré ? On ne peut imaginer dans ce cas quelles en seraient les conséquences. Les troupes sont consignées dans les casernes et ont des vivres pour plusieurs jours, nous dit on. On a vu des voitures chargées de munitions de guerre parcourir dans toute sa longueur la rue St Honoré, à la stupéfaction des passants. Au nom de ce que vous avez de plus cher, nous vous supplions, si vous avez connaissance de ces sinistres symptômes, d’y rester complétement étrangers et de ne point quitter votre chambre.
***
Verdun le 23 février 1848
Mon cher ami,
Nous regrettions de ne t’avoir pas prié de nous écrire de suite après la réception de la lettre que ton père vient de t’adresser, les événements qui se passent à Paris sont de nature à causer de sérieuses inquiétudes à tous les parents qui ont des enfants dans la capitale. Nous te remercions donc mon cher ami d’avoir satisfait à nos désirs sans y être invité et nous t’engageons à nous donner presque chaque jour, toi ou ton frère des nouvelles jusqu’à ce que le calme soit entièrement rétabli ou vous ??? nous voyons avec plaisir que vous habitez un quartier tranquille quoique on y déploie, ainsi que tu nous le dit, des forces militaires qui n’auront pas besoin d’agir. Restez chez vous ; n’en sortez que pour des occupations indispensables, et qu’une vaine curiosité ne vous porte pas aux lieux ou pourrait s’engager quelque conflit. Nous espérons d’ailleurs qu’au reçu de cette lettre tout sera rentré dans l’ordre et dans l’état habituel. Malgré toutes ces circonstances, je ne présume pas que les études en aient souffert. Aussi je m’étonne grandement qu’Abel ne nous ait point écrit depuis plus d’un mois. Nous nous attendions à recevoir de lui l’annonce qu’il avait enfin subi son examen. Il ne se méfie pas assez du temps qui s’écoule et de celui qui lui reste à courir. S’il n’en profite pas mieux je vois avec douleur que l’année se passera encore avant de terminer ses études, car du mois de mars au mois de juillet il n’y a plus que cinq mois, l’école se fermant pour les candidats de dernière année dès le premier août si je me rappelle bien même je crois que c’est au premier juillet, or il a encore deux examens et la thèse a passer . Si il y va de ce train, il n’y a plus possibilité d’atteindre le but attendu qu’il y aura bientôt quatre mois qu’il se prépare à un seul examen, sans compter ce qu’il avait déjà fait auparavant pour cet objet. Le froid a cessé et ne met plus d’obstacle à un travail non interrompu. On a aujourd’hui de dix heures du matin à huit heures du soir quatorze heures de travail durant lesquelles on a le temps voir une infinité de choses. Fais lire cette lettre à ton frère afin qu’il nous réponde à quelle époque il va se présenter pour que nous sachions au moins à quoi nous en tenir. Nous croyons toujours que si il met tant de retard à se présenter c’est qu’il veut être prêt à la fois pour ses deux examens qu’il subirait alors à un intervalle très rapproché et surtout qu’il nous annonce incessamment qu’i a passé son quatrième. Vous savez mes chers enfants que nos santés ne sont pas très bonnes, votre père a bien de la peine et il ne lui en faudrait pas, qu’il soit au moins récompensé des maux qu’il a pour vous, en apprenant que vous employez tout votre temps à l’étude et d’être bientôt près de lui afin de lui éviter toutes les peines morales et physiques qu’il éprouve depuis si longtemps. Je suis presque toujours souffrante, mon ventre ne veut pas se remettre. Nous sommes très peinés de la maladie du mari d’Anna, d’après ce que tu nous dit nous croyons qu’il n’existe plus, mais comme il est dans la force de l’âge il y a des ressources, il serait bien malheureux pour ma pauvre Anna de perdre son mari après un mois de mariage. Tu nous diras ce qui s’est passé. Je crains bien que ton frère allant chez ce M. ??? se trouve à passer entre des piquets de soldats, je ne serai tranquille que quand nous aurons reçu une lettre de vous. Si vous revoyez ma belle sœur, et qu’il soit arrivé le malheur que l’on craint, dites lui que nous prenons bien part à son chagrin ainsi qu’à celui d’Anna. Adieu mes chers enfants, je vous embrasse de tout mon cœur ainsi que votre père.
Annette Jeandet née Chapuis.
Réponse de suite j ‘attends votre lettre le 29
***
Paris le 26 février 1848.
Mes chers parents,
Voici une feuille de papier de bonne maison je vous assure ; Je l’ai prise aux Tuileries le 24 février 1848 jour à jamais mémorable où pour la troisième fois le peuple de Paris, la canaille enfin, a chassé devant elle la dernière branche de cette race indestructible qui s’est implantée sur le sol de France depuis plus de huit siècles. J’ai honte, mes chers parents, en présence d’événements aussi extraordinaires, aussi miraculeux, de vous parler de moi, de ma misérable personne, mais c’est précisément parce que ma pauvre machine est malade dans une de ses parties qu’il est inutile de vous nommer, que j’enrage de tout mon cœur en me voyant réduit à jouer le rôle d’un cul de jatte alors que tous mes concitoyens sont en mouvement et que la patrie a besoin du concours de tous ses enfants. Lorsqu’il y aura moyen de s’occuper de ses affaires, je répondrai à la lettre de mon papa, en ce qui concerne mon travail.
P.S. adieu mon cher papa et ma chère maman je vous embrasse bien tendrement et suis pour la vie votre respectueux fils.
Amédée Jeandet citoyen de la république
***
Verdun le 5 mars 1848
Votre mère vous pardonne mais, c’est à la condition que vous ne vous mêliez pas de politique ; la république ne vous donnera pas de pain si vous en manquez, vos conditions n’ont point changé, pour vivre il faut travailler. Ne vous occupez donc aujourd’hui que de ce qui vous concerne, finissez le plus tôt possible afin que nous soyons plus tôt réunis. Dans les commencements du gouvernement on doit être bien moins difficile à l’égard des jeunes gens, qui ont des examens a passer, il faut profiter du moment, d’ailleurs quand on est si bon républicain, on doit avoir des connaissances qui peuvent vous servir, il faut les utiliser. La ville de Verdun n’est point républicaine, elle ne s’occupe de rien, votre père est trop vieux pour la mettre en mouvement ; Hier deux pétitions circulaient afin de conserver M. Constantin pour maire , on dit que la plus grande partie des habitants l’ont signée. Adieu, votre mère vous conseille aujourd’hui de ne vous occuper que de vos études.
Annette Jeandet
Ces pétitions doivent être envoyées au gouvernement provisoire par le maire à ce que l’on dit.
J’arrive à l’instant où votre mère ferme sa lettre. En approuvant les conseils qu’elle vous donne à l’égard de vos études, je dois ajouter qu’elle préjuge d’une manière trop défavorable de l’esprit patriotique de nos verdunois. Ils n’ont besoin, j’en suis sûr, que d’être un peu stimulés. Aussi avant la réception de ta lettre, j’avais eu la pensée de fonder ici une petite réunion républicaine. Si mes occupations particulières et ma santé me le permettent, je ne renonce pas à ce projet. Pourquoi me manquez-vous dans ces circonstances aussi graves et aussi pressantes ?
Je viens d’apprendre que le citoyen M ??? est nommé préfet de Saône et Loire. Cet événement doit être le présage de quelque important changement dans notre commune. Adieu mes chers fils, portez-vous bien, à un peu plus tard une lettre de moi
Jeandet
***
République Française
Paris ce 15 mars 1848.
Très cher père,
J’ai repris le cours de mes travaux déjà depuis plusieurs jours, mais ce n’est pas sans peine, car, quoiqu’en dise ma bonne mère, à moins d’être un homme de pierre, il est impossible à l’heure qu’il est et en présence des événements prodigieux qui s’accomplissent, il est impossible, dis-je, de se boucher les oreilles, de se fermer dans sa chambre et d’y puiser à longs traits la science chimique et pharmacologique, alors que le peuple de Paris, dans sa juste et sainte colère, renverse un trône entaché de tous les crimes, apprend à l’Europe étonnée que la France est républicaine, et commande le respect à ses ennemis, par une modération sublime après la victoire. Ô mon bon père ! pourquoi ne t’a-t-il pas été permis, comme à nous, de voir le peuple en action, ce peuple de France si faible, si craintif la veille, mais si fort, si robuste le lendemain ? Quel spectacle imposant que l’aspect de ces hommes en blouse, la plupart mal vêtu, qui se promenaient l’arme au bras dans les salons dorés des Tuileries et veillaient, du moins autant qu’ils le pouvaient, à ce que la foule des curieux, qui envahissaient de toutes parts les appartements de l’ex famille royale, ne commit aucun dégât notable ! C’étaient là les véritables combattants, les véritables citoyens qui s’étaient montrés si grands pendant et après la lutte !... C’était en un mot le peuple vainqueur et souverain ! Durant cette journée du 24 février, date désormais inscrite au temple de l’immortalité, tout ce qui arrivait, tout ce qu’on voyait tenait du prodige : ainsi nous n’oublierons jamais, mon frère et moi, l’impression profonde que nous ressentions en entendant, ce même jour 24 à 10 et demi du soir, le citoyen Louis Blanc venir proclamer, du haut des degrés de l’hôtel de ville, la République Française au nom du peuple souverain !... Maintenant voulez-vous le voir en action ce peuple qu’on aime tant à dénigrer ? Voulez-vous savoir comment il sait maintenir l’ordre et faire respecter la propriété ? Eh bien dirigez-vous vers l’hôtel de ville et vous verrez un homme pendu à une des fenêtres de cet édifice, et vous lirez sur un écriteau attaché au dos de cet homme, les mots écrits en gros caractères Justice du peuple et plus bas voleur !...Aux Tuileries il agit de même : un homme est convaincu d’avoir dérobé un objet de prix, il est fusillé sur le champ. Remarquez en passant, que tous ces braves citoyens, si pointilleux à l’endroit de l’honneur, étaient de pauvres diables sans argent, puisqu’ils ne travaillaient pas depuis deux jours, et que le plus grand nombre n’avait pas déjeuné !... Il paraît, mon cher père, qu’il s’organise à Verdun, sous tes auspices, un club républicain ? Je suis on ne peut plus satisfait de te voir prendre l’initiative en de telles circonstances, mais permets moi de te dire que c’est une affaire grave que la fondation d’une semblable société : Défiez-vous des faux frères qui pourraient se glisser parmi vous, de ces hommes du lendemain qui alors que la royauté déchue était aux affaires, applaudissaient à tous ses actes, qui votaient pour les Pritchardistes, s’avouaient hautement satisfaits, de ces hommes enfin qui ont tourné casaque et vous jurent leurs grands dieux qu’ils ont toujours été de purs républicains. La république qui, à peine sortie des barricades encore humides de sang, a proclamé l’oubli et le pardon des injures, veut bien jeter un voile sur le passé, elle veut bien ne repousser de son sein aucun de ses enfants, mais elle ne peut ni ne doit accepter pour chefs ceux qui la veille encore de la victoire , la couvraient de ridicule et l’outrageaient dans leurs discours !... Mais parlons un peu de nos affaires : tu as sans doute, ainsi que moi, mon cher papa, déjà pensé que ces grands événements pourraient bien apporter un notable changement dans ma position ? Désormais mon avenir semble se dessiner de plus en plus ; ainsi voilà le projet de loi sur l’organisation de la médecine ajourné jusqu’à une époque indéterminée et par suite la suppression des jurys médicaux différée ; Je puis donc par conséquent espérer pouvoir prendre mon titre auprès de ceux-ci, attendu qu’il ne s’agit rien moins, pour nous, que d’une économie de 900 francs, et qu’en somme on ne lira pas sur mon visage que je ne suis pas pharmacien de l’école de Paris, titre qui ne vous donne pas la science lorsque vous ne l’avez pas. Quant à ce qui concerne le baccalauréat, je n’ai encore fait aucune démarche, mais d’ici à quelque temps je compte revenir à la charge et j’espère !... Du reste ce qu’il y a de bien clair, de bien net dans ma situation, c’est qu’au mois d’août prochain je plierai bagage et prendrai gaiement le chemin de ma petite ville, séjour affreux, sans doute, pour un dandy du boulevard de Gand, mais véritable paradis terrestre tout émaillé de fleurs pour l’homme sensible et resté pur au contact pestiféré de nos modernes Sodome !...
Adieu mon très cher père et ma très chère mère, je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de croire à l’affection inaltérable de votre fils
Amédée Jeandet
P.S. Nous avons reçu depuis peu des nouvelles du docteur Adrien de Crécy ; il paraît qu’il ne se fait plus illusion sur l’état de son fils qui finira par succomber à la cruelle maladie qui le consume. Je t’ai envoyé le 3° numéro du journal L’ami du peuple ; S’il continue à marcher dans une bonne voie, je te l’enverrai à l’avenir en te priant de me le conserver.
Des compliments de ma part chez l’oncle Pierre, les dames Adrien etc, etc…
***
Paris le 23 mars 1848
Je t’envoie mon cher père, ces deux brochures ; Dans l’une tu trouveras des détails intéressants sur la révolution de février ; Dans l’autre tu y verras des faits qui te sont déjà connus pour la plupart, mais qui offrent le grand avantage d’être racontés en quelque pages. Tu trouveras aussi une lettre de moi que j’adresse à votre société républicaine et que je te prierai de lire à la prochaine réunion. On nous a laissé croire un instant qu’il n’y avait pas d’examens semestriels, ce qui m’accommodait fort, mais il n’en sera rien, et je vais aller aujourd’hui ou demain à l’école, pour m’inscrire sur les registres des candidats.
Tu n’ignores pas que le numéraire est devenu fort rare par suite de la crise financière ; M. Bernard chez lequel je suis allé le 17 n’a pu me remettre qu’un billet de banque de 200 francs dont nous aurons été fort embarrassés, attendu qu’on ne les change pas, sans l’extrême obligeance d’un monsieur Berton ancien élève de mon oncle dont j’ai déjà eu occasion de te signaler la belle conduite à l’égard de ce dernier. Mais une fois que cet argent sera épuisé, comment pourrons nous en procurer de l’autre ? Seras-ce M. Bernard qui continueras à nous en fournir ? Vous savez probablement que la révolution de février vient de faire une brèche considérable à la fortune ? Si par hasard cet événement n’était point encore connu à Verdun, veuillez, je vous prie, n’en rien dire à personne.
L’Ami du peuple n’est pas le journal qui convient à votre société, car outre qu’il ne donne aucun détail sur les événements qui surviennent tant à Paris que dans les départements, ses articles, qui sont d’ailleurs parfaitement rédigés et vraiment inspirés par le plus pur républicanisme ne peuvent convenir qu’à des hommes déjà au courant des affaires publiques. Le journal qui conviendrait à la société, sous tous les rapports et auquel elle devrait s’abonner, c’est la Réforme qui a pour rédacteur Ferdinand Flocon, l’un des membres du gouvernement provisoire. Bien entendu que ceci n’a aucun rapport avec l’envoi que je te fais moi personnellement, du journal L’Ami du peuple que je continuerai à t’expédier comme préalablement.
Adieu très cher père et très chère mère, je vous embrasse de tout mon cœur en vous priant de croire à l’inaltérable affection de votre fils,
Amédée Jeandet
P.S. Des compliments de ma part chez nos parents et connaissances.
***
***
La lettre qui suit porte le tampon du 4 avril 1848. J’y ai adjoint deux notes, la première pour la compréhension de l’état d’esprit d’Abel Jeandet, la deuxième pour illustrer son engagement.
Mon cher frère,
Il y a une certaine fable intitulée les bâtons flottants, je ne l’ai jamais lue et cependant je crois la savoir depuis mon arrivée ici. Plus j’approchais de notre cher petit Verdun, plus l’édifice patriotique que j ‘avais élevé dans mon imagination s’évanouissait. Indifférence, tiédeur, hostilité même, voilà ce que j’ai rencontré. Pourtant nous n’avons pas cru devoir reculer, et avec l’aide de quelques républicains dévoués et ardents, bien rares il est vrai, tels que Guérin, Joseph, Auguste, Louis et tous les Jugnot en général nous avons pu agir. Le dimanche étant réservé à une séance de la société républicaine dont notre père a voulu me donner les honneurs en lisant mon discours du banquet (2), ma profession en public a été renvoyée au lendemain lundi après une cérémonie funèbre en l’honneur des victimes de la tyrannie.
J’ai prononcé du haut de l’orchestre un discours que j’ai écrit le matin et qui a été suivi de mon acte d’adhésion. Notre diable de maire était là. Le soir j’avais donné rendez-vous à quelques parents et amis politiques, eh bien de 5 ou six sur lesquels je comptais il en est arrivé près de 40. Le salon était plein. J’ai été bien sensible à cette démarche et je crois qu’ils ont été aussi satisfaits de moi je l’ai été d’eux. Je suis accablé d’écritures, le temps me presse, je t’embrasse de tout mon cœur et laisse à ma mère le soin de continuer ce brouillon et à toi celui de le déchiffrer.
Ton frère et ami ABEL
Le Capitaine Duvernay est un chaud républicain, Jeandet ferblantier a bien changé à son désavantage, ………. d’une froideur inexplicable, etc, etc…
Mon cher ami, ton frère est arrivé dans un état de maigreur effarant, je comptais qu’il allait se reposer un peu afin de se remettre de l’épuisement dans lequel il est tombé à force de parler. Eh bien non, il parle toujours. Dans ces moments de repos il ne fait qu’écrire ; nous n’avons put nous entretenir encore de rien et j’ai bien peur que cela dure jusqu’après les élections. Il est fâcheux mon Amédée que les parents n’aient point d’emprises sur leurs enfants. Si l’on nous eu écouté, ton frère ne s’occupant que de médecine, toi que de pharmacie, nous n’aurions pas eu tant de chagrin, et pire encore de plus grands ; car enfin que sait on ce qui peut arriver ; crois-tu mon cher ami que la position actuelle de ton frère n’est pas sans danger, s’il allait être nommé, sa vie ne serait-elle pas ….. ? aussi crois le bien, nous ne désirons pas qu’il ait les suffrages suffisants ; mais seulement beaucoup de voix pour le faire connaître à ceux qui disent qu’ils ne le connaissent pas. Le paquet que tu as remis à M. Thiaud n’est pas encore arrivé. Ton frère ne conçoit rien à cela, aussi va-t-il écrire quelques lignes à ce dernier.
Tu voudras bien nous dire mon ami quel jour tu es allé prendre les deux cents chez M. Bernard, et nous écrire plusieurs jours à l’avance quand tu auras besoin d’argent, il paraît que tu ne peux plus aller chez ton patron, il nous faudra te l’envoyer par la poste ou autrement cela prendra plus de temps, tu prendras tes précautions afin que tu ne sois pas sans le sous.
Je te recommande mon cher ami de ne plus faire de politique, occupe toi spécialement de tes affaires, j’ai assez de ton frère pour me causer bien du chagrin, qu’au moins tu ne te mêles de rien.
S’il arrive des lettres à ton frère retourne les de suite. Madame Adèle Colombet doit te remettre 83f80 cts tu iras les demander ou tu lui écriras de te les faire passer, c’est un compte arrêté entre nous.
Adieu mon cher ami, je t’embrasse de tout mon cœur, ton père et ton frère se joignent à moi
Annette Jeandet née Chapuis.
Notes de Jacques Fumey :
(1) - Le chameau et les bâtons flottants de Jean de la Fontaine
|
Le premier qui vit un chameau S'enfuit à cet objet nouveau; Le second approcha! le troisième osa faire Un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier : Ce qui nous paraissait terrible et singulier S'apprivoise avec notre vue Quand ce vient à la continue. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet, On avait mis des gens au guet, Qui voyant sur les eaux de loin certain objet, Ne purent s'empêcher de dire Que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devint brûlot, Et puis nacelle, et puis ballot, Enfin bâtons flottants sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde A qui ceci conviendrait bien : De loin, c'est quelque chose; et de près, ce n'est rien. |
|
(2)
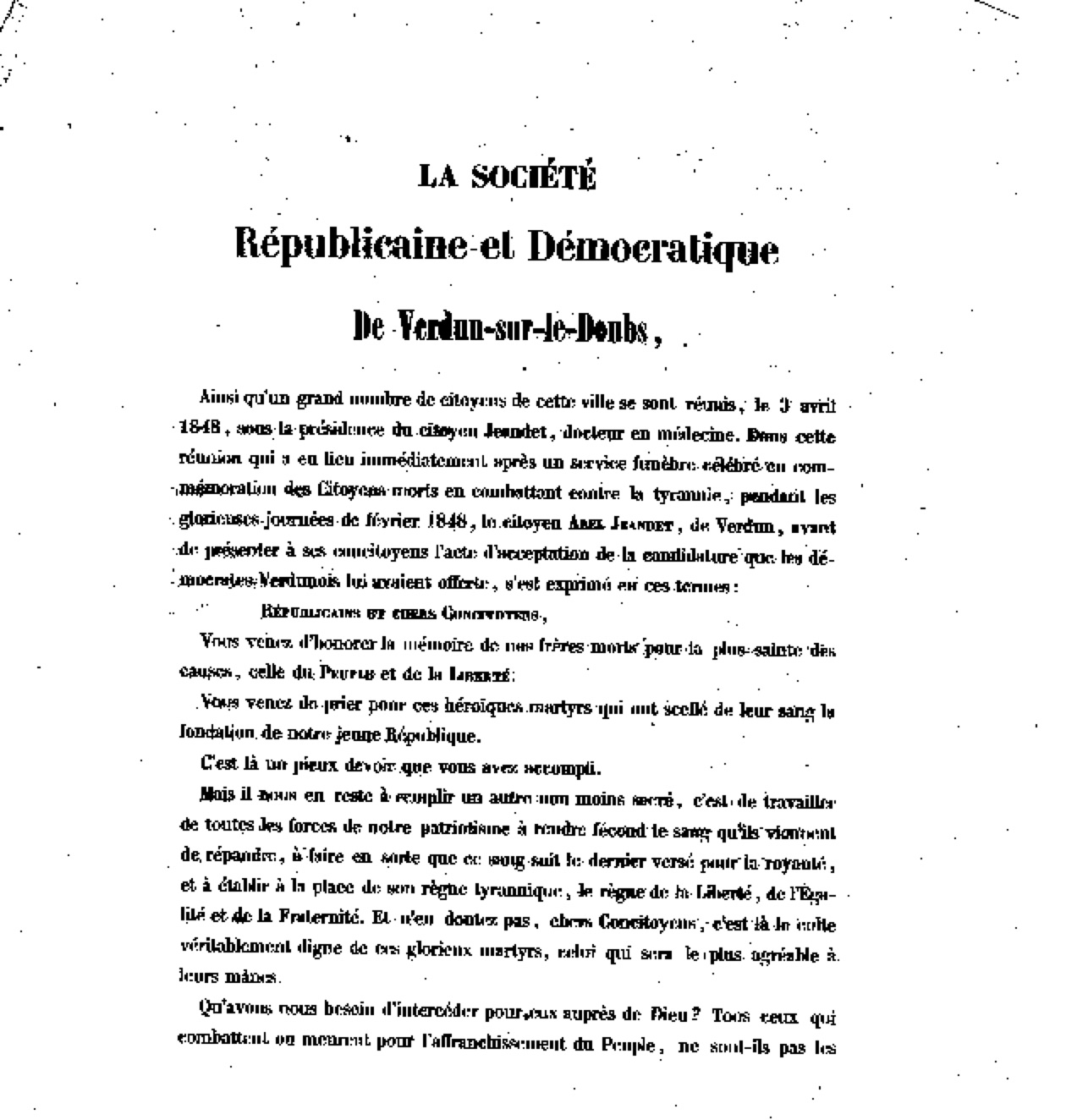
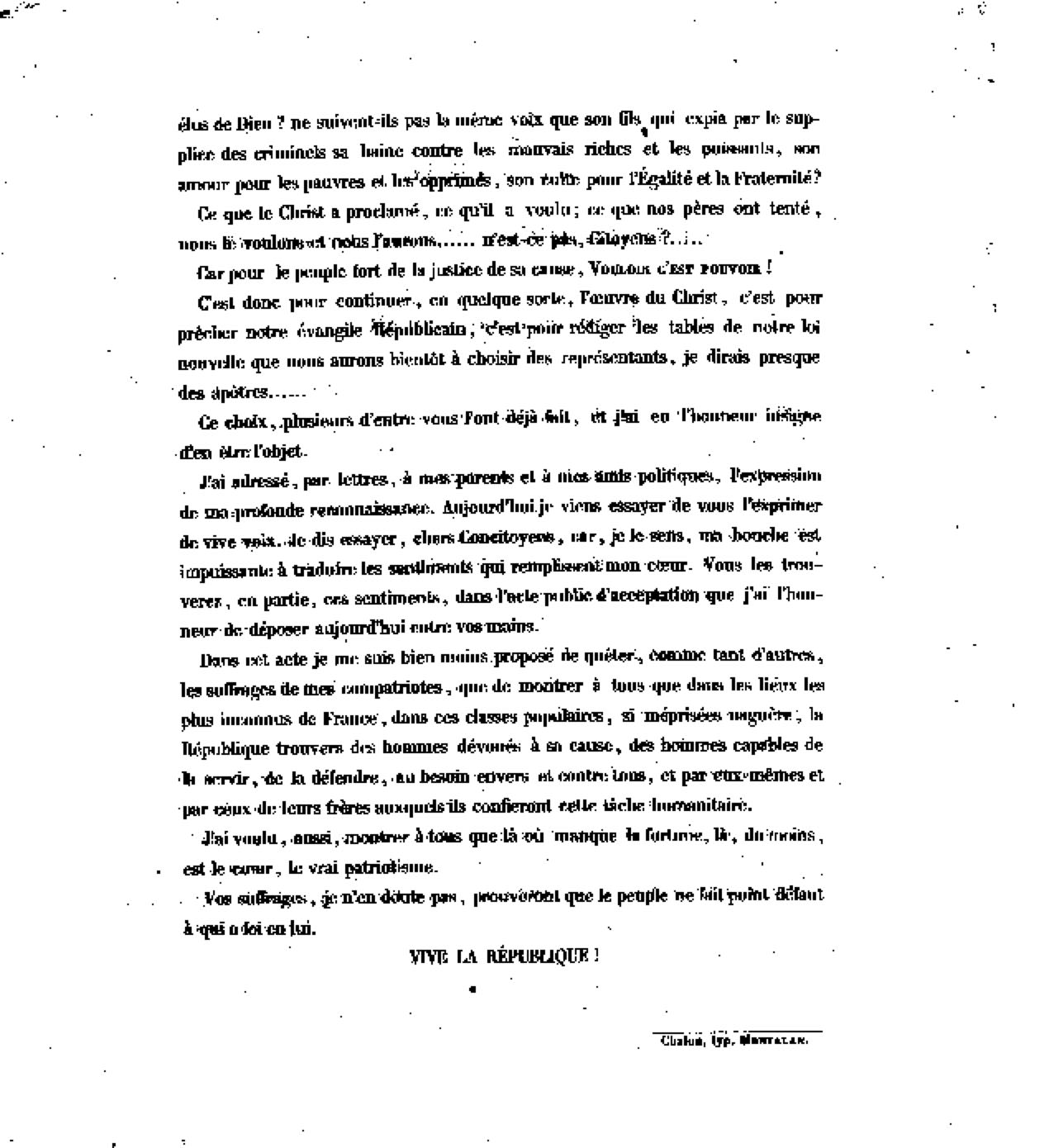
***
Paris 7 avril an 1° de la république
une et indivisible.
Très chère mère,
Je commençais à perdre patience et j’allais aujourd’hui ou demain au plus tard, écrire une lettre de reproche à mon pauvre frère qui a, dieu merci, déjà bien assez à faire, lorsque votre double épître est venue fort à propos pour me calmer. Enfin il me suffit de savoir, quant à présent, qu’Abel est arrivé sain et sauf et que maintenant il jouit de l’inappréciable bonheur d’être auprès de vous. Les réflexions que la situation présente de mon frère te suggère, chère mère, me paraissent fort sages ; sans doute il eut peut-être mieux fait, caché sous le manteau de l’obscurité, de s’adonner sérieusement à l’étude de son art pour aller ensuite vivre heureux et tranquille au milieu de vous, plutôt que de se laisser entraîner dans une carrière, bien digne d’envie en effet, mais à jamais fermée aux douceurs de la paix et où la vie s’use si vite, mais sic volure fata !... Du reste quoiqu’il arrive de tout cela et s’il est écrit là-haut qu’il doit succomber, eh bien ! Il sera encore beau pour lui d’être entrer dans la lice, et la défaite même, si défaite il y a, lui tiendra lieu de récompense !... Succomber lorsque l’on combat pour la sainte cause de la liberté, c’est presque un triomphe !!...
Quant à toi, mère bien aimée, te voilà heureuse, tu vas pouvoir entourer des soins les plus tendres, les plus empressés, l’un de tes fils et tu oublieras, au milieu de ces douces occupations, tes chagrins passés et ceux que tu redoutes pour l’avenir. Pourquoi faut-il qu’une cruelle nécessité me retienne loin de vous et me prive du bonheur de prendre aussi ma part aux joies de la famille ? La politique, chère mère, ne me fait nullement négliger mes propres affaires, il y a temps pour tout : et si je lis les journaux pour me tenir au courant des affaires publiques, si je descend parfois dans la rue pour désiler les yeux des citoyens qui sont encore imbus de ces principes surannés et tout à fait incompatibles avec l’état actuelle de notre civilisation, si enfin, il m’arrive de prendre part aux manifestations qui me semblent en valoir la peine, telle fut celle, par exemple, du 2 avril où la jeunesse de toutes les écoles est allée au champ de mars fraterniser avec les travailleurs en remuant avec eux le sol sacré de la patrie, tout cela dis-je, ne m’empêche pas d’employer utilement mon temps et d’être même assez satisfait : ainsi par exemple, me voilà débarrassé de l’examen d’avril, ces messieurs les professeurs, devenus fort obligeants depuis la révolution, ayant jugé à propos de le supprimer pour cette année en nous avertissant néanmoins que l’examen d’août aurait lieu inévitablement. Du reste de l’avis de tous, jamais époque ne fut plus propice pour passer les examens. Comme toujours, le compte de Madame Arf ??? est incompréhensible ; tu me dis je crois qu’elle doit me remettre 89 francs et des centimes, car le pain à cacheter m’empêche de lire nettement la somme dont il s’agit, et cette dame m’a envoyé le 31 mars, par son frère, 63francs70centimes ? J’aime à croire que le paquet confié au Général Thiard ne sera point perdu, car outre qu’il renfermait plusieurs brochures à Abel, moi-même j’y avais joint une histoire de la révolution de février ornée d’un beau portrait de Lamartine et destiné à mon papa, plus une petite notice sur Louis-Philippe. La première de ces brochures contenait deux lettres, l’une adressée à la société républicaine de Verdun, l’autre à mon papa et dans laquelle, tout en lui annonçant que j’avais reçu le 17 mars un billet de 200 francs de M. Bernard, je lui demandais précisément comment à l’avenir il nous ferait parvenir de l’argent. Actuellement j’ai encore 100 francs. Je me rappelle à l’instant qu’Abel m’a dit avoir reçu de Charles Colombard, il y a déjà quelque temps, plus d’argent que celui-ci n’en devait ; Cela étant, l’affaire ne peut manquer de s’éclaircir.
Adieu chère mère, je t’embrasse de tout mon cœur ainsi que mon cher père et vous prie de croire à l’affection inaltérable de votre fils
Amédée Jeandet
J’embrasse mon cher frère.
P.S. Des compliments de ma part chez l’oncle Pierre et aux personnes qui se souviennent de moi. Quant aux dames Adrien, je m’abstiens jusqu’à nouvel ordre et changement de décoration… Diable ! il n’y aurait pourtant guère moyen de nommer représentant du peuple, à l’assemblée nationale, feu leur frère et fils ?
***
Lettre d'Abel Jeandet à son frère Amédée du 25 avril 1848. Abel est à Verdun et Amédée à Paris;
Mon cher frère,
Tu aurais bien désiré, je n’en doute pas être tenu au courant de ce qui se passe dans notre pays ; J’aurais bien voulu, moi-même te faire ce plaisir, mais cela m’a été impossible. Les quelques lignes que je t ‘ai écrites, la lettre de notre mère et les imprimés que je t’ai adressés ont pu te mettre sur la voie. Les deux lettres ci-incluses te fourniront encore quelques données. Mais ce qu’elles ne t’apprendront pas, ce que tu ne pourras jamais croire, c’est l’état d’ignorance, de stupidité dans lequel nos paysans sont plongés, les moyens que l’on emploie pour les y maintenir et la tyrannie que l’on exerce sur eux à l’occasion des élections. Au milieu des déboires que mon républicanisme a du effrayé ici, il a trouvé cependant à force de travaux , quelques dédommagements. Le plus grand de tous, celui dont je conserverai toujours un doux souvenir, souvenir qui sera cher à tous mes amis, à tous les vrais patriotes, m’a été donné par les citoyens de la commune de Bragny. C’est une des belles pages de l’histoire électorale de 1848. Nous te la ferons connaître avec détails. Je veux te prier aujourd’hui, de porter à Vernet, rue Christine, hôtel du Rhône, la lettre ci-incluse. Tu cachetteras seulement celle qui est à son adresse. Je lui envoie mes pièces électorales moins mon auto acceptation dont tu lui porteras un exemplaire pour la société Démocratique centrale. Tu le trouveras chez lui le matin entre 9 et 10. Recommande lui de me faire obtenir une réponse ici pendant que j’y suis encore. Je commence à me reposer aujourd’hui, j’en ai grand besoin, depuis mon arrivée je n’ai cessé d’être souffrant ce qui ne m’a pas empêcher de parler et d’écrire continuellement. Pour te donner une idée de la bienveillance de certains verdunois à mon égard, je te dirai qu’on affirme que Galland a écrit à sa mère que pendant les journées de février nous sommes restés cachés ensemble. Tu lui apprendras cette nouvelle. Au revoir mon cher frère, je t ‘embrasse de cœur.
Abel jeandet
Le 3° père Duchêne ne me paraît pas de la force du second, cependant je te prie de m’en garder les numéros à propos de sanctions, celui de ……… m’injurie Mattey n’a pas donné signe de vie. Ces républicains aristocrates me font pitié.
***
Collège de Château-Thierry 4 mai 1848
Je pense, mon cher Amédée, que tu te portes bien, et que tu continues à travailler avec l’ardeur et la persévérance qui te caractérisent. Comme tu ne m’as pas écrit, depuis le départ d’Abel, j’en conclu que tu as vécu de ta vie ordinaire, et qu’il ne t’est rien arrivé qui méritait d’être raconté. A propos d’Abel, j’ai reçu une lettre de lui dimanche dernier ; il paraît que tu ne lui a point fait part de la missive que je lui avais adressée, et qui s’est croisée avec la sienne au moment de son départ. D’après les listes que j’ai vues, il n’est point compris parmi nos représentants à l’Assemblée Nationale ; Je le regrette non pour lui qui sera plus tranquille, mais pour la république et la liberté qui auraient eu un consciencieux défenseur.
Je t’ annonce, mon cher Amédée, l’arrivée d’Anna à Paris. Elle y sera demain ; Elle te prie de lui porter la petite somme dont tu es demeuré dépositaire, et elle t’attendra samedi jusqu’à midi à son domicile, rue Montaigne 32, Faubourg St Honoré ; Dans le cas où tu ne pourrais pas y aller dans la matinée, et où par conséquent tu serais exposé à ne pas la rencontrer, tu laisserais l’argent chez le portier.
Je ne te réitérerai pas mon appel pour t’engager à venir à Château-Thierry qui dans cette saison de l’année offre un délicieux paysage, je sais trop que ce serait prêcher dans le désert ; Cependant nous aurions eu bien du plaisir à te posséder avec nous pendant quelques jours.
Adieu, mon cher Amédée, nous t’embrassons tous,
Ton oncle affectionné
Chapuis
Bien des choses de ma part à Galland.
***
Paris 6 mai An 1° de la république
(16 floréal)
Très cher Oncle,
J’arrive de chez Madame Durand ou mieux Anna, chez qui j’ai trouvé M. et Mme Richard ; Pendant le peu de temps que j’y suis resté, j’ai essuyé une décharge à boulets rouges de blasphèmes contre notre sainte république. En vérité je vous en veux beaucoup de ne m’avoir pas prévenu, car je me serais couvert d’une double cuirasse au lieu de ma vêtir en pantalon de ??? et en habit noir comme j’ai eu la bêtise de le faire en cette mémorable occasion. Aussi suis-je tout meurtri des coups qu’on m’a porté, car quoique les décharges n’allaient point à mon adresse, il s’agissait de la république et comme la république est la mère de tous les citoyens, et que j’ai l’honneur d’être citoyen, je suis sorti de chez Anna l’esprit et le corps en marmelade. Du reste j’ai fait bonne contenance en présence de ce feu roulant formidable, et comme j’avais pour adversaires deux femmes aimables et spirituelles, j’ai du m’abstenir de tout controverse et écouter en souriant du bout des lèvres s’entend ce que je serais bien fâché de n’avoir point entendu puisque j’en ai profité pour m’entretenir quelques instants avec vous.
Comme vous le dites fort bien, mon cher oncle, il ne m’est rien arrivé d’extraordinaire, mais pourtant je n’ai point vécu de ma vie ordinaire ; Les événements qui s’accomplissent sous nos yeux ont une si haute portée, leur influence sur les destinées de notre patrie, doit être si décisive que je suis profondément ému de tout ce qui arrive, de tout ce que je vois, de tout ce que j’entends ! Je me dis : »tout ce qui se fait maintenant sera de l’histoire un jour et malheur pour qui faillira à l’œuvre, car il aura la postérité pour juge ! »
Il paraît, mon cher oncle, que vous n’êtes pas satisfait du journal de la commune de Paris, c’est cependant l’organe de la démocratie la plus pure et à l’heure qu’il est on ne saurait trop défendre cette grande cause. Cette feuille ne donne pas de roman-feuilleton, il est vrai, mais actuellement a-t-on besoin de ce pitoyable aiguillon pour chasser l’ennemi ? D’ailleurs il me semble que dernièrement, il donnait, sous forme de feuilleton l’histoire des arbres de la liberté du conventionnel Grégoire, ne vous semble-t-il pas que ceci vaut pour le moins autant qu’une causerie de M. Alexandre Dumas de la Pailleterie ?
Vous me parlez d’un voyage à Château-Thierry ? Moi aussi, mon cher oncle, je serais bien heureux de vous embrasser vous et ma tante, mais vous n’ignorez pas l’antipathie de mon pauvre cœur pour tout ce qu’on appelle voiture, et à moins de me transporter dans votre ville sur las ailes d’Icare, moyen peu sûr de voyager au dire de l’histoire, je dois rester ici quand à présent.
Adieu mon cher oncle, je vous embrasse de tout mon cœur ainsi que ma bonne tante et vous prie de croire à mon sincère attachement.
Amédée Jeandet
P.S. Embrassez pour moi Henry et si vous me faites l’amitié de me répondre, dites-moi si tout en apprenant les fables de votre compatriote Lafontaine, il apprend les deux odes patriotiques si belles qu’il est inutile de vous nommer.
***
Verdun le 8 mai 1848
Mon cher ami,
Le départ de ton frère étant retardé de quelques jours, nous prenons le parti de te faire passer par la poste 30 francs. Tu voudras bien m’accuser réception de suite. Je ne conçois pourquoi tu ne m’as pas écrit par Galland, tu sais mon bon ami combien j’ai de plaisir à lire tes lettres, les quelques lignes que tu mets sur les journaux ne me suffisent pas ; Ainsi une autre fois quand tu auras une occasion pour m’écrire j’espère que tu ne la manqueras plus. Tu ne peux te faire une idée de toutes les menées qui ont eu lieu pour les élections, plusieurs ……………………………………………………………………………….. , on leur a fait croire que si les listes n’étaient pas données tel que le garde champêtre les donnait à chaque électeur il leur arriverait malheur. Ton frère n’étant point porté sur les listes, puisque le comité n’a pas voulu l’accepter en disant qu’il était arrivé trop tard, cela a été cause que les personnes qui avaient promis leur appui se sont laisser gagner par les comités et n’ont point suivi ton frère comme ils l’avaient promis. Nous savions qu’il était impossible qu’il sorte n’étant point porté sur la liste des quatorze, mais si les soi-disant amis eussent servi ton frère comme d’autres candidats non portés, il devait avoir plus de deux mille voix, mais n’importe nous sommes contents, ton frère est connu et malgré toutes les cabales, il a eu à Verdun 633. Ce sont des voix libres, la commune de Bragny a voté entièrement pour lui. Il a encore eu dans d’autres cantons quelques voix mais peu de chose, partout on a été trompé. Il y avait dans le canton de Verdun quatre mille votants, cela lui fait une voix sur sept. Convient que ce n’est pas mal d’avoir un homme sur sept. On parle de renommer un ou deux représentant, c’est ce qui est la cause du retard d’Abel. Il attend aussi une de ce M. ?? il ne conçoit rien à son silence.
Les dames Adrien comme toujours ne lui ont rien dit sur les suffrages qu’il a obtenu. Je ne conçoit rien à leur conduite à notre égard aussi j’y vais très rarement, voilà trois semaines que je n’y suis pas allée.
Tu trouveras le bon ci-inclus pour te présenter à la poste afin de toucher les 30 francs annoncés. Il est dix heures, nous partons tous les trois pour aller déjeuner chez Oncle Pierre Jeandet et dans le pays de sa femme.
Adieu mon cher ami je t’embrasse de tout mon cœur ton père ton frère se joignent à moi.
Ta mère Annette Jeandet née Chapuis.
***
Paris le 10 mai an 1° de la deuxième république.
(20 floréal)
Très chers parents,
Selon le désir de ma bonne mère, je vous accuse de suite réception de la lettre et du billet qui est maintenant converti en belles et bonnes espèces. En vérité je trouve étrange que mon frère s’occupe encore d’élections et de candidatures ? je vois que ce pauvre ami se croit encore en république quoique cependant il devrait être suffisamment renseigné sur ce point par La Réforme. Que lui importe qu’il y ait encore un, deux et même trois représentant à élire ! L e tripotage hideux dont il vient d’être témoin aux élections dernières ne lui montre-t-il pas clairement que c’est un parti pris d’exclure les républicains partout où ils se présenteront et que quand à présent la révolution est arrêtée dans sa marche ! il agirait donc sagement s’il renonçait à l’espoir de devenir homme politique, pour rentrer dans la vie privée où avec ses capacités et ses qualités personnelles, il pourrait selon moi, servir encore utilement ses concitoyens. Sans doute le théâtre est moins vaste, vos actions, quel qu’en soit le mérite, ont paru au même point de l’attentissement, mais qu’importe , on a été utile quand même et il serait bientôt temps que la trompette de la renommée ne soit plus l’aiguillon qui pousse l’homme à faire du bien. D’ailleurs lorsque l’on envisage sérieusement la composition de l’assemblée nationale, on doit moins regretter de n’y point siéger : en effet que voyez-vous dans cette assemblée que je n’appellerai pas nationale ? vous voyez des évêques, des curés, des abbés, des dominicains en froc blanc, des néo-catholiques, des royalistes de toutes les nuances, des républicains aristocrates et enfin quelques démocrates qui, apparent rari nantes in gurgite vasto *! Est-il possible, je vous le demande, que ce grand corps, dont toutes les parties sont si disparates, puisse fonctionner convenablement ? Non certes, du reste le vote d’hier ne laisse plus aucun doute aux amis de la démocratie ; La question de la royauté a été gagnée dans la séance d’hier ; L’assemblée a décidé qu’une commission exécutive de cinq membres, un directoire indépendant, serait nommé au scrutin, que cette commission choisirait les ministres et gouvernerait la France. Trois ou quatre membres seulement parmi lesquels Barbes et Félix ??? se sont levés pour protester contre cette violation du principe républicain, qui distrait de l’assemblée le pouvoir exécutif ! Nous allons donc avoir cinq rois au lieu d’un seul. Quand à l’assemblée que devient-elle ? une fabrique de lois plus ou moins antipopulaires, car un directoire, un consulat, une présidence, en un mot tout pouvoir distinct de l’assemblée nationale, autre que les agents ministériels, n’est ce pas la négation de la souveraineté de l ‘assemblée et par suite de la souveraineté du peuple ? La république étant une et indivisible, ne doit-elle pas être représentée par une assemblée une et indivisible ?
Pour moi j’ai la tête cassée de tout ceci. J’avais la simplicité de me croire en république et j’avais écrit en conséquence à trois journaux différents, et à peu de jours de distance trois lettres inspirées par le plus pur patriotisme, mais ces journaux ne les ayant point insérées, j’en suis pour ma peine et 4 francs d’affranchissement que j’aurais mieux fait de porter au bureau de la souscription ouverte en faveur de nos frères les ouvriers de Rouen mitraillés par les aristocrates-bourgeois !!!
Je m’ennuie considérablement ici ; les cours sont déserts, on travaille avec nonchalance et la politique semble avoir tout absorbé. Aussi est-ce avec peine que je me vois contraint de rester jusqu’à fin août. Mais dussé-je m’ennuyer encore davantage, je resterai jusqu’à cette époque, préférant en finir pour m’en aller une bonne fois et ne pas revenir derechef.
La conduite des dames Adrien devient de plus en plus comique ; pourtant je commence à y voir quelque chose de plus et si j’étais à la place d’Abel, je m’abstiendrai incontinent de franchir le seuil de leur maison.
Adieu mon cher papa et ma chère maman, je vous embrasse de tout mon cœur ainsi que mon frère et je vous prie de croire à mon inaltérable affection.
Amédée jeandet
P.S. Des compliments chez l’oncle Pierre et à toutes les personnes qui se souviennent de moi. Quand à ce qui concerne Vernot, Abel n’a qu’a relire ce dis à ce sujet au bas de je ne sais plus quel journal ? Il fait très chaud ici depuis quelques jours et je commence à endurerle supplice de Tantale en présence de ma carafe et de mon pot plein d’eau tiède ! ô mon pauvre vin blanc, si pétillant, si frais ne viendras-tu pas me trouver dans ma mansarde solitaire !
* De rares naufragés flottent sur le vaste abîme.
***
Paris le 28 floréal, an 1° de la deuxième république.
(18 mai 1848)
Mon cher Abel,
Combien écris-tu de lettres par jour ? Combien donnes-tu d’audiences ? Combien prononces-tu de discours ? Il me tarde de savoir à quoi m’en tenir là-dessus, car je m’expliquerai alors ton indifférence à mon égard. Néanmoins en attendant te réponse ou ta personne, je vais te dire, selon mon gros bon sens et sans m’occuper de l’opinion des journaux ce que je pense de la journée du 15 mai.
L’échauffourée du 15 mai* fera, à mon avis un très grand tort à la démocratie et le triomphe de la cause populaire est peut être ajourné pour longtemps ! Les réactionnaires, les esprits rétrogrades, les bourgeois-aristocrates vont relever la tête plus que jamais ; ils vont au nom de la république et de la souveraineté du peuple dont ils se disent les représentants, confisquer insensiblement, au profit des bourgeois, une révolution à laquelle ceux-ci n’ont pris aucune part et qui a été faite par la classe populaire vraiment indigente et malheureuse. La calomnie, l’arme ordinaire des jésuites et des cagots, va présenter aux yeux des citoyens, sous les couleurs les plus noires, Barbès, Raspail Blanqui et autres ; Ils seront déclarés mauvais citoyens, ennemis du peuple, traître à la Patrie ! ce sont là des mots ronflants qui sonnent bien et il n’en faut pas davantage pour persuader les imbéciles.
Je conviens, du reste, que les hommes qui sont maintenant sous les verrous victimes de leur dévouement à la cause populaire , sont bien coupables et bien à plaindre : ils sont bien coupables d’avoir compromis par une tentative inconsidérée et dont il était facile de prévoir l’issue, la cause démocratique qui est celle de tous les vrais républicains et qui se trouve maintenant à la merci d’une assemblée dont l’élément est essentiellement bourgeois et aristocratique ; ils sont bien à plaindre, parce que selon moi, leurs intentions étaient pures et qu’ils ont en quelque sorte été forcé d’obéir à la volonté impérieuse de la foule. Il va sans dire que la journée du 15 mai sera présentée à la nation comme le résultat d’une conspiration depuis longtemps organisée, et que la manifestation en faveur de la Pologne n’était qu’un vain prétexte pour mieux masquer le complot . Quand à moi, qui faisait partie de la manifestation, je pense tout différemment et je crois que tout ce qui est arrivé n’était pas arrêté d’avance. Ce qui me confirme dans cette opinion, c’est que Barbès, Raspail, Blanqui et Sobier n’en sont pas à leur coup d’essai, et qu’avant de s’engager dans une telle entreprise on doit d’abord sonder le terrain, se ménager des partisans, et leur donner le mot d’ordre, chose qui aurait été faite à Barbès en raison de sa popularité dans la douzième légion dont il était le colonel ; eh bien !ils n’ont rien fait de tout cela. Je te ferai surtout remarquer que les 400000 citoyens qui ont pris part à la manifestation étaient sans armes. Depuis lundi soir jusqu’à aujourd’hui, la garde N. a stationné dans les rues et sur les places publiques. La 11° er la 12° légion qui sont composées d’un grand nombre d’ouvriers, n’étaient pas les moins empressées : ils étaient là, l’arme au bras, ces braves prolétaires ne se doutant que c’était leur propre cause qui venait de succomber !Dévouez-vous pour le peuple, sacrifiez votre fortune, votre repos, votre liberté, comme l’a fait Barbès, Raspail, Blanqui, Hubert et Sobier, pour être poursuivis par ceux là même que vous voulez affranchir et condamnés ensuite au nom du peuple français à pourrir dans un cachot !Leur tentative est inqualifiable in-politique, ceci est incontestable, mais en définitive pourquoi le peuple a-t-il envahi l’assemblée nationale et chassé son président ? C’est parce que l’assemblée, composée de plus de 200 députés dynastiques y compris la commission des cinq, excepté Ledru-Rollin, n’est pas républicaine ou du moins veut à l’exception d’un certain nombre de représentants, une république entourées d’institutions monarchiques ou mieux le gouvernement de Louis-Philippe moins le nom et la forme ; c’est parce que cette assemblée paraît oublier que la révolution de février est toute sociale et que le peuple ne veut pas que tout en lui parlant sans cesse de sa souveraineté et en inscrivant sur les étendards liberté, égalité, fraternité, la bourgeoisie, de même qu’en 1830 escamote une révolution pour laquelle elle n’a pas brûlé une cartouche. C’est qu’enfin le parti jésuistique et catholique compte plus d’un partisan dans cette grotesque assemblée et qu’il est temps que le règne de la franchise de la candeur et de la vérité prennent la place de l’astuce, de la ruse et de l’hypocrisie. Je termine concluant que l’échauffourée du 15 mai est d’autant plus regrettable qu’elle aura une influence funeste sur les prochaines élections, qui sans cela auraient peut être été révolutionnaires. Quand à vous Barbès, Raspail, Blanqui, Sobier, Hubert et d’autres, pourquoi n’avez-vous point attendu ? Il fallait laisser fonctionner l’assemblée quand même ! et vous réserver pour l’avenir. C’est là à mon avis , le seul reproche que peuvent vous adresser les républicains démocrates !
Amédée Jeandet
*La manifestation du 15 mai 1848 les élections d’avril 1848 avaient entraîné l’élection de nombreux républicains du lendemain, hostiles aux réformes sociales.
A cette date, de nombreux républicains de la veille n’acceptaient pas l’attitude conservatrice de nombreux députés, pas plus que l’immobilisme du ministère des Affaires étrangères face aux insurrections qui avaient éclaté dans toute l’Europe.
Les républicains les plus radicaux décidèrent alors d’organiser une manifestation le 15 mai 1848, accompagnés de nombreuses délégations étrangères (Italiens, Polonais, etc.).
150 000 manifestants, réunis à la Bastille, marchèrent donc vers la place de la Concorde, sous le prétexte de présenter une pétition à l’assemblée demandant le soutien aux patriotes polonais.
Mais vers 13 heures, les manifestants envahirent le Palais Bourbon, siège de l’assemblée. Ces derniers, ne rencontrant pas d’opposition armée, envahirent alors les lieux dans un chaos indescriptible. Lamartine, tentant de rétablir l’ordre, fut alors hué, certains émeutiers réclamèrent le rétablissement de la Terreur, l’envoi d’une armée pour la Pologne, ainsi que la création d’un impôt sur les riches.
Toutefois, les députés refusant de délibérer avant que le Palais Bourbon soit évacué, un des manifestants, nommé Louis Huber, proclama la dissolution de l’assemblée.
Les manifestants formèrent alors à la hâte un gouvernement insurrectionnel (composé d’Armand Barbès, Louis Blanc, Ferdinand Flocon, Alexandre Martin (dit l’ouvrier Albert.), et Alexandre Ledru-Rollin.), puis se rendirent à l’Hôtel de ville. Lamartine et Ledru-Rollin, membres de la commission exécutive, envoyèrent la Garde nationale déloger les manifestants de l’Hôtel de ville. Ainsi, les principaux chefs républicains furent arrêtés (Louis Huber, l’ouvrier Albert, Louis Auguste Blanqui et François Vincent Raspail furent condamnés à de lourdes peines de prison.) ; Marc Caussidière, préfet de Paris et républicain de la veille, fut démis de ses fonctions ; enfin, le vicomte Amable Gaspard Henri de Courtais, commandant de la Garde nationale, fut écroué pour n’avoir pas réprimé plus tôt la manifestation.
***
Je n’avais pas répondu à ta lettre , mon cher Amédée, parce que j’en attendais une de ton frère à qui j’avais écrit en Bourgogne, et dont je croyais le retour à Paris extrêmement prochain. Mais les jours, les semaines et les mois se passent, sans que j’entende parler ni de lui, ni de toi. Ce silence nous inquiète d’autant plus que depuis la funeste journée du 15 mai, nous sommes ici constamment sur le qui vive, relativement à Paris. Une crainte vague, indéfinissable règne dans les esprits. A l’activité fiévreuse des premiers jours de la révolution, on a vu succéder une irrésolution, une inertie que rien n’explique et qui compromet tous les intérêt. L’assemblée nationale devait sauver la France, et cette assemblée vers laquelle se tournaient tous nos regards, tous nos vœux, toutes nos espérances, semble prendre ???? en débats stériles, tandis que la patrie menacée d’un côté par les factieux de la démagogie, de l’autre par les factieux de la royauté aînée ou cadette est fatalement entraînée vers une dissolution, dont ne veut pas cependant quiconque sent battre dans sa poitrine un cœur d’homme, de français et de citoyen.
Voilà ce qui nous épouvante lorsque nous attendions des nouvelles de Paris et surtout quand nous n’en recevons pas.
Tiens toi à distance, mon cher Amédée, des énergumènes qui rêvent le retour heureusement impossible de la sanglante tyrannie de 1793. Repousse comme des traîtres les esclaves qui voudraient encore courber la France sous la verge royale, et écris-moi, ce que tu fais, ce que tu veux faire , ce que fait ton frère, s’il est ou non à Verdun, et comment se trouvent ton père et ta mère au milieu de ce mouvement désordonné, que jusqu’à présent la sagesse de nos législateurs régularise par des canons et des baïonnettes absolument comme les fossiles assis sur des troncs. Adieu, je t’embrasse ou plutôt nous t’embrassons tous,
Ton oncle affectionné
Chapuis
Collège de Château-Thierry, 24 mai 1848
***
Paris le 8 prairial (27 mai) an 1° de la 2° république.
Très chère mère,
Je ferai peut être bien de ne pas t’écrire. Car pourquoi répondre à des pleurs par des pleurs ? Pourquoi gémir avec celui qui gémit ? Un semblable langage te surprendra n’est-ce pas ? Tu crains déjà de tristes nouvelles. Mon dieu ! il n’y a rien du tout ; seulement je me trouve aujourd’hui (je ne sais pourquoi) dans une disposition d’esprit toute particulière et à laquelle nous sommes tous plus ou moins sujets. Il y a des jours où l’on est content et joyeux ; il en aient d’autres où l’on est entraîné forcément vers des pensées tristes et mélancoliques. De même que la nature est tantôt riante et belle, tantôt triste et aride, de même le cours de la vie est marqué tantôt par la joie et le plaisir tantôt par le découragement et la douleur ! L’homme aime les contrastes : tout ce qui rappelle l’uniformité et la symétrie lui déplaît. La nature ne nous semble belle, qu’autant qu’elle s’offre à nous, sous mille aspects divers. Eh bien ! il en est de même de l’existence humaine, l’on finit aussi par se lasser d’une vie monotone et matérielle, qui n’offre rien de tout ce qu’on avait rêvé et où les jours s’écoulent un à un sans laisser dans l’âme ni plaisir ni regrets !
Tu sembles vivement affligée, ma bonne mère, de l’indifférence, ou, pour mieux dire de l’ingratitude des verdunois à l’égard d’Abel. Je conviens qu’ils auraient du tenir compte à mon frère de toutes les peines qu’il s’est données pour porter la lumière dans leurs esprits grossiers, mais est-ce une raison pour faire de cela une affaire si importante, et pour prendre une résolution qui, outre qu’elle paraîtrait ridicule et semblerait accuser de votre part une sorte de dépit, pourrait en changeant vos habitudes, compromettre votre bien être. D’ailleurs, chère mère, si c’est pour fuir les égoïstes, les intrigants, et les mauvaises langues, que tu tiens à quitter Verdun, je te demanderai où tu comptes nous conduire ? Je ne vois guère de villes, de bourg, de villages, dans toute l’étendue de la république, qui ne nous offrent exactement le même tableau que Verdun. Nous pourrions, il est vrai, transporter nos pénates dans quelques îles inconnues aux peuples civilisés, ou bien encore partir avec le citoyen Cabet pour l’Icarie, ce qui me sourirait assez, mais jusqu’à nouvel ordre, renonce à ce projet, ma chère mère, laisse dire et egir les ilotes de Verdun et surtout cesse de t’affliger comme tu le fais ; Il ne faut pas désespérer de l’avenir et du salut de la république.
Adieu ma chère maman, je t’embrasse de tout mon cœur ainsi que mon cher papa et vous prie de croire à l’inaltérable affection de votre fils.
Amédée Jeandet
P.S. Des compliments chez l’oncle Pierre et aux autres personnes qui se souviennent de moi. Le pharmacien philippiste de St Laurent est-il rentré dans sa maison ? S’il voulait se défaire de la pharmacie, il ne serait pas impossible que je puisse m’y établir au mois de septembre prochain.
***
Le 7 juin 1848
Si j’étais bien sûr, mon cher Amédée, que cette lettre ne fut jamais lue que par toi, je te demanderais pardon d’avoir été si longtemps à t’écrire. Ma gravité de père en souffrirait moins qu’ l’indulgence d’un fils. C’est pour ménager celle ci et ne pas rendre l’autre ridicule peut être aux yeux des étrangers que j’entre en matière sans autre préambule.
Je te remercie de tout ce que tu m’as envoyé depuis la révolution de février. Si tu as accueilli avec moins d’enthousiasme qu’un autre les événements qui ont accompagné cette ère nouvelle, c’est que tu as mieux jugé de leur avenir. Peu de jours ont suffi pour te donner raison. Je n’y ai pas été pris longtemps moi-même. Nos premiers hommes d’état laissaient facilement deviner, par leurs antécédents, quelles seraient leurs œuvres, mais ils sont encore allés plus loin qu’on le pouvait prévoir. Dire aujourd’hui où ils s’arrêteront serait chose impossible. Nos aristocrates de Verdun, fort nombreux comme partout ailleurs, le savent pourtant : pour les uns c’est le régent Louis-Philippe, pour d’autres la restauration légitimiste, et pour le peuple enfin, ainsi que tu verras par les votes qui sont sortis ici, un Napoléon avec un 18 brumaire. Il y a-t-il un moyen terme, je l’ignore, pas plus que s’il nous restera quelques fragments de cette république, malgré nos vivats et les vôtres ? Tout esprit naturellement positif ne s’inquiétera que médiocrement de tout cela. Je t’en félicite. Et à quoi servirait, en effet l’expression de nos vœux, de nos besoins, de nos misères même en présence d’une force permanente et en armes qui nous comprime et nous étouffe. Fais comme moi, mon cher ami, mets ton frein dans l’isolement, et attends des jours meilleurs, s’il en peut venir, après les vains efforts que nous avons si souvent faits pour les ?? et les ???
Chacun a été tellement détourné de sa voie ordinaire par ce qui s’est passé depuis trois mois, qu’on se cherche sans se retrouver. Nous sommes dans ce cas. Tu ne nous dis rien de tes études. N’as-tu donc eu nulle velléité de te présenter à l’examen du baccalauréat ? Sans ce titre quelle sera plus tard ta position ? Penses-tu avoir fini au mois d’août et ne plus être obligé d’aller à Paris ? ta réception alors aurait lieu en province et tu perdras la faculté de te placer où bon te semblera. C’est toujours une chose fâcheuse et que nous ne devrions subir que dans l’impossibilité de faire mieux. écris-moi longuement sur tous les objets, et, si dès à présent, tu comptes venir près de nous aux vacances prochaines pour ne nous quitter qu’en vue d’un établissement en pharmacie.
Les temps sont infiniment plus durs que je ne les ai jamais vus. La clientèle est presque nulle. On ne reçoit pas un sou. Ton frère a du te donner de l’argent pour les mois de juin et juillet. Il faut l’un et l’autre en être ménagers. J’ignore entièrement où j’en prendrai quand vous en aurez besoin. Tout le monde ici est dans le même cas. On ne fait rien, on ne gagne rien, la crise est générale et elle s’aggrave des craintes qu’impose le retour de l’hiver après la belle saison passée sans travail.
Adieu, mon cher fils, réponds nous sans retard. Ni toi ni ton frère ne nous laissez pas trop attendre de vos nouvelles.
Ton affectionné père Jeandet
P.S. Si tu veux savoir quelque chose de nos élections, lis la lettre destinée à ton frère et qui se trouve sous le même pli.
***
Chemin de fer Meaux, le 7 juin 1848
de
Paris à Strasbourg
Service de la voie
1° Arrondissement
3° section Mon cher Amédée,
Je pense aller vous voir samedi prochain. J’arriverai à Paris vers 6h1/2 par le bateau poste. Si cela ne vous dérange pas trop, je vous proposerai de m’attendre pour dîner.
Bien des choses à Mr Abel et à Désiré
Tout à toi
G LEGUFF
***
Paris 9 juin 1848 et an 1° de la République
Très cher Père,
Maintenant que j’ai reçu ta lettre, j’ai oublié combien de temps elle s’est fait attendre et ne songe plus qu’à t’en remercier de tout mon cœur.
Seulement il y a dans ton épître une chose qui me chiffonne, comme dirait le père Duchêne, c’est que si on jugeait ce que je suis en politique d’après le langage que tu m’y tiens et le rôle que tu sembles me faire jouer, l’on aurait de moi une opinion complètement fausse et surtout bien peu honorable pour un jeune homme. Je t’avoue que je m’étonne de cette méprise, mon cher père, car soit par la couleur politique des journaux que je t’envoie, soit par mes précédentes lettres et surtout celle que j’adresse à Abel le 17 mai derniers les évènements du 15 du même mois, il est aisé de voir ce que je suis et ce que je ne suis pas.
Sans doute moi pauvre citoyen obscur, ignoré et inconnu à tous, je ne puis rien ou du moins peu de chose pour le triomphe de la Cause Sainte, mais quoiqu’il arrive je ne changerai jamais ! Ce que j’écrivais sur les rois avant la R évolution et sous le règne de Philippe, je l’ai écris à Raspail alors que la réaction commençait déjà à relever la tête. Lors même qu’un prétendant quelconque ressaisirait le pouvoir, pour un temps indéterminé, ceci ne prouverait nullement que nous avons tort et qu’ils ont raison; Je n’en dirai pas moins avec Grégoire, que les rois sont dans l’ordre moral ce que les monstres sont dans l’ordre physique ; Je n’en continuerai pas moins à avoir en grande estime la mémoire de tous les révolutionnaires ennemis des rois , depuis Jésus Christ jusqu’à Robespierre , depuis Robespierre jusqu’à Thibaut !!
Les élections sont terminées. Malgré les manœuvres du parti réactionnaire et le peu d’accord qui existait entre les travailleurs, dont plus de la moitié n’ont pas voté, quatre noms éminemment révolutionnaires sont pourtant sortis de l’urne; ce sont Caussidière, Lagrange, Pierre Leroux et Proudhon; les deux premiers sont des républicains démocrates fortement trempés; quand aux derniers ce sont, comme tu le sais , des philosophes socialistes de premier ordre. Malheureusement à coté de ces hommes d’élite, viennent figurer les noms hideux de Thiers et de Victor Hugo ! quoiqu’il en soit la nomination de Leroux et Proudhon à Paris, les nombreux suffrages obtenus par ???? Raspail et Cabet sont à mon avis autant d’énergiques protestations en faveur du socialisme et des patriotes du Donjon de Vincennes. Les détails que tu me demandes au sujet de mes études , mon cher père, j’ai déjà eu l’occasion de te les donner plusieurs fois ; relis toutes mes lettres à partir du mois de janvier et tu verras que je m’explique clairement sur la question des vacances . Quand au baccalauréat je ferai tout ce que je pourrai pour m’en dispenser et si j’y parviens , je remercierai encore la loi qui, pour toute punition , m’imposera l’obligation de me choisir un gîte dans un département qui a en superficie 852.243 hectares et une population de plus de 500.000 habitants.
Amédée Jeandet
P.S. Je suis curieux de savoir comment le citoyen Dupaty a pu constater que lui et sa suite habitent depuis 6 mois dans le canton . Vraiment il est honteux de voir des gens qui s’appellent comme il faut se conduire de la sorte.
***
Paris 28 juin 1848
Rassurez vous très chers parents, la vie de vos enfants est sauve ! Après quatre jours de carnage pendant lesquels l'humanité a reculé de quatre siècles, l'ordre règne dans Paris comme sur les bords de la Vistule !! C'est le lundi 26 que le pouvoir a triomphé au faubourg Saint Antoine dernier retranchement des insurgés et de la démocratie. Voilà le problème social résolu, toute réforme concernant les travailleurs devient sinon impossible du moins inutile ; c'est la vieille société qui va reprendre le dessus, et le flambeau de la vérité et de saine philosophie qui commençait déjà à éclairer les intelligences, après un semblable cataclysme rentre dans les ténèbres encore pour cinquante ans. Je ne vous dirai pas, mes chers parents, ce que nous avons souffert, mon frère et moi, pendant ces quatre jours d'agonie et d'angoisse !.. Chaque coup de canon, chaque coup d'arquebuse, nous faisait une blessure au cœur, car pour nous qui ne comprenons pas l'insurrection ….. on s'efforce maintenant de le faire comprendre, c'était ….... un prolétaire qui tombait pour avoir voulu la réalisation de ces deux mots de la devise républicaine égalité, fraternité !! Maintenant mes chers parents ai je besoin de vous dire ce que j'éprouve! ai je besoin de vous dire que le séjour à Paris m'est devenu plus que jamais insupportable , Depuis les derniers événements et que j'attends avec impatience le moment ou je pourrai m'éloigner d'une ville dont chaque rue retrace à l'esprit autant de champs de bataille ou le sang français a coulé à flot !
Adieu mon cher père et ma chère mère je vous étreints de tout mon cœur et vous prie de croire à l'inaltérable affection de votre fils,
Amédée Jeandet
***
Paris le 13 juillet (Messidor) 1848.
Très cher père,
Nous avons reçu hier ta lettre qui nous annonce votre heureuse arrivée. Ai-je besoin de te dire que nous l’attendions avec une vive impatience et combien il nous tardait de vous savoir rentré chez vous après un voyage assez long pour devenir fatiguant et même pénible pour qui se trouve comme toi dans une position exceptionnelle. Maintenant, mes bien-aimés parents, que vous voilà de retour, reposez-vous longuement de vos fatigues et surtout soyez sans inquiétude sur notre compte ; Car Paris, vous l’avez vu par vous même, est on ne peut plus tranquille : au bruit du canon et de la fusillade a succédé un calme profond ; à la vérité, c’est un calme qui attriste l’âme, qui serre le cœur, c’est le silence de la tombe !!.......
Tu ne nous aurais pas dit dans ta lettre, cher père de vous écrire de suite, que j’allais néanmoins le faire pour le motif que voilà : il s’agit tout simplement de faire copier à la mairie mon acte de naissance et de me l’envoyer le plus tôt possible pour le joindre aux autres pièces justificatives que je dois adresser au ministre et sans lesquelles il ne peut rien statuer sur ma demande. J’avais d’abord songé à réclamer celui qui est déposé à l’école de pharmacie, mais le secrétaire m’a positivement déclaré qu’il ne pouvait m’être rendu et qu’il restait dans les archives de l’école.
Je n’ai rien de nouveau à vous apprendre, si ce n’est que je commence à consulter bien souvent mon calendrier et que je marque avec bonheur d’un point blanc chaque jour qui s’écoule !
Adieu très chers et bien-aimés parents, je vous embrasse de tout mon cœur et vous prie de croire à l’inaltérable affection de votre fils
Amédée Jeandet
Mon frère se joint à moi
P.S. Des compliments chez l’oncle Pierre et aux autres personnes qui se souviennent de moi
***
Verdun le 16 juillet 1848.
Tu trouveras ci-inclus, mon cher Amédée, ton extrait de naissance, dûment certifié . Le besoin que tu en as me fait présumer que cette pièce manquait à celles que tu as envoyées au ministre et qu’on te la demande. J’ai conclu également que tu as reçu une réponse. Mais comment se fait-il que tu ne m’en dis rein ?
Depuis notre retour je n’ai fait aujourd’hui qu’un voyage. C’était à Gorgy. J’en arrive à l’instant même. Durant toute cette course que j’ai pourtant faite de grand matin et à la fraîcheur, j’ai uriné beaucoup de sang et j’ai éprouvé et j’éprouve encore des besoins incessant d’uriner suivi de douleurs incessantes dans le canal. Décidemment c’est là une infirmité qui ne doit finir qu’avec moi.
Ton frère et toi en sentirez la nécessité de presser la conclusion de vos études. Je prie Abel surtout d’avoir sans cesse devant les yeux, à cet égard, ce déplorable état qui d’un jour à l’autre peut me réduire à néant. On a paru ici prendre généralement intérêt à nous qu’au moment où nous sommes partis pour Paris. On s’est enquis de la lettre qui est arrivée le lendemain de notre départ. Toutefois personne n’est venu nous voir sinon nos parents.
Adieu, mon cher fils, dis à Abel de nous écrire bientôt, ton très attentionné père
Jeandet
***
Paris le 20 juillet 1848
Monsieur le Directeur,
C’est comme élève de l’école de pharmacie de Paris et à titre d’auditeur de votre cours que j’ai eu l’honneur de suivre pendant deux années que je prends la liberté de vous écrire.
Retenu loin de ma famille déjà depuis longtemps, mes parents qui habitent une province éloignée de Paris, me pressent surtout depuis les évènements de juin de retourner le plus tôt possible près d’eux; Comme les cours de l’école vont finir très prochainement , je vais, Monsieur, vous demander si je ne pourrai pas obtenir dès à présent mon certificat d’étude, qu’on ne délivre ordinairement que dans les premiers jours d’août.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur , l’assurance de la plus huate considération de votre très humble serviteur .
Amédée Jeandet
***
Paris 21 Août 1848,
Mon cher frère,
L’arrivée de ta lettre ne m’a point surpris, je prévoyais ta juste impatience ainsi que celle de nos excellents parents. Chaque jour je formais le projet d’y satisfaire, et cependant je viens de laisser passer encore deux jours avant de te répondre. Bien que diverses circonstances, le séjour de notre oncle à Paris, et un peu de je ne sais quoi qui doit être de la paresse ou une grande ressemblance avec elle, ne m’aurait guère permis d’écrire plutôt, j’aurais néanmoins hâté le départ de cette lettre, si je ne vous avais donné signe de vie ces jours derniers par l’envoi de deux journaux.
Juge, mon cher frère, de la contrariété que j’ai éprouvée hier, en apprenant que la censure royale avait mis sa griffe sur le journal que je t’ai adressé. Serait-elle allée s’abattre jusque dans la poste ? Ce moyen de communication, ordinairement si sûr, pourrait-il nous être enlevé par le caprice de M. le lieutenant de police ? Ainsi l’affreux régime d’exception et le bon plaisir que nous subissons, nous tient sans cesse sur le qui vive ! Chacun de nous, hier vainqueur et héros magnanimes, aujourd’hui vaincu et gibier de potence, est comme Damoclès sous la menace d’un glaive, sans avoir comme lui en compensation, de moelleux coussins, des parfums délicieux et des buffets chargés de mets exquis.
Grace à une étoile jusqu’alors des plus nébuleuses, mais qui dans ces derniers jours de tempête que nous venons de traverser, s’est montrée à nous d’une manière resplendissante, nous n’avons plus rien à craindre, jusqu’à nouvel ordre, de l’aveugle vengeance ou des caprices de nos tyranneaux, il ne me reste donc qu’a vous satisfaire sur le second objet qui vous intéresse, c’est à dire sur mes études. Quand je parle de vous satisfaire j’exprime plutôt ce que je désire que ce que je puis, car moi aussi, je serais le plus satisfait de tous, n’en déplaise à notre chère mère, qui dans la lettre qu’elle t’adressa ici le 3 du mois, te chargeait de me dire que je pouvais terminer sans dispense ni faveur aucune !...
Je viens à mon tour, mon cher ami, te prier de lui exposer ainsi qu’à notre cher père, non pas ce que nous voudrions qui fût, mais ce qui est, savoir : que du jour où je passais mon examen jusqu’à celui de la fermeture de l’école, il n’y avait plus qu’un mois, à quatre jours près ; qu’en éloignant toutes les entraves, toutes les influences fâcheuses, en se plaçant dans les conditions les plus favorables, en procédant avec toute la célérité possible, c’est à dire théoriquement parlant, il me fallait au moins quinze jours pour mon second examen, 15ou 20 jours pour composer ma thèse, Currente calamo (1); dix jours au minimum entre le dépôt du manuscrit et l’acte, ce qui nous reporte à la mi-septembre, à 20 jours au moins après la fermeture de l’école. Tout cela ne souffre pas de la moindre discussion. Quand à l’autorisation de subir des thèses pendant les vacances, cela ne s’accorde pas pour la raison que l’on a eu dix mois de l’année scolaire pour subir cet acte. La seule chose qui se fait en faveur de ceux qui veulent passer des examens aussitôt après la rentrée, c’est de leur permettre de s’inscrire dès les derniers jours de ce mois ci et de consigner à partir du 27 octobre, époque à laquelle les bureaux rouvrent.
Il me reste maintenant à dire un mot du second examen que j’aurais pu, ou mieux du subir dans ce mois. Je crains bien que mon père blâme ma résolution, mais j’espère qu’il me la pardonnera comme il m’a pardonné tant d’autres choses, en considérant que le temps qui me reste me donne l’assurance d’un succès qui aujourd’hui était loin d’être certain.
Cette lettre eut beaucoup mieux été adressée à nos bons parents qu’à toi, mon cher frère, mais qu’importe, et puis je suis bien aise de t’avoir pour avocat et intermédiaire auprès d’eux. Sois aussi l’interprète de la peine que me cause la perspective de cet isolement dans lequel il me faut encore vivre et parle leur de la joie que j’éprouve à approcher du moment qui me rendra enfin à ma famille. Ces peines et ces joies ont aussi été les tiennes, qui mieux que toi peut les comprendre et les exprimer ?
Adieu, mon cher frère, j’aurais beaucoup de choses à te dire, mais il ne me reste plus que le temps et l’espace nécessaire pour t’embrasser de coeur ainsi que nos chers parents, et t’assure de l’attachement de ton meilleur ami.
Abel Jeandet
Ne m’oublie jamais auprès de ceux qui se souviennent de moi. C’est bien mal de ne m’avoir pas donné une seule nouvelle de notre pays. Quelles ont été les élections ? Que fais tu pour propager les mauvaises doctrines ? ( style de ceux comme il faut)
Ton paquet est parti hier.
(1) Expression adverbiale signifiant au courant de la plume, c'est-à-dire qu'on écrit rapidement et sans soigner son style
***
Verdun le 24 août 1848.
Très cher frère,
Je reçois à l’instant ta lettre, dont je commence tout d’abord par te remercier de tout mon cœur, et j’y réponds de suite à défaut de notre père qui en est empêché. Ce que tu nous dis relativement à ta thèse, mon cher Abel, ne nous que médiocrement surpris, mais il n’en a pas été de même pour ce qui concerne ton cinquième examen. E effet , nos parents espéraient, en supposant que tu eusses employé utilement le long mois qui va bientôt finir, que tu n’hésiterais pas à te présenter, de telle sorte, que débarrassé de ce dernier obstacle, tu n’eusses plus qu’à t’occuper de ta thèse, mais comme tu as préféré agir autrement, ils pensent que tu ne t’es déterminé qu’après avoir mûrement réfléchi. D’après cela ils supposent, quoique tu ne le dises pas, que tout en préparant ton examen pendant les mois de septembre et d’octobre, tu vas également travailler à ta thèse, de manière qu’à la rentrée tu n’aies plus qu’à subir ces deux épreuves. Mais il y a une chose que tu omets de nous dire, et c’est même le motif qui me fait t’écrire aussi promptement car notre père la regarde comme très importante, c’est, mon cher ami, si tu comptes profiter de la faculté qu’on laisse aux candidats de s’inscrire dès les derniers jours de ce mois et de consigner à partir du 27 octobre pour pouvoir passer leurs examens aussitôt après la rentrée ? Nos parents pensent que c’est un oubli de ta part et que tu es en mesure sur ce point, car l’affaire importante est la question de temps et tu ne dois avoir disent-ils qu’un but, qu’une idée fixe, c’est de finir une bonne fois, c’est de quitter enfin une position qui n’est rien moins que brillante et dont tu dois être las ! c’est pourquoi, mon cher Abel, nous attendons une lettre de toi qui contentera à coup sûr nos excellents parents touchant l’objet qui nous occupe.
Je croyais que tu retarderais de deux jours le départ de ta lettre , pour m’annoncer l’envoi de mes pièces au ministre de l’instruction publique ; si tu n’es pas encore allé à l’école chercher mes deux certificats, ne tarde pas plus longtemps je t’en prie, et surtout dis-moi dans ta prochaine lettre vers quel quantième du mois tu as adressées mas pièces. Tu me demandes ce que je fais pour propager les mauvaises doctrines ? hélas, mon ami, je fais bien peu de choses pour ne pas dire rien, car la politique est morte ici et l’on s’occupe fort peu si les hommes qui nous gouvernent sont des traîtres à la patrie ou de grands citoyens ! Du reste cela ne me surprend pas, nous sommes selon moi, dans un temps d’arrêt : quant à ce qui nous regarde personnellement, c’est à dire mon père et moi, je présume que tu es des nôtres, la république que nous avons maintenant n’étant pas notre république, nous restons dans un statu quo parfait en attendant des jours meilleurs ! Mais quoiqu’il puisse arriver, mon cher Abel, je commence à croire, et le jour où tu penseras comme moi n’est peut être pas loin, que là ou finit la famille, il n’y a plus qu’indifférence et égoïsme !! Notre excellente mère quoique très souffrante et à laquelle ta lettre vient encore de causer des larmes, va terminer cette épître. J’ai bien reçu hier mon paquet et ma caisse de livres.
A. Jeandet
***
Verdun le 19 vendémiaire, An 1° de la
deuxième république ( 11 octobre)
Permis à toi, mon cher ami, de me demander de ces nouvelles locales que l’on aime tant à entendre raconter ! Permis à toi, exilé depuis si longtemps de la terre natale, de rêver de la patrie absente et de prendre plaisir à entendre parler, alors même que ce qui la concerne n’offre rien de bien récréatif ? Je comprends même qu’il ne peut en être autrement, car moi aussi j’ai éprouvé naguère ce même besoin, mais malheureusement la matière échappe à l’analyse comme dirait un chimiste. Et en effet que pourrais-je te dire de notre petite bourgade si indifférente sur tout ce qui se passe hors de ses murs et qui ne sort même pas de l’indolent et coupable sommeil où elle est plongée pour s’occuper de ses propres affaires !... pauvre petite cité bourguignonne tu n’étais pas née pour vivre dans ces temps révolutionnaires ! L’énergie qui animait jadis tes fils du moyen âge et de quatre vingt treize s’est changée en un véritable sibarisme et l’ignorance de ta population actuelle lui défend d’invoquer ces glorieux souvenirs !... Voilà où en est réduit notre pauvre Verdun dont les vignes qui sont toujours aimables ne pousseraient pas, j’arrive à croire, le patriotisme jusqu’à aller danser le menuet à l’arrivée de nos amis les Prussiens à l’exemple de leurs homonymes de quatre vingt douze. A propos de 92 qui ne vaut pas 93 quoiqu’on en dise mais qui vaut encore mieux que 48 n’en déplaise à qui pense autrement, je vais t’apprendre une nouvelle fort intéressante : sache donc, mon cher ami, que le 17 septembre un enfant mâle du nom de Jeandet est venu s’asseoir au banquet de la vie où sans aucun doute la divine providence lui avait réservé une place, attendu qu’elle prévoit tout ce qui doit arriver et que chacun de nous ici bas est l’objet de sa plus tendre sollicitude ! Qui dit cela ? ce n’est pas moi, ce n’est pas toi non plus, j’imagine et que ce n’est pas la question . Enfin bref ???? Jeandet n’en est pas venu s’asseoir au banquet de la vie d’où , sans doute, il faudra qu’i s’en aille, tôt ou tard ce qui est fort bien fait puisque le père éternel l’a aussi décidé dans sa suprême sagesse et que tout est pour le mieux au dire du ??? Panglosse.
Je passe, maintenant, mon cher Abel, à ce qui me regarde personnellement : Je n’ai rien ou presque rien à te dire , tu sais combien est douce la vie de famille que l’on mène ici et qu’il ne m’en faut pas davantage pour me satisfaire. Mais hélas ! pourquoi cette situation qui me semble si agréable ne doit-elle être que passagère ? Je sens moi-même qu’il faudra y mettre un terme et déjà même nous avons de vagues projets d’établissement, de mariage !!...
Danser un menuet à l’arrivée de nos amis prussiens. Tu ne saurais croire combien la nouvelle de la destitution de mon oncle nous a surpris et peinés tout à la fois ? Il faut convenir que nous avons bien peu de chance, et sans s’en prendre au destin ou à la fatalité, ne te semble-t-il pas que la République y est pour quelque chose ? Ce qui est évident, c’est que la République distribue ses faveurs à tort et à travers et qu’elle agit en véritable marâtre. Je sais bien que nous ne sommes point en république et que tout ce qui se fait maintenant n’est qu’une plate et indigne copie du gouvernement républicain tel que le comprennent les vrais patriotes, mais quoiqu’il en soit nous n’en sommes pas moins sous le joug pieds et poings liés.
Avant de terminer ce trop long verbiage, mon cher frère, j’ai encore quelque chose à te dire relativement aux romans illustrés : aussi tu prendras chez Havard les dernières livraisons de Gil Blas dont j’ai les trois premières ici ; Mais je préfère continuer les Veillées littéraires publiées par BRY AINE. Toutefois tu pourrais prendre quelques romans de la collection Havard s’ils ne se trouvaient pas dans celle précitée. Je te prierai aussi de m’acheter avant ton départ, l’almanach impérial pour 1849. Ai-je besoin de te dire que si tu trouvais quelques brochures politiques et curieuses tu pourrais en prendre un exemplaire pour moi.
Adieu mon cher frère Abel, je t’embrasse de tout mon cœur et te prie de croire à l’inaltérable affection de ton frère et ami.
Amédée Jeandet
***
Verdun, 10 novembre (brumaire) 1848.
Ne crains pas que je t’oublie, mon cher ami, notre affection mutuelle, qui jusqu’à ce jour, le plus léger nuage n’a point encore obscurci, ne peut que s’accroître avec l’âge. Eh d’ailleurs, à l’heure qu’il est, ne doit-on pas resserrer plus que jamais les liens de la famille et même n’éprouve-t-on pas le besoin de se grouper les uns contre les autres, alors que la société moderne, ébranlée jusque dans ses fondements, semble vouloir s’abîmer dans le gouffre sans fond qu’a produit le vingt quatre février ! Il me semble, dis-je, qu’en présence de ces grandes commotions sociales dont on ne peut prévoir le dénouement, mais qui en définitive pourraient bien se terminer par le renversement de tout ce qui existe, que les esprits les plus fortement trempés, et même les plus révolutionnaires ont besoin, non de se réchauffer au foyer du patriotisme, car s’il en étaient arrivés là ils seraient à demi-vaincus, mais du moins de se recueillir et de crier qui vive ! avant de marcher en avant !!
Ce langage te surprendra peut être, surtout venant de moi ton élève ? mais, mon ami, réfléchis un peu, rappelle toi tes souvenirs historiques et tu verras que bien souvent l’esprit humain hésite au moment du sacrifice. Maintenant dire ce qu’enfantera ce nouveau cataclysme social, c’est ce qui échappe à ma faible raison. La liberté sera-t-elle encore étouffée sous le poids du despotisme ou bien seras-ce la liberté elle même qui de ses bras nerveux étouffera le despotisme expirant ? L’avenir nous l’apprendra. Quant à ce qui concerne la France en particulier, j’essaie de me faire illusion sur son compte en relisant les pages sublimes de son immortelle Révolution de 89, mais ces lectures au lieu de me rassurer sur son sort à venir, me la montre peut être encore sous un aspect plus défavorable. Mais laissons de côté ces graves questions et parlons un peu de toi, mon cher frère, de toi qui est maintenant accablé sous le poids de nombreuses occupations et dont l’esprit doit être tourmenté par une inquiétude vague et bien naturelle dans la situation où tu te trouves présentement. Ai-je besoin de te dire, mon cher ami, que si je n’ai pas le bonheur d’être près de toi, ton souvenir occupe sans cesse ma pensée, que tout ce qui peut t’arriver d’heureux ou de malheureux me touche singulièrement et que je souhaite de toute la force de mon âme qu’un heureux résultat vienne enfin mettre un terme à tous les soucis qui nous assiègent. A propos des bustes de Vauquelin et de Parmentier, c’est celui de ce dernier que je préférerais, s’il était possible de l’avoir bronzé et à un prix raisonnable ; Quant aux veillées littéraires la dernière que tu m’as fait parvenir avait pour titre Ourika ! N’oublie pas aussi de prendre la suite de Gil Blas et relis à ce sujet ma dernière lettre.
Adieu mon cher Abel, je t’embrasse de tout mon cœur, attendant que je puisse le faire en réalité et te prie de croire au sincère attachement de ton frère et ami
Amédée Jeandet
***
Verdun 26 décembre 1848.
Très cher frère,
Quoique nous ne fussions pas précisément inquiets, eu égard aux journaux que tu me fais l’amitié de m’envoyer, néanmoins ta lettre a été la bien venue. C’est qu’en effet il n’y a pas de plus puissants remèdes contre l’absence qu’un commerce de lettres entre personnes qui s ‘aiment. Par ce moyen ingénieux les … disparaissent, tout ce qui est éloigné se rapproche et fussions nous l’un et l’autre séparés par les mers que nous pourrions encore nous communiquer nos impressions réciproques, nos pensées les plus intimes et alléger par là les chagrins de l’exil. Te dire maintenant pourquoi moi tout le premier je ne t’écris pas plus souvent, c’est ce que je ne sais pas ou du moins si je le sais, je n’essaierai pas de te l’expliquer, car probablement je ne te dirais rien que tu ne sache aussi bien que moi sur ce chapitre.
Tua s à ce qu’il paraît, mon cher ami, renoncé à la politique, je t’en félicite sincèrement, mais j’aurais désiré que tu eusses fait cet aveu sans restriction, car pourquoi ajouter jusqu’à nouvel ordre ? Compterais-tu par hasard sur une nouvelle résurrection du peuple de Paris après les déceptions sans nombres que toi républicain tu as essuyées ! Certes pas mieux qu’un autre je ne sais lire dans le livre du destin, et dieu me garde de désespérer du salut de la France, mais je te confesses qu‘en présence des faits monstrueux accomplis depuis bientôt un an en dépit de tous les grands mots bien sonores, bien ronflant et je le dit à regret, inventés pour les sots, je crains sérieusement de me réveiller athée un de ces quatre matins. J’admets qu’en véritable apôtre, il faille boire le calice jusqu’à la lie, mais à la fin les plus grands courages faiblissent et comme dit le proverbe tant va la cruche à l’eau qu’elle se brise, ce qui traduit en langage un peu moins vulgaire, signifie qu’on finit par se lasser de parler à des hommes nés pour l’esclavage et que c’est justice d’abandonner un peuple assez dégradé, assez vile pour préférer à sa liberté l’infime héritier d’un grand homme il est vrai, mais dont la grandeur même fut su funeste à sa patrie ! en vérité c’est à n’y pas croire et le poète qui a dit Liberté, liberté, mot sonore, doux songe, que vingt siècles encore n’ont pu réaliser, ne pourrait pas mieux dire.
Je suis bien reconnaissant, mon cher Abel, des journaux que tu m’envoies, car quoiqu’à présent je m’occupe beaucoup plus de pharmacie que de politique, je tiens cependant à être au courant de ce qui se passe et surtout à lire un journal dont l’opinion est en tout conforme à la mienne : à ce propos je te demanderai pour quel motif tu ne m’envoies pas le n° hebdomadaire du peuple ? Je conserve avec soin tous ceux que tu m’as déjà envoyés, ainsi tu peux bien te dispenser d’en acheter 2 n°, puisque tu les retrouveras à ton retour ici. Pourquoi m’as-tu envoyé le roman des deux fous du bibliophile Jacob, avant sa terminaison définitive ? J’ai également découvert en lisant la table du 1° volume qu’il me manquait Clair d’abbe, Melle de Kérouare par Jules Sandeau et la Fanfarlo, mais j’ignore si ce dernier forme une livraison particulière. Comme tu le vois toutes ces choses demandent une réponse, aussi j’espère, mon cher ami, qu’elle ne se fera pas trop longtemps attendre. Vas-tu toujours chez Madame Bonneville ? Y-vois-tu parfois le père Ferdinand ? je serai curieux de savoir si ce pauvre diable de philanthrope croit encore à l’heure qu’il est à l’amélioration toujours croissante de l’espèce humaine, en présence de la boucherie des patriotes de Vienne ?
Je termine, mon cher Abel, en te souhaitant une bonne et heureuse année et en te priant de croire à l’inaltérable affection de ton frère et ami
Amédée jeandet
***
1849
Lettre en date du 1° janvier 1849 d’Abel Jeandet à Paris à son frère Amédée à Verdun-sur-le-Doubs
Postée le 4 janvier 1849
Paris le 1° janvier 1849 !...
Mon cher frère, Tu apprécies trop bien tout ce que le cœur peut trouver de consolation, contre les ennuis de l’absence des personnes qu’il aime, à l’aide de ce moyen merveilleux que l’on nomme écriture, pour que je te pardonne facilement d’en user si peu avec moi. Aussi malgré la lettre que tu viens de me faire l’amitié de m’écrire, ou plutôt à cause de cette lettre je me plaindrai encore de ce que tu es avare de ces communications amicales dans lesquelles j’aime à trouver à côté des épanchements de ton âme, des détails intimes de cette vie de famille dont les douceurs sont augmentées à mes yeux par les privations.
Ces plaintes, mon cher frère, je n’ai que faire de te le dire, ne sont pas des reproches que je t’adresse : j’accuse et avec raison, non ton cœur, il n’est point en cause, mais ce je ne sais quoi dont je subis, comme toi, de temps en temps la funeste influence.
Je ne puis te dissimiler, mon cher ami, que ta lettre ne m’a pas entièrement satisfait ; je n’y ai pas trouvé des détails que je t’avais demandés sur nos chers parents, et d’un autre côté j’y ai rencontré bien des hérésies. Quoi ! mon cher frère, toi, fils de cette génération qui n’a encore rien payé de la dette qu’elle a contractée envers sa mère la Patrie, venir te déclarer insolvable !...Le roi des tyrans Napoléon le grand, disait que le mot impossible n’était pas français et un plébéien dirait en parlant du Peuple de France, il ne peut pas ! Si ce blasphème avait de l’écho, c’est alors qu’il faudrait désespérer.
En présence de notre abaissement, de notre infortune et de ce renversement général, tu crains me dis tu de te réveiller athée, allons donc, ne sommes nous pas des athées aux yeux des vrais croyants !...mais aux yeux de la philosophie, y-a-t-il des athées ?...
Je m’arrête, à regret, car tu m’as entraîné dans une route spacieuse, immense, mais cette lettre n’a pas pour objet de répondre à la tienne, son but principal est de te charger d’une mission que le sort n’a pas permis que je remplisse moi-même. Mission presque sainte qui aurait été trop douce à mon cœur pour que le tien ne soit pas heureux de la remplir.
À toi donc , cher frère, le soin d’être mon interprète auprès de notre cher père et de notre chère mère et de leur faire agréer mes souhaits bien sincères ainsi que la nouvelle expression de mes regrets.
Adieu, mon cher frère, je t’embrasse de tout mon cœur ainsi que nos chers parents, bonne, meilleure année.
Ton frère et ami
Abel Jeandet
Je te prie de ne pas m’oublier auprès de l’oncle Pierre, de Jeandet, de ma tante Adrien etc etc. Je n’y vois plus…
***
Verdun le 31 janvier 1849.
Mon cher oncle,
Il me semble vous entendre vous écrier à l’ouverture de cette lettre : « mais en vérité est-ce possible, je crois que c’est là l’écriture de mon neveu Amédée ? » Eh mon dieu oui ! Mon cher oncle, c’est moi-même plus honteux que le corbeau de la fable, car je ne m’abuse pas sur ma négligence et j’en suis des plus marris, mais enfin il t a un proverbe dont je ne vous garanti pas la nouveauté et que sans doute le bonhomme Sancho n’avait pas omis dans son répertoire, qui dit : mieux vaut tard que jamais.
Du reste je crois déjà avoir eu occasion de vous dire que je n’écrivais que fort rarement surtout à certaines personnes, vu la faiblesse de mon style épistolaire et que par conséquent il ne serait pas juste de se prononcer sur la nature de mes sentiments d’après le nombre, je le confesse plus ou moins grand de mes lettres des quelles je serai probablement toujours fort avare. Néanmoins je tâcherai de sortir de temps en temps de ma léthargie pour vous informer que j’appartiens encore à ce monde sublunaire, de telle sorte que mon existence soit pour vous un peu moins problématique. Ai-je besoin de vous dire, mon cher oncle, que votre lettre du janvier, qui nous annonçait enfin votre nomination au collège de Blaye, nous a causé une bien vive satisfaction, et pourtant dans cet heureux événement qui est venu mettre un terme à toutes vos angoisses, j’ai reconnu, moi qui suis quelque peu fataliste, les caprices de ces divinités allégoriques imaginées à tort ou à raison et qu’on est convenu d’appeler fortune, hasard, destin, car au lieu d’être envoyé dans un département qui est à 120 lieues de votre pays ne pouviez-vous pas aussi bien être nommé dans dix autres qui en sont plus rapprochés ?
A ce propos, mon cher oncle, si vous me faites l’amitié de me répondre, je vous serais obligé de me donner quelques détails sur votre nouvelle position, c’est à dire que nous tiendrons à savoir quel est l’importance de ce nouveau collège où vous venez d’être relégué, quelles sont les rétributions affectées aux professeurs chargés des classes supérieures et enfin comment vous, ma tante et Henri, vous vous trouvez du séjour de Blaye, cité fameuse, comme vous savez, et de laquelle l’illustre duc D’Isly doit conserver un bien doux souvenir. Nous n’avons pas reçu de lettre d’Abel depuis longtemps ; Dites nous je vous prie si vous l’avez vu avant votre départ de Paris.
Sur ce, mon cher oncle, je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ma chère tante, et vous prie de croire à l’affection sincère de votre neveu
Amédée Jeandet
Mon père et ma mère se joignent à moi, nous embrassons Henri.
***
Il est vrai, mon cher Amédée, que ta lettre m’a surpris, car vous ne vous mettez pas trop en frais de correspondance ; mais la surprise a été agréable, j’ai vu avec plaisir que rien n’allait plus mal dans la santé de ton père ou de ta mère ; pour toi tu es dans un âge où l’on se porte toujours bien. Nous avons eu ton frère avec nous au moment de notre départ ; il allait bien et paraissait disposé à quitter Paris dans un délai peu éloigné.
Je suis de ton avis, mon cher Amédée, au lieu de m’envoyer à 480 kilomètres de notre pays, l’université pouvait m’envoyer dans le département de Saône-et-Loire, ou dans un département voisin ; Elle ne l’a pas voulu. Je ne dirai pas comme Job : sit nomen domini benedictum * ni comme Panglos : tout ira mieux dans le meilleur des mondes possible ; car j’ai trop de respect pour dieu, pour le rendre complice de l’iniquité des méchants, et le monde va trop mal pour qu’on est l’impudence ou la sottise de le considérer comme le meilleur des mondes, mais n’étant pas le plus fort je me résigne et j’obéis.
Nous sommes arrivés à Bordeaux le samedi 20, et à Blaye le dimanche 21 janvier 1849. Bordeaux est une belle et grande ville où nous sommes restés près de vingt quatre heures ; Je l’ai parcouru dans tous les sens pour chercher le Recteur de l’académie, que j’ai enfin trouvé et dont la réception m’a fait plaisir. Blaye est une vilaine ville, mal batie, mal percée, mal pavée. Mais la gironde est magnifique, elle a cinq kilomètres de large en face du port.
Nous y sommes logés agréablement ayant pour nous promener un enclos de vignes de sept à huit journaux à deux pas du collège.
Le principal est un excellent homme ; les autres fonctionnaires, chose rare dans l’université ! sont parfaitement unis entre eux, ce qui est pour un nouvel arrivant une grande fiche de consolation. Tous ceux des habitants avec lesquels nous avons eu jusqu’à présent quelques rapports nous ont rappelé les bons habitants de Bretagne, que nous avons regretté et que nous regrettons encore, et ici un professeur du collège est regardé comme une autorité.
Je n’en suis pas moins déchu de mon titre, et je ne crois pas que nous puissions jamais faire grande figure avec mon traitement de 1600 francs par an, courant à partir du 22 janvier.
Ce qu’il y a de meilleur dans tout ceci, c’est que nous sommes tranquilles, et que nous commençons à nous reposer de nos longues agitations. Un emploi, quelque petit, quelque humble et obscur qu’il soit, vaut toujours mieux que l’incertitude et l’oisiveté, quoique, pendant ces derniers jours de malheur, nous ayons trouvé dans nos amis un intérêt, une sympathie et une affection dévouée que nous n’aurions pas même osé espérer.
En arrivant à Blaye, mon cher Amédée, nous avons rencontré un nom connu, Léchelle ! c’est un frère de monsieur Léchelle, qui se trouve professeur de seconde, et que j’aurais reconnu à son extrême obligeance, à sa ressemblance morale avec ses frères, quand même je n’aurais pas su comment il s’appelait. C’est te dire que nous avions ici des amis avant même d’y venir. J’ai déjà répondu hier à une lettre de celui que vous avez tous connu à Verdun, qui demande surtout de vos nouvelles, et que j’espère bien voir un de ces jours dans notre modeste habitation de la Gironde.
Au revoir, mon cher neveu, ta tante t’embrasse de cœur ainsi que ton père et ta mère, je me joins à elle de toute mon âme et n’ai pas besoin de te dire que tu peux compter en tout temps sur l’affection de ton oncle.
Chapuis
Ancien principal chargé de la classe de rhétorique au collège de Blaye.
P.S. il y a ici un principal qui aime le bon vin, et nous sommes ici parfaitement bien placés pour le déguster. Mais le susdit principal voudrait comparer : je désirerais donc que tu me mandasses ce que coûte dans notre pays une pièce de bon vin, à quoi reviennent les frais de transport et autres afin que j’en puisse faire venir, pour prouver aux habitants de la Gironde que nos vins ne craignent aucune comparaison.
* Que le nom du Seigneur soit béni
***
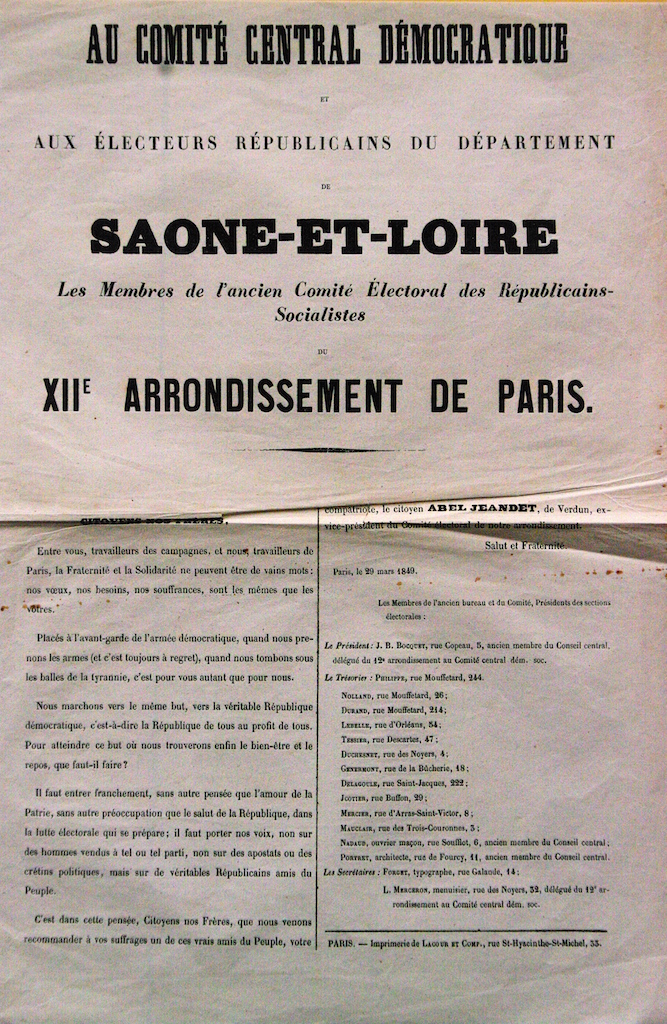
***
J’ai eu beaucoup de mal à déchiffrer la lettre qui suit d’Abel Jeandet à Paris à son frère Amédée chez son père médecin à Verdun sur le Doubs. Beaucoup de noms propres écrits dans tous les sens. J’ai essayé de trouver sur généanet sans résultat.
9 Avril 1849,
Mon cher frère,
Malgré l’influence funeste que les miasmes délétères du marais politique dans lequel tu vis ont du exercer sur toi, malgré la disposition naturelle que je te connais à contracter facilement les épidémies régnantes, je ne puis , cependant, croire que tu resteras inactif dans la grande lutte qui va s’engager.
Je n’entrerai dans aucune considération générale, tu n’en a que faire ; je me contenterai de te dire que tu peux beaucoup pour ma candidature, si non pour la faire réussir, du moins pour la poser d’une manière sérieuse. Seulement il faut vouloir. La partie est certainement belle et flatteuse pour toi, car ton candidat sera probablement le seul qui se présentera avec la recommandation d’une partie des républicains de Paris. C’est là un point sur lequel il faut insister. Ce serait bien le diable … si on ne pouvait pas compter sur son frère. Hélas cela c’est pourtant vu. Nous n’avons pas à recommencer la petite guerre de l’année dernière, il faut surtout agir avec et sur les comités. D’après la réaction qui s’est manifestée en ma faveur aux élections supplémentaires j’ai tout lieu de croire que le comité du canton de Verdun appuiera ma candidature, mais il faut surtout qu’elle soit soutenue au comité central. Le mouvement électoral prend assez bonne tournure dans le Mâconnais et le Charollais. Il paraît que le parti de la vraie république démocratique plantera franchement son drapeau. Si l’ignorance, la mauvaise foi et l’égoïsme n’étaient contre nous, la réussite serait assurée, malheureusement il n’en est pas ainsi, je ne me le dissimule nullement.
Quoiqu’il en soit , voilà un aperçu de ce qu’il y a à faire : former pour l’élection populaire un comité national démocratique qui se hâte de se mettre en rapport avec ceux déjà existant, leur envoie ses candidats et leur demande la liste des siens. J’apprends que dès le 22 mars la petite ville de Marigny avait adressé cet appel aux comités démocratiques du département. Il faudrait donc leur écrire de suite etc etc … Deux ou trois citoyens qui voudront bien te venir en aide, et il s’agit tout bonnement d’avoir des noms comme point d’appui, suffisent.
Dans les premières élections c’est à peine si nous avons pu percer en dehors du canton, nous devons au moins cette fois nous faire connaître dans tout le département. Voilà déjà ce que j ‘ai fait pour atteindre ce but. J’ai adressé la lettre des républicains démocratiques socialistes du 12° arrondissement de Paris aux citoyens dont les noms suivent :
- À Chagny Defay éclusier au ??? , Chaussier aîné, Gras vétérinaire.
- à Pierre *Amédée Guillemein chez son père ???
- à Marcigny *Paul Préaud président du comité électoral ???? de Marcigny.
- à Charolles François Roiveaud secrétaire du club de Charolles.
- à Mâcon le ?? ordinaire rédacteur en chef de l’union républicaine ????avec demande d’insertion dans son journal.
Je t’envoie ce soir par la diligence à l’adresse de Claude Auger à ????? 1240 exemplaires de la lettre en question pour faire tenir de suite à tous les démocrates présumés que l’on pourra découvrir et d’abord à ceux qui me sont désignés comme bons. À Chagny : Vacherot fils épicier, Changarnier chapelier, Chauveau Michon, Gremelin à Fontaine canton de Chagny. Canton de Pierre : *David Matthey à Pierre, *Oppenin Nre à la chapelle St Sauveur, Gueret idem, *Guillot Nre à Bellevesvre , Sergent Maire de St Bonnet en Bresse. Canton de St Germain du bois : *Guillemain maire à Mervaux, *Mathey Nre à Charey.
*??? Batillat à Mâcon, Charpentier avocat à Mâcon, Marin à St Jollin canton de Mâcon, Delile tisserand à St Clément les Mâcon.
Il faudrait encore envoyer de suite à tous ceux dont les noms sont marqués d’un * un exemplaire de chacune de mes pièces de l’année dernière ( lettre au Patriote – lettre aux électeurs de Saône et Loire – adresse ?????? )
En ayant grand soin, 1° de couper le post-scriptum dirigé contre le patriote. 2° de corriger deux fautes d’impression dans la lettre, au lieu d’historien, mettre histrion de cette manière hist//rions – ajouter un s à voie nouvelles. 3° mettre les dates laissées en blanc ??????????
(7 novembre et 14)
Au revoir mon cher frère, il faut que je te quitte, engage le combat et j’arrive pour te soutenir.
Abel Jeandet
Embrasse bien pour moi nos chers parents. Je vais tâcher d’aller aujourd’hui au ministère de l’instruction publique pour ton affaire.
Les pièces en question sont dans un paquet sur ????? de la bibliothèque de notre père.
Si vous recevez l’union républicaine avec la lettre du 12° arrondissement, hâtez vous d’en demander une 12° d’exemplaire.
***
26 novembre 1849.
Mon cher oncle,
Après la lettre que je vous ai écrite en date du 29 septembre dernier, j’espérais que votre réponse ne se ferait pas attendre trop longtemps nonobstant même votre juste mécontentement contre nous. Mais je m’abusais étrangement à ce qu’il paraît, car depuis bien des jours se sont écoulés et je n’ai point vu venir votre réponse. Eh pourtant ! dans ma lettre je croyais avoir justifié notre silence par des raisons plausibles, telles que celles-ci par exemple : je ne sais ce que vous faites, ce que vous devenez ? quant à nous nous avons éprouvé bien des contrariétés, bien des ennuis : ma mère a été retenue au lit pendant près de deux mois par cette cruelle maladie qui il y a trois ans l’a déjà si fort tourmentée ; la santé de mon père a été et est toujours très mauvaise, etc… etc… Je croyais également dans cette même lettre , mon cher oncle, vous avoir donné des explications assez satisfaisantes quant à ce qui me concerne, lorsque je vous disais n’avoir tardé si longtemps à vous écrire, que parce que je tenais surtout à vous informer de ma réception au titre de pharmacien, et qu’il m’avait fallu pour le faire, attendre que tout fut terminé. Serait-il vrai, comme on l’a si souvent répété, qu’une absence par trop prolongée finit si non par briser les liens de famille, du moins par leur porter la plus rude atteinte ? ou bien encore l’influence de l’éloignement sur les affections humaines serait-elle si grande, que l’amitié que nous portons à nos proches dut croître ou diminuer en raison même de la distance qui nous en sépare ? Quoiqu’il en soit de ce qui précède et sans me prononcer pour la négative ou l’affirmative, ces deux propositions étant assez importantes par elles même pour s’y arrêter plus longtemps que je ne le fais. Votre silence, mon cher oncle, ne m’en paraît pas moins fort étrange et pour l’expliquer je ne puis que supposer que ma dernière lettre ne vous ait point parvenu. Mais en voici une seconde, j’aime à croire qu’elle sera plus heureuse que la première et qu’un prompte réponse de vous, en faisant cesser l’inquiétude où nous sommes, mette ainsi un terme à toutes les conjectures plus ou moins invraisemblables, que l’on a coutume de faire en de pareils circonstances.
Adieu, mon cher oncle, je vous embrasse de tout mon cœur ainsi que ma tante et Henri et vous prie de croire à la sincère affection de votre neveu.
Amédée Jeandet,
Pharmacien
***
1850
Mon cher frère,
Comme nous supposons que tu vas écrire très incessamment à M. Giraudeau de ST Gervais pour lui demander de son ROB, notre père et moi pensons que tu devrais profiter de cette occasion pour le prier de te renseigner sur le Rob de Boyveau-Laffecteur qui se pose comme concurrent du sien.
Voilà ce me semble comment tu pourrais lui présenter la chose. « Un de mas collègues de Chalon annoncerait qu’il préfère parmi les dépôts que l’on trouve dans sa pharmacie, le Rob Giraudeau St Gervais et le Rob Boyveau-Laffecteur, préparation que jusqu’à ce jour je regardais comme parfaitement identiques, malgré le dire de M. Bouchardat, je vous prierai, monsieur, tant pour ma propre satisfaction que dans l’intérêt de mas clients et de de votre médicament de vouloir bien me donner quelques renseignements précis sur ce point tout à la fois commercial et thérapeutique afin que je puisse être à même de répondre aux explications qu’on pourrait me demander ».
Nous avons reçu hier ton envoi en très bon état, nous espérons que tes paquets te seront parvenus de même.
Je t’écris à la hâte Currente calanco
Je t’embrasse de cœur en attendant avec impatience l’arrivée de notre mère afin d’avoir de tes nouvelles.
Ton frère et ami
Abel Jeandet
Le 2 mars 1850
Pour ceux qui voudraient tout savoir sur les Rob suivre ce lien :
***
Voici, mon cher ami, un premier échantillon des notes que tu m’as demandées et que je t’ai promises. Ce petit résumé contient tout ce qu’il t’importe de savoir sur les maladies syphilitiques pour lesquelles on a le plus souvent recours aux pharmaciens à l’exclusion de nous autres. Tu le liras attentivement plusieurs fois afin de bien te pénétrer des conseils qu’il renferme et d’en tirer une méthode thérapeutique qui te servira dans presque tous les cas. Autant que ma santé le permettra, je m’occuperai du reste de ce travail que je t’adresserai par lambeaux à mesure qu’il sera fait.
Notre Verdun conserve le calme plat que tu lui connais, les élections ne lui ont rien fait perdre de son apathie habituelle. Si nos femmes font quelque chose d’équivalent à l’affaire qui est pendante chez vous, elles s’y prennent plus habilement, les maris n’en savent jamais rien. Ce qu’il y a d’uniquement déplorable en ceci, c’est qu’on puisse le donner une chiquenaude voir des coups de pistolet, à l’occasion d’une pareille vétille. Ô vanas hominum mentes !
Il ne faut pourtant pas te tuer à faire en un mois ce qui demande rigoureusement six. Ménage je t’en prie ta santé, seul moyen que tout aille en son temps et à bien. Nous regrettons que tu ne nous ais pas dit que ta petite clientèle se maintient au modique ?? des jours qu’on a passé près de toi. Ta mère ira te voir dans les premiers jours de la semaine prochaine…Quant à moi j’ignore s’il est écrit là-haut ou là-bas si j’irai jamais…
Envoie moi sans faute demain par Claude les objets suivants destinés comme les précédents à M. Graillot.
1° une bouteille de Rob de Boyveau-Laffecteur avec étiquette portant : Rob dépuratif de Boyveau.
2° Dix paquets dont chacun se composera de :
Salsepareille )
???? ) à a 30 grammes
??? )
3° Dix autres paquets contenant chacun :
??? )
réglisse ??? ) à a 8 grammes
Adieu, mon cher ami, porte toi bien et compte plus que jamais sur l’affection et le dévouement de ton père.
Jeandet
Verdun le 16 mars 1850
***
Lettre d’Abel Jeandet de Verdun à son frère Amédée pharmacien à Chalon-sur Saône en date du 26 mars 1850.
Verdun 26 mars 1850 au soir,
Mon cher frère,
Nous avons attendus dimanche matin pour déjeuner, le feu pétillait dans l’âtre, la table était dressée, le café inhalait son parfum. Des petits rognons étaient sautés au vi dit de champagne, et tout cela à ton intention… Nous t’avons attendu le soir, nous t’attendions presque lundi matin et même mardi ; nous espérions, à ton défaut, recevoir un tout petit mot de toi, mais rien, rien . Nous avons été trompés dans toutes nos espérances.
Nous nous perdons, comme tu penses bien en conjectures toutes plus favorables les unes que les autres pour expliquer et ton absence et ton silence. Je me décide donc, pour mettre un terme à nos incertitudes à t’adresser ces quelques lignes pour te prier, de vouloir bien nous donner le moindre petit signe de vie. Montre toi seulement à Carreau lorsqu’il passe devant ta porte ou fais dire un mot à Claude afin que nous sachions ce que tu deviens.
Sur ce cette lettre n’étant à d’autre fin, je te prie , mon cher frère, que Dieu t’ait en sa sainte et digne garde.
Ton frère et ami
Abel Jeandet
Notre mère t’envoie une nappe pour remplacer celle qu’elle a emportée et fera un petit paquet pour mettre ce billet. J’y joins une lettre que tu voudras bien faire remettre de suite à son adresse.
Les nouvelles abondent à Verdun, mais malheureusement elles ne sont toutes des meilleures.
***
Lettre d’Abel Jeandet en date du 1°avril 1850 adresséé à Monsieur Amédée Jeandet, pharmacien, grande rue 49 Chalon-sur-Saône
1° avril 1850 au soir,
Mon cher frère,
Je te prie de vouloir bien faire remettre de suite cette lettre à son adresse. C’est un mot de réponse à une note insérée dans le Démocrate au sujet de mon article. Je pense qu’il paraîtra dans le prochain numéro et quoiqu’il y sera très probablement incomplet, tu voudras bien envoyer prendre les 12 numéros que j’ai demandés dans ma première lettre le journal d’aujourd’hui donne précisément un article de Boisset sur le même sujet que le mien, seulement il ne l’a envisagé que superficiellement et au point de vue politique tandis que j’ai traité la chose en chrétien et j’ai pénétré in visceribus rei. (1)
D’après ce que m’a dit Claude il paraît que la journée de samedi a été bonne pour ta maison, cela a un peu remonté notre cher père.
Au revoir, je t’embrasse de cœur, ton frère et ami
Abel Jeandet
(1) si c’est bien ce qui est écrit, cela devrait vouloir dire « au cœur de l’état » à vérifier
***
Cette lettre d’Abel Jeandet, à Verdun sur le Doubs, à son frère Amédée pharmacien à Chalon sur Saône est en date du 22 avril. L’année n’est pas précisée peut être 1850. Il est question dans cette lettre du journal « le démocrate de Saône et Loire », et j’ai retrouvé dans le journal du 11 avril un article qui semble correspondre à ce qu’il en dit dans sa lettre.
Verdun, lundi 22 avril (au soir)
Mon cher frère,
Tu voudras bien m’envoyer par notre tante Pierre 8 ou 10 numéros du Démocrate dans lequel se trouve mon petit article. Il a été inséré (chose merveilleuse) avec une religieuse exactitude, mais en vérité il en valait la peine sous tous les rapports, soit dit sans vanité. En revanche le compte rendu de la séance du congrès est aussi pâle qu’inexacte.
Tu remarqueras que mon idée sur la synonymie politique des….. De Deflotte et de Colfavru a été acceptée complètement et consigné dans le supplément biographique du Démocrate. Au revoir cher frère, je t’embrasse de cœur. Je te prie de serrer (pour moi) la main du dit Esquiron si tu as le bonheur de le voir
Abel JEANDET
N.B. tu feras un petit paquet cacheté des numéros en question. Ne pourrais tu pas me faire acheter par Claude pour deux ou trois sous de graines de sainfoin ?
***
Lettre d’Abel Jeandet de Verdun sur le Doubs à son frère Amédée pharmacien 47 grande rue à Chalon-sur-Saône. J’y ai ajouté deux notes explicatives.
Verdun 26 avril 1850 au soir
Je te remercie, mon cher frère, de l’exactitude que tu as mis à m’envoyer mes journaux et mes livres, tu voudras bien faire la note de ce que je te dois, si tu as payé le relieur, dont je ne suis pas complétement satisfait.
Nous t’attendons pour les élections ; néanmoins nous profitons de l’occasion de Clara pour te faire passer un tout petit paquet et te demander 2 flacons de Baume opodeldoch (1) de 30 grammes chacun. D’un autre côté, notre mère, me charge de te prévenir qu’elle a dit à Mme Coulon que tu avais fixé le prix de ton miel à 45 centimes la livre, ce qu’elle a accepté.
Je ne te parlerai ni d’élection, ni de réaction, ni d’Esquiron, ni de Colfavru (2) dont on m’avait presque annoncé la visite, cela m’entraînerait trop loin.
À bientôt, je t’embrasse de cœur.
Abel Jeandet
(1) Baume à base de savon, d'ammoniaque, de camphre et d'alcool, et qui est utilisé en frictions contre les douleurs.
(2) Jean-Claude Colfavru est un homme politique avocat et député républicain français né le 1er décembre 1820 à Lyon (Rhône) et décédé à Paris le 18 mai 1891.
***
Blaye, 21 mai 1850.
Reconnaissant ton écriture, mon cher Amédée, et ne voyant pas le timbre de Verdun, j’avais pensé d’abord que quelqu’un de vous l’avait apportée à Charton et que c’était une réponse à ma dernière lettre. J’ai donc été fort agréablement surpris, en apprenant que ce qui me paraissait un accident était le résultat d’un fait accompli et durable, et que tu étais devenu citadin de notre chef lieu si joli, si aimable, si hospitalier. A vingt six ans, à l’âge où l’on entre dans la vie réelle, te voilà appelé à recueillir les fruits de l’éducation longue et coûteuse que t’ont assurée tes parents, tu as sans doute en perspective des travaux, des ennuis et des peines, c’est le lot de l’humanité ; mais tu as une carrière déterminée, tu as à ta disposition la portion essentielle du double capital sans lequel on ne peut rien faire de sérieux, rien se promettre de stable, de l’intelligence et une exploitation à laquelle tu peux l’appliquer. Ton but est fixé, ta marche toute tracée, et, ce qui vaut tous les autres avantages, tu es au milieu des tiens ; car, qu’est ce que une distance de quelques kilomètres qui sans le recours du chemin de fer, on peut franchir en deux heures ?
Je t’en félicite, mon ami, je t’en félicite de tout mon cœur. Tel que je te connais, tu ne peux que faire prospérer l’établissement dont tu es aujourd’hui le possesseur. Il m’est bien doux de penser que le fils d’une sœur que j’ai tant aimée et d’un homme en qui pour moi se sont toujours confondus le frère et l’ami, n’aura point à passer par ces rudes épreuves qui, si elles ne brisent pas tout à fait, abattent du moins celui qui les subit, empoisonnent le présent et détruisent l’avenir.
Ta lettre m’est venu comme un événement heureux pour un pauvre exilé, c’est quelque chose de consolant que de revoir des caractères ??? par une morne année. C’est une joie véritable lorsque ces caractères sont les messagers d’une bonne nouvelle. Ta lettre commençait par des réflexions sur le silence de mort que nous gardons les uns vis à vis des autres : Eh ! qui en souffre le plus de ces silences ? ce ne sont pas les bourguignons qui respirent l’air natal, qui ne voient autour d’eux que des visages connus qui vivent au milieu des objets dont leur enfance a été entourée, qui peuvent s’asseoir à ce qui est ou fut le foyer paternel ; mais ce sont les bourguignons qui depuis plus de trente années sont privés de tous ces biens et qui n’espèrent jamais plus en jouir.
Ce matin même, mon cher Amédée, j’irai reconduire au bateau à vapeur qui, à l’heure où je t’écris se prépare à Bordeaux, un homme de bien et de cœur, un vieil ami avec lequel, pendant deux jours, se sont réveillés tous les souvenirs de la famille et du pays. C’est l’excellent M. Léchelle qui m’a chargé de vous transmettre à tous l’expression de son amitié et de son désir de vous revoir. Encore un de ces exemples de l’intelligence, de la probité, et du travail, luttant, luttant sans cesse, et n’arrivant à rien !
Le collège de Blaye a depuis quelques jours un nouveau chef : Que sera-t-il ? je l’ignore, et j’avoue entre nous que cela m’est indifférent, par suite des chagrins et des ennuis qui sont résultés pour moi de mon intime liaison avec le prédécesseur.
J’ai eu beau tourner et retourner tes lettres dans tous les sens, je n’y ai pas trouvé les plus légères mentions sur ton frère. A quoi tient cette réticence ou cet oubli ? ne serait-il pas à Verdun ? Habiterait-il Paris ou quelque localité éloignée ? Je n’y comprends rien. Quand tu auras l’occasion de voir ton père ou ta mère ou de leur écrire, dis leur que je me plains de leur paresse, ???? J’aimerais au moins savoir ce qu’ils font. Sais-tu quelque chose du collège de Chalon, est-il florissant ? Hélas ! C’aurait été mon bâton de maréchal. Mais il n’y faut plus penser.
Adieu, mon cher Amédée, ta tante a été bien sensible à ton souvenir, elle et moi t’embrassons, ainsi qu’Henri qui ??, de tout oublié. ???
Chapuis
toute la fin de la lettre est illisible pour moi.
***
Chalon-sur-Saône le 21 juin 1850.
Merci, trois fois merci, mon cher oncle, de votre aimable et affectueuse lettre du mois de mai dernier. Merci surtout des encouragements que vous m’y donnez, j’en ai besoin, bien besoin ; De temps en temps mon courage faiblit, chancelle, lorsque mon esprit soucieux et chagrin, peu satisfait du présent, cherche à lire dans l’avenir et tremble d’y voir écrit : adversité ! Vous voyez il me faut des paroles d’espérance et d’amour, des paroles qui expriment l’affection et l’intérêt et qui comme celles de votre lettre, émanent d’un cœur resté sensible et bon, en dépit des revers et des rudes épreuves qu’il a traversé. Heureusement j’éloigne, autant que je le puis, les tristes pensées. Je cherche même à m’étourdir, et feuilletant de nouveau le livre du destin, je n’y vois que joies et prospérités !... Et puis ! Sans croire précisément à tout ce que vous promet ou vous a promis une imagination jeune et souvent en délire, il existe toujours dans le cœur de l’homme, et cela même après les plus cruelles vicissitudes, une lueur d’espérance. Sans espérance mieux vaut mourir ! a dit le poète. Et en effet qui soutient l’exilé dans son exil, le prisonnier dans sa prison, les malheureux naufragés luttant au milieu des flots furieux ? L’espérance, toujours l’espérance ! Vous-même, mon cher oncle, pensez-vous nous avoir dit un dernier adieu ? N’avez-vous jamais rêvé que vous vous trouviez, vous et les vôtres, au milieu de nous, parcourant avec bonheur les lieux où s’écoula votre enfance, retrouvant ici un arbre aimé, là un chemin boisé jadis votre promenade favorite ? Eh bien ! Si ce rêve a été le votre, c’est que vous avez encore au cœur l’espoir de retour ; car les rêves ne sont-ils pas des miroirs où viennent se refléter fidèlement toutes les émotions de notre âme, tous les désirs que nous pouvons former ?
Lorsque votre lettre m’est arrivée, ma mère était près de moi, et j’eus ainsi le plaisir de la lui lire, plaisir du reste mêlé de regrets, puisque je vis couler ses larmes et que moi même je fus profondément ému ! C’est que dans toute votre épître régnait un ton de tristesse difficile à décrire et que vous aviez mis à profit le précepte d’Horace « si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi ».*
Mardi dernier 18 courant, j’ai eu le bonheur de voir mon père que jusqu’à présent sa mauvaise santé avait retenu à Verdun, mais hélas ! Ce bonheur a faillit nous coûter bien cher et, empoisonner pour jamais le reste de notre vie, à ma mère et à moi. Voici le fait : Mon bon père se trouvant mieux depuis quelques temps, se décide à faire le voyage de Chalon, pour cela on loue un cabriolet, bien suspendu, Abel se charge de conduire et ils partent en passant par Gergy où mon frère avait un malade à visiter, bref le voyage se fait très bien, mon père ne se trouve point incommodé par les cahots de la voiture, et ils vont toucher au terme de leur trajet, lorsqu’ils voient venir à eux un lourd chariot : alors soit par imprudence de la part d’Abel, soit de la part du charretier, ils heurtent violemment la voiture de celui-ci, les deux timons de la leur se brisent comme du verre, la capote du cabriolet, n’étant plus soutenue tombe sur la croupe du cheval qui, effrayé lui-même et légèrement blessé au pied part au galop… représentez-vous, si vous le pouvez, la position de mon père et de mon frère dans cette caisse roulante, où, presque privés de lumière, une mort horrible les attend ! Fort heureusement mon frère n’avait pas lâché les rênes, ce qui lui permit de modérer un peu le cheval et donna aux spectateurs de cette catastrophe le temps de leur porter secours.
Je n’essaierai pas de vous dépeindre la scène qui se passa chez moi, lorsque maman qui était à la maison depuis deux jours et moi, nous vîmes arriver mon papa et mon frère, ce sont de ces émotions qui vibrent vivement et longtemps dans le cœur, mais qui ne peuvent se traduire sur le papier. Enfin dieu soit loué ! ils n’ont point de mal, à part cependant, quelques contusions.
Excusez-moi, cher oncle et vous aussi chère tante, de vous avoir entretenu si longuement de nos misères. En le faisant j’ai obéi à ce sentiment naturel qui nous pousse à confier, même à autrui et à plus forte raison à des proches, à des amis, nos joies, nos douleurs ! Ne faut-il pas que le cœur humain s’épanche, qu’il déverse le trop plein de ses émotions dans le sein d’un ami !...
Que fait Henri ? Commence-t-il à sentir le prix du travail ? Et lui enseignez-vous à aimer le peuple et la liberté et à détester toutes les tyrannies ? Il est encore dans l’âge heureux où nul souci n’a passé sur le front, sur la vie de l’enfant qui sourit et qui nous fait envie, hélas ! à presque tous !
Adieu, mon cher oncle, je vous embrasse de tout mon cœur ainsi que ma chère tante, je vous prie de croire à l’affection de votre neveu.
Amédée Jeandet
Pharmacien
J’embrasse Henri.
P.S. Mon papa, maman et Abel vous embrasse tous. Mon frère vous écrira très probablement dans quelques temps
* Si vous voulez que je pleure, commencez par pleurer vous-même.
***
Blaye, 18 juillet 1850
Nous avons tremblé, mon cher Amédée, au récit que tu m'as fait de la catastrophe qui a failli devenir funeste à ton père et à Abel, et à l'idée des transes mortelles dans lesquelles vous dites être ta pauvre mère et toi, lorsque vous les vites arriver sous l'impression récente et terrible de l'affreux péril auquel il venait d'échapper. Heureusement, vous en avez été quitte pour la peur ; car, que sont quelques contusions, lorsque la vie a été en question ? Voilà pourtant à quoi on est exposé lorsqu'on habite aux 2 extrémités opposées de la France. On vit, les uns relativement aux autres, dans une sorte d'apathie née de l'habitude d'une longue séparation ; Et l'on peut apprendre, sans que rien y ait préparé, qu'on a perdu des êtres dont l'affection fut autrefois une nécessité, une partie même de l'existence ! A mon âge, mon cher Amédée, quand, chaque jour se relâche ou se brise un des anneaux qui rattache la vie passée à la vie présente, quand ce monde toujours si bruyant et animé parcequ' à ceux qui s'en vont succèdent ceux qui viennent, se change de plus en plus en un vaste désert, où, de distance en distance errent quelques ombres vaines et faibles débris des affections premières ; le cœur, violemment ému par un choc que rien n'avait fait prévoir se retrouve jeune pour sentir et par conséquent pour souffrir, l'un, dans notre triste humanité, étant à peu près inséparable de l'autre. On se demande alors ce qu'on a fait de sa vie, à quoi on l'a dépensé, pourquoi, de quels spécieux prétextes qui ait pu être coloré de renoncement volontaire aux biens les plus précieux, on ….....priver de sa terre natale qui pour la 1ère fois dilata les poumons et donna une nouvelle vie chaque fois qu'on le respire ; de ces paysages sur lesquels s'arrêtèrent les yeux en s'ouvrant à la lumière ; de ces habitudes, de ces attachements d'enfance et de jeunesse qui survivent à toutes les agitations postérieures ; et de ces jouissances de la famille hors desquels tout n'est illusion et mensonge, Il y a bien longtemps que j'ai ressenti et exprimées les mêmes idées ; mais elles me reviennent plus fréquentes et plus fortes par ce sentiment naturel qui, lorsque l'homme touche à son déclin, le porte à désirer que sa tombe soit rapprochée de son berceau et du dernier asile ou reposent ses pères, c' est, en obéissant à une inspiration de ce genre que j'ai adressé à monsieur le recteur de l'académie de Dijon, une lettre demeurée jusqu'à présent sans réponses, et dans laquelle je lui demandais des renseignements sur le collège de Cluny, mis en régie par la ville, dont le principal reçoit un traitement de 3000. Dans le même but je désirerais que, si cela était possible tu me transmisses quelques documents sur le collège de Chalon, sur la position du principal, sur celles des fonctionnaires chargés de la philosophie et de la rhétorique, s'ils doivent ou non conserver leurs postes et quelle en est l'importance. Dis aussi à Abel d'écrire à ses amis de Dijon, afin de savoir s'il y aurait quelque chaire vacante au Lycée. Si j'avais quelques données précises, je pourrais faire au moins, non avec espérance du succès, mais avec certaines probabilités des tentatives pour obtenir.
En lisant cette lettre, mon cher Amédée, tu vas te dire : mon oncle vient sans doute de relire Homère et il me fait une contrepartie des discours du vieux Nestor. Soit, mais tu me rendras la justice de reconnaître que je ne suis pas : Laudator temporis acti.
Je vois, avec satisfaction, que tu te fais à ta situation. Après les premiers embarras, résultant de méritables;;;;;;;;;;;;;;;responsabilité personnelle dont tu n'avais pas dicté ta …...............nécessairement à la pensée toujours agréable parce qu'elle chatouille une des fibres les plus sensibles du cœur humain, qui à côté des ennuis et des inconvénients sont les dédommagements et les avantages que tu vaux quelque chose par toi même, que tu es maître et chef de cet établissement que tu as pris rang dans la cité, non seulement comme civil mais encore, comme membre actif et utile de la société, Je te le répète, mon ami, j'augure bien de ton avenir, il sera tranquille, comme devrait l'être celui de tous les hommes, s'ils avaient le moins de monde la conscience de ce qui peut constituer, le véritable bonheur, honorable, comme il convient à celui qui n'a devant lui que de bonnes traditions et de bons exemples ; heureux autant que l'on peut l'être sur cette terre, en cherchant et trouvant près de toi ce que trop souvent on cherche vainement ailleurs. J'ai eu ces jours ci une seconde visite des Mr et Mme LEC ;;;; que j' avais invité à venir faire leurs adieux à ma femme qui devait partir pour Paris, mais dont le voyage est retardé. Ils m'ont chargé de leurs amitiés pour vous tous.
Adieu, mon cher Amédée, Henri, ta tante et moi nous t'embrassons de tout cœur et te prions de ne pas nous oublier auprès de notre monde verdunois, Tout à toi
signé Chapuis
***
Tâche, mon cher ami, de voir demain le notaire Bernard, et vas à cet effet le demander chez M. Adenot, s’il ne vient pas chez toi. Sache enfin de lui, s’il ne conserve pas quelque espérance de sortir de la malheureuse affaire où il se trouve. Il me semble à moi qu’en mettant en jeu toutes les personnes qu’on connaît et qui jouissent de quelque influence, il n’est pas impossible de conjurer le nouvel orage. Je regrette beaucoup qu’il ne soit pas venu à Verdun où nous aurions parlé ensemble. Fais en sorte de l’y décider, car nous avons encore du temps devant nous.
Informe le que sa pauvre mère vient chaque jour nous voir pour nous demander des nouvelles, instruite qu’elle est qu’Abel a écrit dimanche dernier. Jusqu’ici nous lui avons caché la vérité ; mais les craintes sont telles qu’elle semble la deviner ou à peu près. Notre embarras avec elle est extrême et ne saurait durer bien longtemps. Elle ne parle de rien moins que d’aller elle même à Rully pour sortir de ses cruelles incertitudes. Sa position nous cause à tous un mal difficile à concevoir. Je prie instamment Bernard de venir ici afin de nous aider de ses conseils et surtout de sa présence qui contribuera davantage à la rassurer.
Dans la supposition où il ne serait pas à Chalon demain, fais le moi savoir par Claude porteur du présent.
Nous nous portons bien. J’ai fait aujourd’hui en voiture suspendue un voyage à Gergy, lequel m’a un peu fatigué, mais depuis deux ou trois heures de repos je suis beaucoup mieux et depuis trois ou quatre jours je me suis trouvé si bien qu’il me semble que je touche à la fin de ma maladie. Cela durera-t-il ? Je n’ose pas le croire.
Adieu, mon cher fils, porte toi bien ton affectionné père
Jeandet
Verdun le 3 octobre 1850
***
Mon cher ami,
A l’arrivée de Claude tu feras porter à son adresse la lettre ci-incluse, qui a pour but d’obtenir de M. Fafier un certificat qui me dispense, vu mon indisposition, d’aller à Chalon le 8 du mois prochain pour déposer, près du tribunal de police correctionnelle, dans l’affaire qui s’est passé entre Jeannin et Boissard, et dont il a été, je crois, question quand tu étais ici. Ton frère ira vendredi chez M. Fafier chercher cette pièce, et fera les démarches ultérieures qui devront m’éviter le déplacement.
Ta lettre d’hier nous a profondément contristés, moi surtout. Ta nature naturellement soucieuse et mélancolique a réagi sur la mienne qui n’a déjà que trop de propension à se tourmenter. Assurément c’est une chose déplorable que l’exposé de ton actif et de ton passif quand on a en perspective que les nouvelles charges qui vont peser sur ce dernier. Nos illusions se dissipent peu à peu, et la seule que j’avais, moi, celle d’un bon et fortuné mariage, ne paraît pas devoir se réaliser si tôt. Dans les graves extrémités, toutes nos études doivent tendre à y trouver remède. Je n’en reconnais point de plus efficace que celui d’en détruire la cause, à moins que cet axiome ne soit faux. Sublata causa tollitur effectus*
Commencé notre exploitation comme de grands seigneurs, il est évident aujourd’hui que nous ne saurions la continuer sans devenir nos propres domestiques, seul moyen de ramener la dépense au niveau du produit. Tu vois qu’il s’agit ici d’une réforme qui s’étend sur toutes les branches du personnel et de l’administration. Nous parlerons de tout cela à notre plus prochaine entrevue, mais dès aujourd’hui tu peux commencer l’épuration, car tu devines d’avance à qui elle s’applique et quelles en seront les futures conséquences. Jamais je ne me suis trouvé avec de si forts engagements et si peu de ressources pour y satisfaire. Je ne m’abuse plus : ma clientèle est morte et bien enterrée, et dut-elle reprendre un jour, mon âge et ma santé me priveraient de la faculté d’y répondre. Si je ne dois pas compter sur toi et ton frère, mon plus amer regret est de sentir que désormais vous ne pourrez guère compter sur moi. Malheureux que nous sommes. Ne nous voilà-t-il pas réduits à dire avec les sages de notre siècle : chacun chez soi, chacun pour soi.
Ne vas pas, mon cher enfant, t’attrister outre mesure de ces pénibles réflexions, ni les prendre à la lettre, car elles ne seront jamais à nos yeux qu’une règle de conduite abjecte et méprisable. Fais moi connaître tes besoins, et sois assuré d’avance de l’empressement que je mettrais toujours à les alléger.
Adieu, porte toi bien et le reste et tout ce qui manque te viendra plus tard.
Ton affectionné père.
Jeandet
Verdun le 28 octobre 1850
* Pas d’effet sans cause.
***
Chalon, 31 octobre 1850
Le silence que j’ai gardé à votre égard depuis notre séparation, doit vous paraître bien singulier, pour ne pas dire plus, et comme vous ne me connaissez encore que très imparfaitement, peut être m’avez-vous accusé d’oubli ou pour le moins d’indifférence. Eh pourtant ! il n’en est rien : au contraire, je me suis toujours informé de vous et des vôtres auprès de la maman Bellami et c’est même un des motifs de mon silence. Et puis je dois vous avouer que tout en aimant beaucoup recevoir les lettres de mes parents et amis, j’ai toujours été fort avare des miennes. On dit que César dictait jusqu’à 4 lettres à la fois ! Si le fait est vrai et que j’aurais rêvé de son temps, je lui en aurais certainement témoigné toute mon admiration. Loin de dicter quatre lettres à la fois, je m’estime déjà fort heureux lorsqu’il m’arrive d’en écrire une seule passablement. Maintenant que vous connaissez ma profession de foi épistolaire, oserais-je vous interroger, sur votre nouvelle position ? Sur Montréal et ses environs ? Si je juge cette ville d’après l’étymologie de son nom, qui à la vérité pourrait bien avoir une signification toute apposée, vu la prédilection naguère de nos ancêtres pour l’antithèse, je me la représente situé au sommet ou sur les flancs d’une montagne, absolument comme un nid d’aigle ou de vautour. J’ai appris avec plaisir que Mme Pascal commençait à s’acclimater dans votre pays, il paraît même que le séjour dans cette contrée lui est salutaire, puisque je me suis laissé dire qu’elle avait repris un certain embonpoint qui, ajoute la chronique, lui sied à merveille ; Je la félicite doublement de ces heureux résultats et souhaite qu’ils soient durables. A propos ! Que devient la pharmacie dans le midi de la France et vous satisfait-elle personnellement ? Vous ignore peut être mon cher confrère, que le monde pharmaceutique va, viens, s’agite en tous sens ; qu’il adresse au chimiste Dumas, devenu ministre, pétition sur pétition, et que nos confrères, les professeurs de l’école de Paris, c’est à dire les gros bonnets, les aristos de la pharmaceutique, rédigent de magnifiques rapports, dont l’heureux effet, s’ils étaient suivis, serait la division des pharmaciens en deux classes. Ces dignes savants comme vous le voyez, secondent admirablement le gouvernement éteignoir du neveu de son oncle par des idées éminemment progressives ; ils semblent professer un si grand culte pour tout ce qui est vain, tout ce qui est suranné et en désaccord avec nos mœurs, que je ne serais pas surpris de les voir demander le rétablissement du faux serment des apothicaires dans lequel ces derniers juraient d’observer fidèlement la religion catholique apostolique et romaine. Mais allez-vous me dire, que fera-t-on de ces deux classes de pharmaciens ? Ma foi je n’en sais trop rien et c’est ce dont s’occupent fort peu messieurs les rapporteurs dont l’unique préoccupation, en tout ceci, est de pouvoir revêtir la robe et coiffer le bonnet de docteur. Pourtant, autant que je puisse me rappeler l’esprit et la lettre des rapports, les pharmaciens de première classe, parés du titre pompeux de docteur, habiteraient exclusivement les grandes cités, ce seraient à proprement parler les vrais lettrés et partant les seuls capables de conserver dans tout son éclat une profession qui fut celle des Bayer, des Vauquelin et des Parmentier ! Quant aux pharmaciens de deuxième classe, que vous en dirais-je ? Ces pauvres diables, relégués dans les bourgs et villages où ils donneront des clystères et vendront du thé suisse, se tireront d’affaire comme ils l’entendront ; Heureusement qu’il est à présumer que leurs quasi confrères, les docteurs en pharmacie, touchés de la pauvreté de quelques uns, les recueilleront dans leurs officines, où ces demi-pharmaciens s’estimeront très heureux de nettoyer les mortiers et de broyer les habits de Monsieur le docteur. Voilà, mon cher confrère, où en sont les choses. Qu’en résultera-t-il ? je l’ignore. Ce que je sais parfaitement, c’est que , si la pharmacie tente de s’élever au premier rang des professions scientifiques et honorifiques, elle perd sensiblement tous les jours de son importance comme profession curative. Et le jour n’est pas loin peut être où nous verrons les pharmaciens rechercher autre chose que des titres : en effet à quoi servent-ils ? bien souvent ils ne confèrent pas la science et parce que jamais ils ne sont une recommandation auprès des masses. Veuillez excuser, mon cher Monsieur Pascal, de vous avoir entretenu aussi longtemps sur ce sujet, mais comme il avait trait à notre honorable profession, j’ai pensé qu’il ne vous serait peut être pas indifférent. Il n’y a rien de neuf dans notre cité ou du moins je n’en sais rien moi personnellement. Il est vrai que je sorts fort peu et que je vis exclusivement dans la société de mes bocaux que j’époussette du matin au soir, n’ayant rien de mieux à faire.
Adieu mon cher confrère, portez-vous bien, Veuillez faire agréer mes hommages à Madame Pascal et recevoir vous même les salutations empressées de votre dévoué serviteur.
Amédée Jeandet
****
Je t’envoie, mon cher ami, le certificat qui me dispense d’aller à Chalon pour témoigner dans l’affaire Jeannin-Boissard. Mon absence et celle de ton frère sera indubitablement cause que cette affaire ne sera point entendue au jour fixé, ma déposition surtout me paraissant être la plus importante. Dans le cas où l’audience viendrait à s’ouvrir tu porteras toi-même en mon nom ou tu la donneras à Bailly ou à Masoulle qui y assisteront, l’attestation dont il s’agit, et après sa lecture, si elle a lieu, tu feras en sorte de te la faire rendre pour qu’elle reste à l’avenir en ma possession à l’effet de m’en servir de nouveau si j’étais obligé de me déplacer soit pour une circonstance semblable soit pour tout autre.
Je n’ai pas pu voir Jeannin dans ces derniers jours. C’est lui qui poursuit et j’aurais usé de toute mon influence pour obtenir son désistement car je porte un intérêt égal aux deux adversaires. J’espère encore que nos verdunois qui se rendent à Chalon à titre de témoins comme moi, se verront auparavant, et viendront peut être à bout de tout concilier avant d’aller au tribunal. Je t’engage à les voir et à joindre tes efforts aux leurs afin d’arriver à ces résultats.
Nous avons reçu aujourd’hui une lettre de ton frère. Le voyage a été fort heureux ; ni lui ni sa femme n’en ont été incommodés. Ils sont allés se promener le cinq, par une vraie journée de printemps, au jardin des plantes. Nous nous réjouissons ici, à cause d’eux, du beau temps qui règne et qui semble devoir durer.
Il y a un certain M. Jeannin d’Auroux qui vient assez souvent te voir, signe assez certain que tu lui vas et qu’il te trouve de son goût. Il y a enfin une certaine demoiselle Corillas du même endroit qui pourrait, dit-on, te convenir dans la grave affaire matrimoniale que nous méditons. A ta première entrevue avec M. Jeannin, ne manque pas de lui demander de longs détails sur cette jeune personne et sur sa famille.
Nous t’attendons samedi soir ou dimanche matin.
Adieu, mon cher ami, portes-toi bien, ton dévoué père et ami.
Jeandet
Verdun le 7 novembre huit heures du soir (1850)
Pourquoi ne nous as tu pas accusé réception des 600francs qu’on t’a dernièrement envoyés ?
***
Mon cher fils,
L’affaire Jeannin-Boissard va être de nouveau appelée en justice correctionnelle, demain vendredi 22 courant et sera très probablement remise à huitaine à cause de mon absence, comme étant un des plus importants témoins. Je t’envoie le certificat, où sont rappelés les motifs qui m’empêchent de me rendre à la citation. Tu n’oublieras pas ce que je t’ai précédemment recommandé à ce sujet, de confier cette pièce à une personne sûre, à l’avoué par exemple, qui, après sa production, fera en sorte de la ravoir, afin que, le cas échéant, elle me puisse servir derechef.
Maître Boissard mêle à tout cela tant de mauvaise foi et des faits qui y sont tellement étrangers, que je regrette sincèrement de ne pas pouvoir aller à Chalon pour le confondre par ma déposition.
Nous avons reçu aujourd’hui seulement une lettre de ton frère en réponse à celle que je lui ai écrite il y a huit jours. Ainsi que je l’avais présumé, les questions qui font suite à sa thèse, sont de graves et difficiles obstacles à surmonter, puisqu’elles embrassent les sciences médicales tout entières, et qu’on ne les connaît qu’au moment même où il faut y répondre. Tu te garderas bien d’en parler à la famille Doyen et tu te borneras seulement à leur dire qu’il est contraint de se livrer à un long travail préliminaire qui absorbe tout son temps. Les nouvelles qui les concernent ne manquant sans doute pas à Chalon, mais j’ajouterai, par surabondance, qu’à la date du 19 de ce mois, Abel et sa femme jouissaient d’une bonne santé.
Depuis huit jours, je me porte tout à fait bien, à la vérité je ne sors presque pas du coin de la cheminée. On ne songe guère plus à moi que si je n’avais jamais fait de médecine, et cela, après bientôt 40 ans.
Tu nous enverras par Masoulte qui te remettra ce paquet une once d’extrait d’opium et une chaîne de pois d’iris n°9 dont tu nous indiqueras le prix.
Adieu, mon cher ami, portes toi bien, ton tout dévoué père et ami.
Jeandet
Verdun le 21 novembre 1850.
***
Je ne suis pas comme toi, mon cher fils, je n’élève aucun doute sur l’exactitude de la nouvelle qui nous est venue de Paris. C’est bien aujourd’hui qu’a lieu la grande et dernière épreuve dont nous attendons l’issue avec tant d’anxiété. étrange coïncidence ! il y a juste trente sept ans ( 28 décembre 1813) que c’était mon tour. D’ici je vois notre pauvre Abel sur la même sellette où j’étais alors, affublé probablement de la même robe que je portais et dont la taille complaisante doit se prêter à toutes les formes. Ridicule mascarade qui ne se joue, du reste, qu’une fois en ta vie. Il y a juste aussi sept ans, sans trop exagérer que tout cela devrait être de l’histoire. Dieu veuille que notre récipiendaire ait l’aplomb et la fermeté dont j’ai, peut être, le premier donné l’exemple en pareille conjoncture.
Si mes calculs sont exacts, on pourrait écrire de Paris aujourd’hui même, après la séance qui finit ordinairement à trois heures du relevé. Vous auriez dans ce cas une lettre demain soir, et lundi matin vous nous en feriez connaître le contenu, sinon nous ne saurons rien avant mardi et vous avant lundi.
Ta mère a reçu à midi une lettre de Flavie, qui confirme ce qu’elle a écrit précédemment, c’est à dire que la thèse sera soutenue à la fin de la semaine ou aujourd’hui 28. Sa santé légèrement altérée il y a quelques temps est tout à fait bonne à présent. Voilà ce que tu auras soin de dire, pour leur entière sécurité, à l’excellente famille Doyen. Tout porte à croire que le jour de l’an se passera à Paris, car, trois à quatre jours ne sauraient suffire pour faire les préparatifs d’un départ aussi compliqué.
J’aurais eu à souffrir aussi fort que toi au milieu des si, des ah ! et des oh ! dont tu as été assailli avant hier. Ces braves gens ne se doutent guère que nous vivons à travers toutes ces perplexités, depuis plus de dix ans. Sans cette maudite affaire de mariage et la tienne, j’aurais acheté, mardi dernier, vingt trois journaux de terre qui vaudraient un tiers ou moitié en plus dans trois ou quatre ans seulement.
Adieu, mon cher ami, porte toi bien, ton père et ami
Jeandet
Verdun le 28 décembre 1850
P.S. à l’heure où l’on distribue les lettres, ne manque pas d’aller demain chez M. Doyen afin de nous tenir nous même au courant de ca que l’on aura appris, ainsi que je te l’ai expressément recommandé plus haut. Nous pouvons gagner de cette manière 24 heurs, ce qui n’est pas peu de chose dans l’incertitude où nous nous sommes.
***
Chalon sur Saône 31 décembre 1850.
Chère mère,
J’apporterai demain avec moi tout ce que tu me demandes dans le billet que m’a remis Madame Bernard. Si je t’écris aujourd’hui, quoique devant avoir le plaisir de t’embrasser demain, pourvu cependant que M. le courrier veuille bien me réserver une place, c’est exclusivement pour une question de bouche !...question de bouche ! que voilà une question heureuse dont Brillat-Savarin doit être jaloux même dans l’autre monde s’il y en a un !Ceux qui parlent le jargon politique disent à tous propos « la question à l’ordre du jour est ceci, est cela ; » hier c’était la question d’orient, demain ce sera la question anglo-russe ; pour moi en fait de question, je m’en adresse souvent une et c’est celle-ci : mais mon pauvre Amédée, avec quoi diable souperas-tu ce soir ? Je reviens donc à la question ou mieux j’y reste car j’y suis plus que jamais, et je te prie, chère mère, de m’acheter demain le matin assez de bœuf pour me préparer un ?? que je rapporterai ?? Maintenant, peut être voudrais tu savoir pourquoi je te fais une semblable demande ? c’est qu’il pourrait bien se faire que mon Laplanche aille pour la Noel visiter le toit paternel, et alors, alors, qui surveillera les fourneaux ? Qui tiendra la queue de la poêle ?
A demain chère mère, je t’embrasse ainsi que mon père, votre fils, assez à plaindre du reste quoiqu’il plaisante.
Amédée Jeandet.
Date de dernière mise à jour : 05/02/2016
Ajouter un commentaire